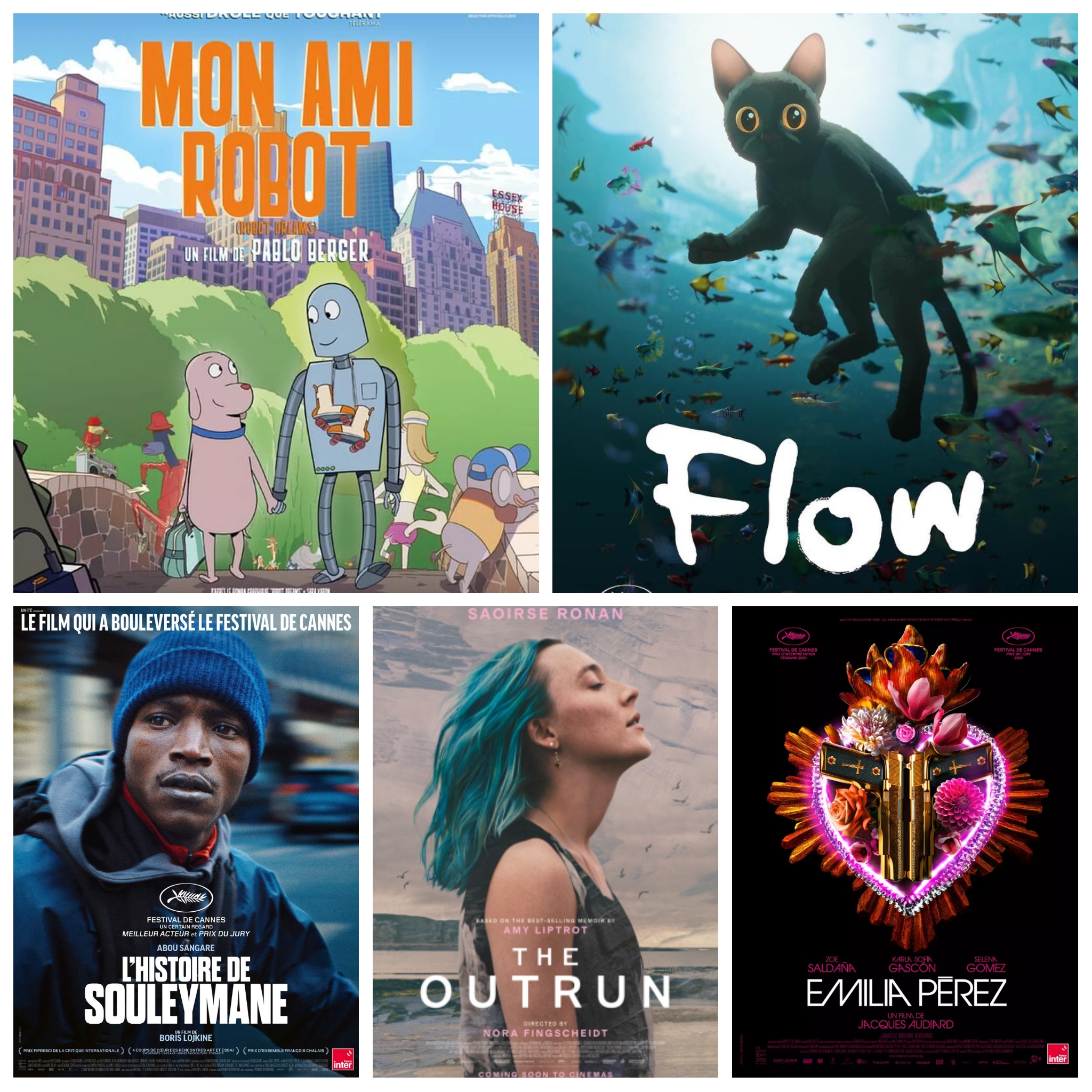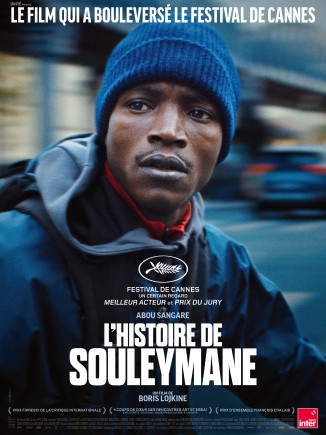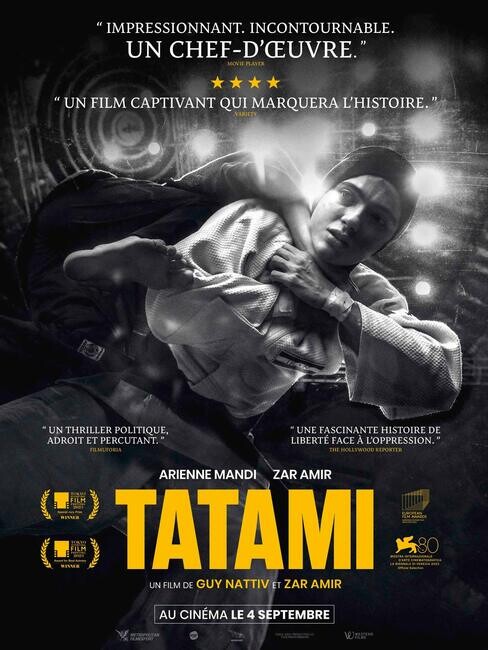Durant le mois de février, j’ai pu lire sept livres :
-« D’autres étoiles, un conte de Noël » d’Ingvild H. Rishoi qui arrive un peu tard après Noël mais que j’ai beaucoup apprécié quand même ;
-« La loi de la tartine beurrée » de J.M. Erre où je retrouve avec plaisir l’humour caustique d’un de mes auteurs préférés ;
-« Francoeur, à nous la vie d’artiste » de Marie-Audre Murail et Constance Robert-Murail, une formidable fresque familiale qui nous plonge dans le Paris de 1848 ;
-« La marque de naissance » de Nathaniel Hawthorne, une nouvelle qui parle de gaslighting avant l’heure. Et je tiens à souligner le magnifique travail éditorial des éditions Tendance Négative ;
-« Love » d’Elizabeth Von Arnim qui est l’un des meilleurs romans de l’autrice et qui aborde le thème très moderne de la différence d’âge dans le couple ;
-« Ida ou le délire » de Hélène Bessette pour lequel j’ai eu un gros coup de cœur et qui dresse le portrait d’Ida, une femme de ménage, qui vient de mourir à travers le regard de ses employeurs ;
-« Chiens des Ozarks » d’Eli Cranor qui est le premier roman de l’auteur et nous entraine dans le Deep South où le trafic de drogue gangrène l’Arkansas.
Côté cinéma, je vais vous parler des neufs films vus ce mois-ci dont voici mes deux préférés :
Dans le Maine et Loire, deux amis fusionnels pratiquent le motocross. Jojo pilote sa moto tandis que Willy s’occupe de la mécanique. Le premier a de grandes chances de remporter le championnat et il est poussé par son père autoritaire et son entraineur. Les deux jeunes garçons, en terminale, profitent de la vie, s’enivrent de la vitesse et de leurs exploits motorisés. Pourtant, leurs destins vont s’assombrir après la révélation d’un secret bien gardé jusque là.
Antoine Chevrollier avait auparavant réalisé la formidable série « Oussekine » avec Sayyid El Alani dans le rôle titre que l’on retrouve ici dans celui de Willy. Contrairement à ce que laissent penser les premières images, ce n’est pas le solaire et intrépide Jojo qui sera le personnage principal du film mais bien Willy. Il est essentiellement observateur de l’action, il est mécanicien et il n’est donc pas celui qui concoure. Il sera également spectateur du drame qui va se dérouler devant ses yeux sans qu’il puisse intervenir ou l’empêcher. « La pampa » sera le film de son apprentissage, de son envol aussi. Sayyid El Alani est encore une fois épatant, d’un naturel confondant. Les autres personnages sont intéressants, leur psychologie est complexe, ils ne sont jamais manichéens. C’est le cas notamment du père de Jojo et de son entraineur (Damien Bonnard toujours excellent et Artus Solaro qui nous surprend dans ce rôle) qui ne sont pas accablés par le réalisateur malgré leur toxicité. « La pampa » est un film profondément touchant servi par un formidable casting (je n’ai pas encore cité Amaury Foucher dans le rôle de Jojo) et qui arrive à surprendre son spectateur.
1971, la famille Paiva semble heureuse, unie. Rubens, le père, est ingénieur et ex-député travailliste. La maison est grande ouverte aux amis, sur la plage où s’échappent sans cesse les cinq enfants. Un joyeux tourbillon qui est soudainement obscurci par le passage d’un hélicoptère militaire au-dessus de la plage ou d’un camion rempli de soldats. La dictature militaire garde la population brésilienne sous sa coupe. Rubens va d’ailleurs être arrêté et sa famille ne le reverra jamais. Sa femme Eunice va se battre pendant vingt cinq ans pour que l’Etat reconnaisse la mort de son mari.
« Je suis toujours là » n’éblouit pas par sa mise en scène très classique, mais par la justesse de l’histoire racontée et celle de ses personnages. Walter Salles a connu la famille Paiva et il a fait partie des personnes invitées dans leur maison à Rio en face de l’océan. Le film est d’ailleurs tiré du livre de Marcello, le fils d’Eunice et Rubens. La proximité avec les personnages est donc bien réelle, profonde et Walter Salles nous fait pénétrer directement dans leur intimité. L’empathie est immédiate et elle ne faiblit à aucun moment. « Je suis toujours là » est un portrait de famille mais surtout celui d’une femme admirable : Eunice Paiva. Son courage (elle fut également incarcérée brièvement), son abnégation, sa détermination forcent l’admiration. A 48 ans, elle est devenue avocate et s’est battue pour les droits des peuples autochtones. Avant que la famille ne quitte Rio, des journalistes viennent faire un reportage et des photos où ils souhaitent montrer l’ampleur du chagrin des Paiva. Mais Eunice demande à ses enfants de sourire comme un pied de nez à la dictature. A l’écran, Fernanda Torres incarne Eunice Paiva avec force et élégance. Un film infiniment touchant qui s’achève avec des photographies d’archive.
- « Mon gâteau préféré » de Maryam Moqadam et Behtash Sanaeeha : Mahin, une veuve qui vit à Téhéran et se sent très seule : ses enfants ont quitté le pays et elle ne voit ses amies qu’une fois par an. Un jour, elle se fait audacieuse et intrépide, elle invite un homme, croisé dans un restaurant de retraités, à venir chez elle. Faramaz, un chauffeur de taxi, accepte de la suivre. La soirée de Mahin et Faramaz est faite de tendresse, d’humour et de beaucoup de nostalgie. Les deux septuagénaires évoquent l’époque révolue où elle pouvait porter des robes décolletées, où il pouvait faire du vin dans sa cour avec ses amis. Durant la soirée, ils dansent, boivent, profitent des plaisirs simples qu’offre la vie. Tous deux sont infiniment touchants et leur bonheur fugace réchauffe le cœur. Maryam Moqadam et Behtash Sanaeeha ont été assignés à résidence, en attendant leur procès, pour ce film qui célèbre l’amour, la liberté et montre la régression de l’Iran du point de vue des mœurs.
- « L’attachement » de Carine Tardieu : Alors que sa femme vient de perdre les eaux, Alex laisse son beau-fils Elliot à leur voisine Sandra. Cette dernière est libraire, célibataire par choix et ne sachant pas se débrouiller avec les enfants. Pourtant, entre elle et ce petit garçon très éveillé, un lien immédiat se crée. Lorsque Alex revient de la clinique, il est le père d’une petite Lucille mais il est également veuf. « L’attachement » est un entrelac de liens amicaux, amoureux qui se construisent sur le deuil et le chagrin. La tendresse y a une place essentielle sans jamais tomber dans la mièvrerie. Les acteurs sont pour beaucoup dans la réussite de ce film : Valeria Bruni-Tedeschi et Pio Marmai en symbiose totale, mais également la fantasque Vimala Pons, l’incongru Raphaël Quenard, la sensible Catherine Mouchet et l’incroyablement naturel César Botti qui incarne Elliot.
- « Un parfait inconnu » de James Mangold : James Mangold, dont j’avais beaucoup « Walk the line » sur Johnny Cash, s’attaque à une figure mythique du folk et du rock : Bob Dylan. Il se concentre sur ses débuts de janvier 1961 à juillet 1965. De son ascension fulgurante à son passage à la guitare électrique qui fit scandale. Le biopic est classique mais sonne juste. Timothée Chalamet est parfait, très à l’aise dans les vêtements de Dylan et interprétant lui-même les chansons. Perpétuellement en train de créer, d’absorber son époque, Bob Dylan n’est pas non plus montré comme un saint. Il peut être fuyant, peu aimable notamment avec Sylvie Russo (Elle Fanning) ou Joan Baez (Maonica Barbaro) mais son génie de compositeur est indiscutable.
- « 5 septembre » de Tim Fehlbaum : Munich, 1972, la chaîne ANC diffuse en direct les Jeux Olympiques. Le 5 septembre, l’organisation palestinienne Septembre noir prend en otage une partie de la délégation israélienne. La chaine américaine se transforme alors en chaine d’information en continu. Tim Fehlbaum choisit de nous montrer les évènements uniquement du côté des journalistes qui doivent improviser face à ce drame imprévu. Ce qui est très intéressant, ce sont les questions éthiques que se posent les journalistes au fur et à mesure : diffusion d’images pouvant compromettre le travail des policiers, course au scoop, concurrence entre les chaines pour montrer les images en premier, annonce prématurée à la fin de la prise d’otages. Des interrogations qui sont toujours d’actualité. Le film est tendu et remarquablement interprété.
- « La pie voleuse » de Robert Guédiguian : Maria est aide ménagère chez des personnes âgées ou handicapées. Elle est très dévouée, patiente et chaleureuse. Mais Maria et son mari ont de grosses difficultés financières. Pour se soulager un peu et surtout pour payer les cours particuliers de piano de son petit-fils, Maria vole un billet par-ci, par-là et falsifie des chèques jusqu’à ce que le fils d’un de ses clients ne s’en rende compte. Retour à l’Estaque avec la merveilleuse Ariane Ascaride, Gérard Meylan, Jean-Pierre Darrousin, Robinson Stévenin, Grégoire Leprince-Ringuet et tous les autres ! La troupe de Guédiguian est au complet pour notre plus grand plaisir et le réalisateur fustige toujours la dureté sociale. Mais la bonté et l’humanisme peuvent encore exister et l’optimisme du réalisateur rayonne sur cette « Pie voleuse ». Même si l’histoire d’amour de la deuxième partie est un peu soudaine et improbable, je me plais toujours dans l’univers du réalisateur.
- « Hola Frida » d’André Kadi et Karine Vézina : Ce dessin-animé raconte l’enfance de Frida Kahlo : sa famille aimante, son envie de devenir médecin, la polio qui atrophia sa jambe droite, sa résilience face à la maladie et au handicap. L’ambiance est malgré tout joyeuse et pétillante, les couleurs vives comme celles de la Casa Azul. André Kadi et Karine Vézina rendent un bel hommage à la peintre, à la naissance de sa créativité et à son univers si singulier inspiré des origines du Mexique et de sa propre expérience. Le dessin est plein de charme et Frida adulte a la voix d’Olivia Ruiz (qui chante également une chanson originale).
- « Paddington au Pérou » de Dougal Wilson : Paddington part au Pérou pour rendre visite à sa chère tante Lucy. Mais arrivé là-bas, il découvre qu’elle a disparu de la maison de retraite pour ours où elle vivait. Il part donc à sa recherche aidé par la famille Brown. C’est toujours un plaisir de retrouver le célèbre ours en duffle coat (en vo la voix de Ben Whishaw est un régal) dont la maladresse est légendaire. Il est particulièrement bien entouré dans ce troisième volet avec Olivia Coleman en bonne sœur déjantée et Antonio Banderas en chasseur d’or obsessionnel. Hugh Bonneville est toujours de la partie et je regrette que Sally Hawkins ne fasse plus partie du casting. Rythmé, sympathique, plein de tendresse et d’humour, « Paddington au Pérou » séduira sans peine les amoureux de cet ours facétieux.