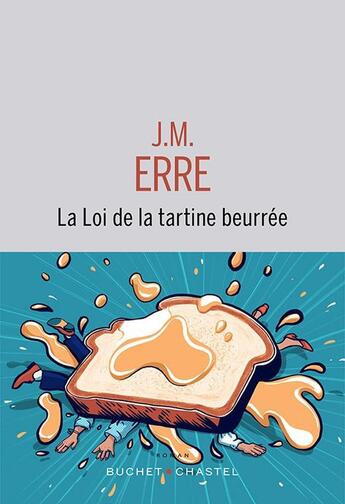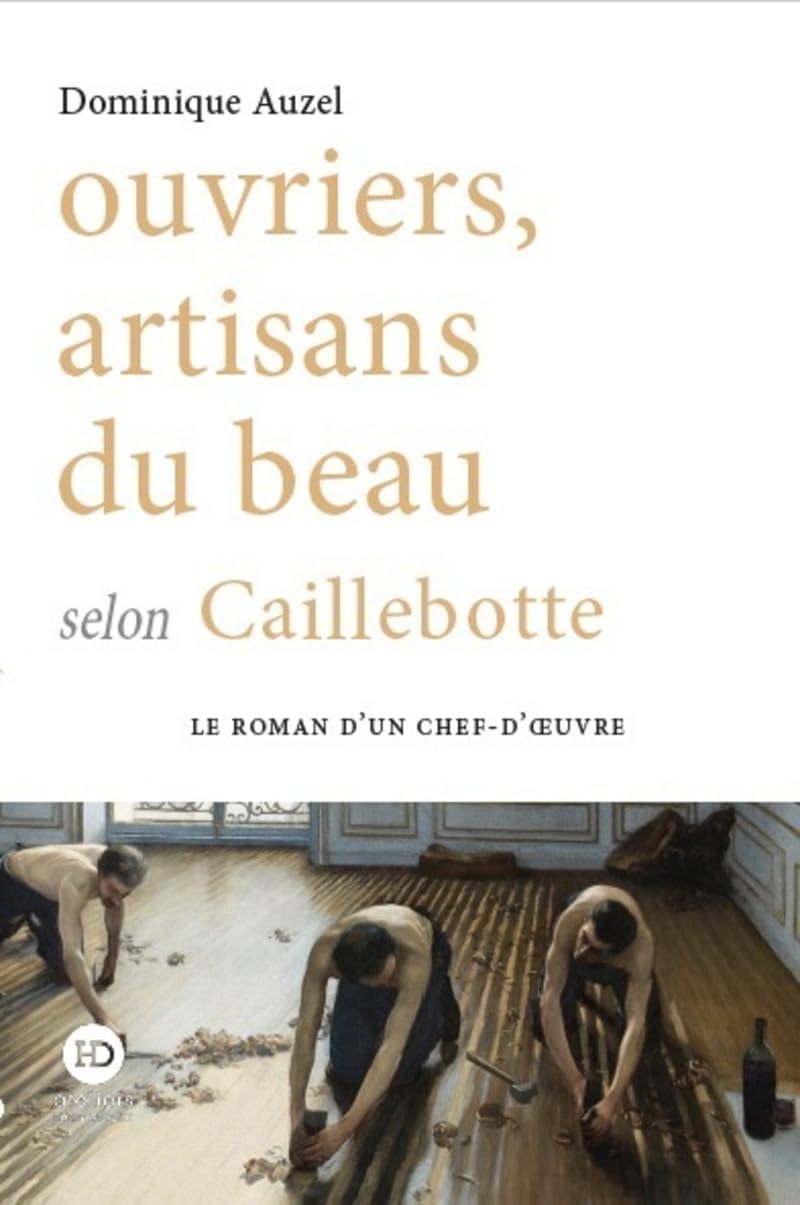A Berkeley, il est demandé au bibliothécaire de l’université d’aller récupérer à l’aéroport un nouveau professeur en provenance de Suisse. Notre narrateur est en effet français d’origine et il vit à San Francisco depuis les années soixante. Il fait donc la connaissance de Michel avec qui il sympathise immédiatement. Les deux hommes finissent leur journée au First and Last Chance, un bar près des docks que fréquentait Jack London au début du siècle dernier. C’est lors de cette soirée qu’ils rencontrent un hurluberlu se prenant pour l’auteur de « Mardin Eden ». Un original qui se révèlera fort sympathique et un puits de science sur l’œuvre de London…et sur San Francisco. Ce trio va rapidement se compléter d’une jeune femme, June. Celle-ci va louer une chambre chez notre bibliothécaire qui se sent bien seul depuis la mort de Martha, sa femme, et ce malgré la compagnie de son chat sourd.
Avec son dernier roman, Olivier Mak-Bouchard a quitté son Lubéron natal pour nous emmener dans sa ville d’adoption San Francisco. Comme dans ses précédents romans, j’ai eu plaisir à retrouver son écriture fluide et son talent de conteur. Il mélange toujours avec autant de facilité le réel et la fantaisie. On croise entre les pages du « Grand tout » aussi bien Sir Francis Drake, Jack London, Michel Foucault, un sabre japonais mythique et un certain Mickey Cromp, calamiteux président des Etats-Unis. Olivier Mak-Bouchard se fait plus politique dans ce roman. Notre quatuor de personnages s’interroge durant tout le roman sur la disparition ou non du rêve américain. Michel imagine que ce président destructeur n’est qu’une étape vers le meilleur, on imagine sans peine sa déconvenue s’il voyait l’état de l’Amérique aujourd’hui.
« Le grand tout » est une fable, une quête de sens teintée de pessimisme et de mélancolie et qui nous offre un formidable voyage dans la baie de San Francisco.