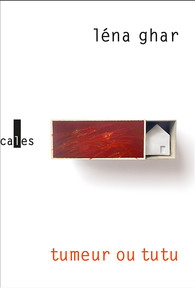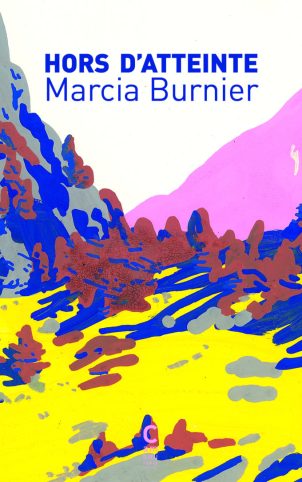
« Mais elle sait que quelques années après son départ, quand il était entré dans sa vie, il avait fini par la convaincre qu’elle avait peur de tout, tout le temps. Peur du froid. Peur d’être seule. Peur de ne pas savoir comment faire pour vivre. Qu’elle était une chose fragile, qu’il fallait protéger, isoler et enfermer, pour éviter qu’elle se blesse. Après cinq ans passés sous l’emprise de son compagnon, Erin a tout quitté pour se réfugier dans les Pyrénées. Dans une maison isolée, elle pose ses bagages avec sa chienne Tonnerre. Loin de tout, elle va essayer de se reconstruire notamment grâce aux randonnées en pleine nature. Elle a grandi dans les Alpes mais ne pouvait retourner en montagne en raison de sa soit disant fragilité. En raison des brimades, des remontrances, Erin est devenue peu à peu invisible. Elle doit réapprendre à se faire confiance, a effacé la peur.
Après la rage des « Orageuses », j’ai retrouvé une Marcia Burnier plus apaisée dans « Hors d’atteinte ». Comme dans son premier roman, elle traite du thème des violences faites aux femmes. Mais ici point de vengeance mais une reconstruction qui se fait lentement, au rythme de la nature qui entoure Erin. Le roman est une ode à la nature, à sa beauté qui peut émerveiller mais surtout consoler. Le personnage principal du roman retrouve des sensations oubliées et redonne toute sa place à son corps malmené. La compagnie des animaux, Tonnerre et le chat Idéfix, l’aidera également sur le chemin de la guérison. Au fur et à mesure, les flash-backs de sa vie d’avant deviennent de moins en moins présents, preuve qu’Erin se sent mieux.
Comme chez Jean-François Beauchemin, la beauté du monde, de la nature sauvage peut aider à surmonter sa peine. L’héroïne du deuxième roman de Marcia Burnier l’expérimente et nous explorons avec elle les sublimes paysages des Pyrénées. L’autrice nous offre à nouveau un très beau portrait de femme qui fuit pour mieux se retrouver.