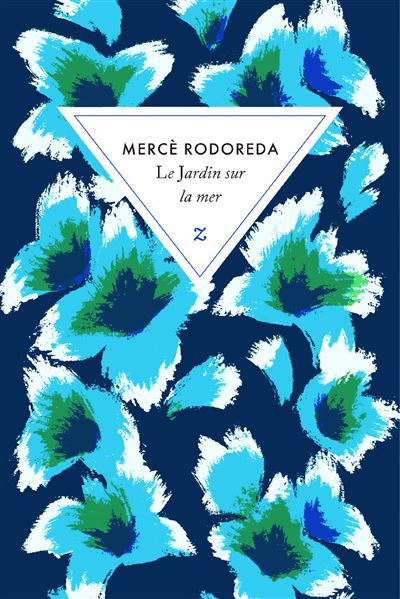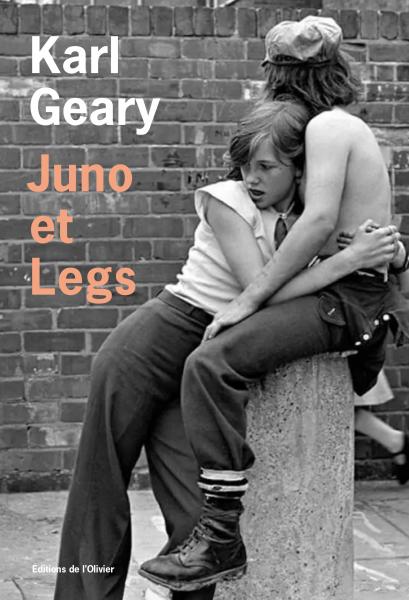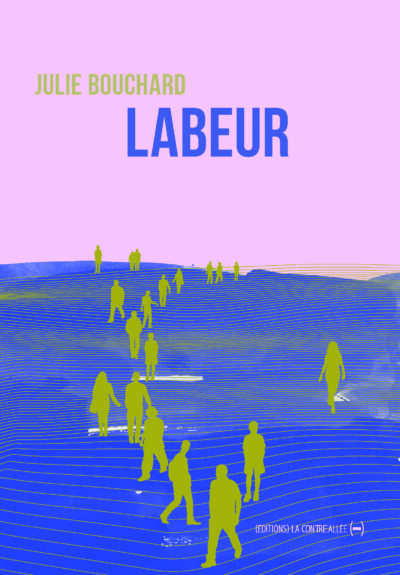« Moi, j’ai toujours aimé connaître tout ce qui arrive aux gens, bien que je ne sois pas bachelier… C’est parce que j’aime les gens. Et les propriétaires de cette maison, je les aimais. Mais cela fait si longtemps, de tout ça, dont je ne me souviens plus. Je suis trop vieux et parfois je m’embrouille malgré moi… » Un vieux jardinier se remémore les six étés où il travailla pour Mme Rosamaria et M. Francesc dans leur superbe villa surplombant la mer. Le jeune couple, issu de la bourgeoisie barcelonaise, arrive chaque année à la belle saison avec des amis comme le peintre Feliu qui ne peint que la mer. De somptueuses fêtes sont organisées dans le luxuriant jardin, des feux d’artifice, un lion et une guenon feront également partie des divertissements qui se déroule sous le regard amusé et indulgent du jardinier. Mais l’insouciance prendra fin avec l’arrivée d’un nouveau voisin qui fait construire une villa pour sa fille et son mari.
Je découvre Mercè Rodoreda grâce au « Jardin sur la mer » pour la première fois traduit en français. L’histoire du couple est vu au travers des yeux bienveillants de leur jardinier. Cet homme modeste, amoureux de la nature, est aussi attentif aux plantes qu’aux personnes qui vivent dans la villa. Il observe avec finesse, écoute avec patience et se dessine, grâce à lui, par petites touches la vie des autres. Les premiers étés ont un côté fitzgeraldien mais les bulles de champagne vont bientôt laisser la place à un drame poignant. Le passé des personnages jette une ombre sur ce lieu idyllique et le charme se rompt. Le récit du vieux jardinier, personnage infiniment touchant, se fait mélancolique et emprunt de désenchantement. Mercé Rodoreda décrit avec finesse et subtilité les sentiments, les actions de ses personnages, comme leurs secrets les plus enfouis.
Délicat, nostalgique, poétique, « Le jardin sur la mer » est un splendide roman qui me donne envie de découvrir toute l’œuvre de Mercé Rodoreda.
Traduction Edmond Raillard