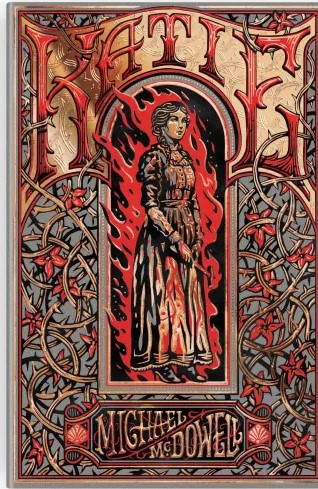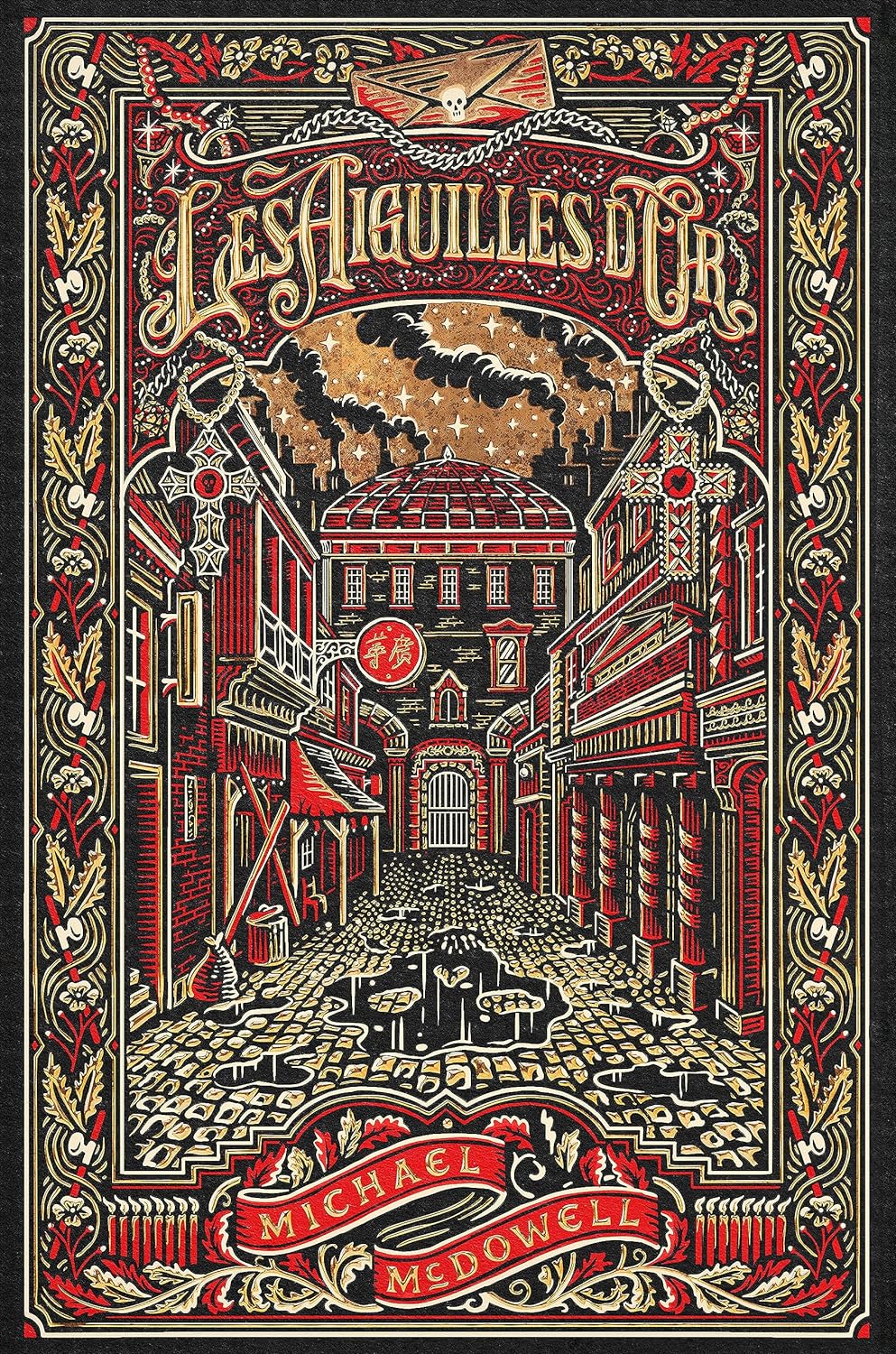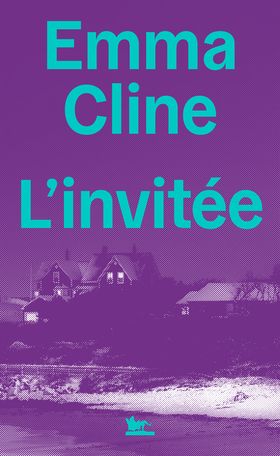1851, Monterey, Californie, Eliza travaille dans la maison close de Mme Parks depuis la mort de son mari. Il a été tué dans un bar et la jeune femme n’a versé aucune larme pour cet homme brutal et violent. Loin de son Michigan natal, Eliza n’avait guère de possibilité pour subvenir à ses besoins. Mrs Parks est d’ailleurs très attentionnée envers ses filles et les protège le plus possible des clients malsains. Eliza passe son temps libre avec son amie Jean, prostituée également mais pour les femmes. Ensemble, elles lisent les aventures du chevalier Dupin imaginées par Edgar Allan Poe. Lorsque des prostituées, d’autres maisons closes, disparaissent et sont ensuite retrouvées mortes, Eliza constate que leur sort n’intéresse pas les autorités. Elle décide donc de mener sa propre enquête et se met à soupçonner tous ses clients.
Avec « Un métier dangereux », Jane Smiley nous offre un roman extrêmement divertissant et très plaisant à lire. Elle croise avec aisance le western et l’enquête policière dans une Amérique d’avant la guerre de Sécession. L’arrière-plan sociétal et historique est parfaitement rendu, nous sommes bien dans le Far-West de la ruée vers l’or qui en laissa plus d’un sur le carreau (c’est le cas du mari d’Eliza). Le roman interroge également la place et l’indépendance des femmes au travers du destin d’Eliza qui n’avait pas choisi son mari et qui va acquérir au fil des pages une certaine indépendance.
Le plaisir, qu’a eu Jane Smiley à écrire ce roman, se ressent dans chacune des pages qui se dévorent avec gourmandise.
Traduction Carine Chichereau