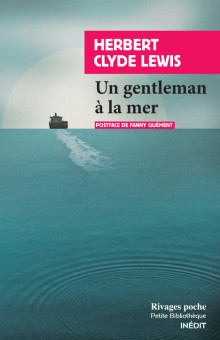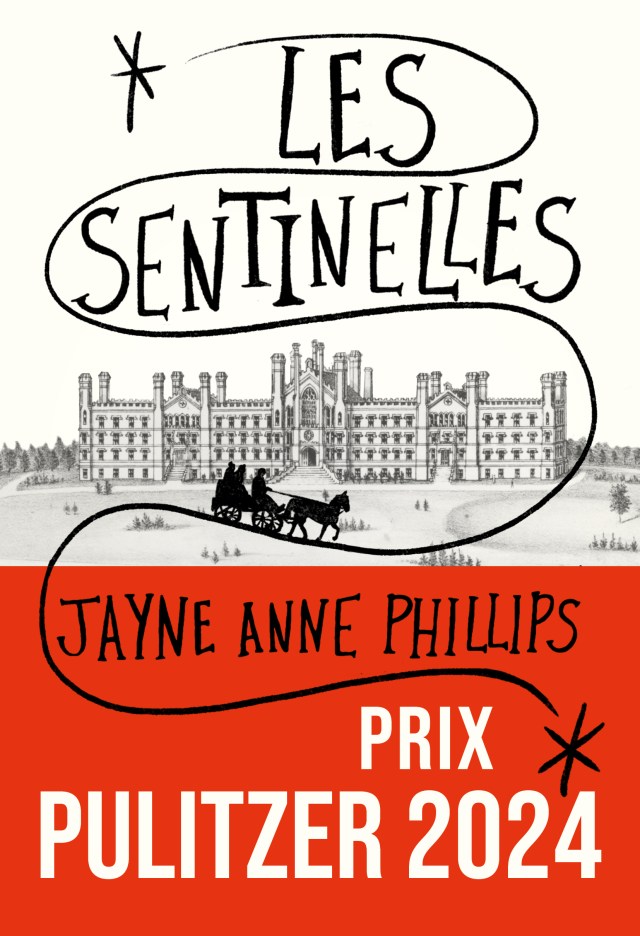
1874, Virginie Occidentale, une carriole s’arrête devant l’asile d’aliénés de Trans-Allegheny. Un homme y dépose une femme, Eliza, épuisée, rendue muette par les épreuves traversées, et sa fille, ConaLee, âgée de 12 ans. Avant de disparaître, l’homme leur demande de ne pas révéler leurs véritables identités et de se faire passer pour une dame de qualité et sa bonne. A l’intérieur de cette institution, le docteur Story mène une méthode thérapeutique innovante appelée « le traitement moral » basée sur l’écoute, les promenades dans le parc et des activités. La guerre de Sécession a ravagé l’état qui se trouve à la frontière entre le nord et le sud. Eliza a vu son mari s’engager, la laissant seule avec un bébé dans une maison isolée. La violence ne l’a pas épargnée.
« Les sentinelles » est un roman choral qui navigue entre 1874 et 1864. Le récit de Jayne Anne Phillips est très documenté, des photos et des documents d’époque émaillent le texte. La guerre de Sécession est au cœur du roman, la scène de la bataille de Wilderness est saisissante. L’autrice y parle des traumatismes de la guerre, qu’ils soient physiques ou mentaux et de leur possible guérison. La construction est habilement menée, même si elle est parfois un peu complexe à suivre. Les personnages féminins, ConaLee, Eliza et leur voisine Dearbha, sont incroyablement émouvantes et résilientes. Il en est de même pour O’Shea, le gardien de nuit de l’asile, devenu amnésique suite à une grave blessure à la tête.
« Les sentinelles » a obtenu le prix Pulitzer en 2024, ce qui est mérité au vu de l’ambition narrative de Jayne Anne Phillips et de l’empathie que l’on ressent pour ses personnages.
Traduction Marc Amfreville