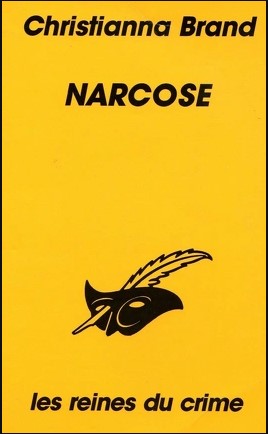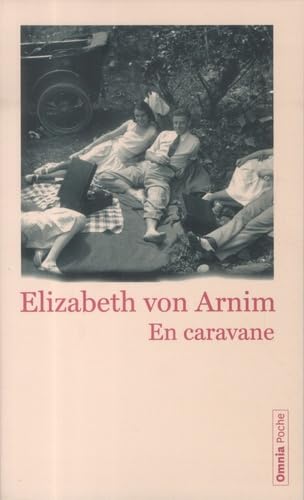Jack Paton a presque 63 ans et il a toujours vécu sur une île de l’archipel de Shetland. Il habite dans la maison où vivaient ses parents. Sa vie est faite de solitude et de routine. Il fait ses courses dans la petite épicerie tenue par une amie d’enfance, occupe un boulot d’homme de ménage dans des bureaux, ce qui lui laisse le temps de se balader et surtout d’écouter de la musique. Car Jack est totalement habité par la musique country, il a une belle collection de disques et il compose également. Parallèlement à la vie de Jack, on découvre également celle de ses parents Kathleen et Sonny. Ce dernier a commencé par travailler sur un bateau de chasse à la baleine dans l’Atlantique sud avant de se fixer sur son île du nord de l’Écosse.
« Les hommes de Shetland » est le récit d’une vie simple, sans prétention. Jack a toujours vécu ainsi, sans ambition particulière. Il sait profiter des paysages sauvages et rudes de son île, il les parcourt chaque jour. Petit à petit, on découvre que Jack a été obligé de rester sur son île et qu’un terrible souvenir l’y attache. J’ai au départ préféré les chapitres consacrés à la vie de ses parents, le premier chapitre est particulièrement réussi et résonnera cruellement avec le dernier. La vie terne de Jack va pourtant s’ouvrir et le personnage se révèle de plus en plus touchant. Se dégagent de sa vie de la douceur et une humanité qui était en sommeil. Le roman est par ailleurs émaillé de textes de chansons écrites par Jack que Malachy Tallack a réellement enregistrées et qui nous accompagnent durant notre lecture.
« Les hommes de Shetland » est un roman au rythme lent à l’image de la vie de son personnage principal, un joli texte touchant.
Traduction Anne Pouzargues