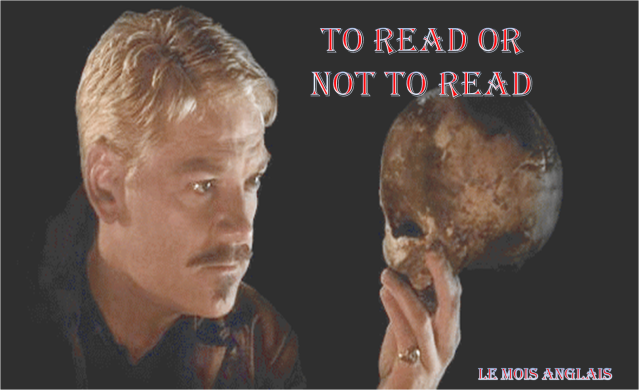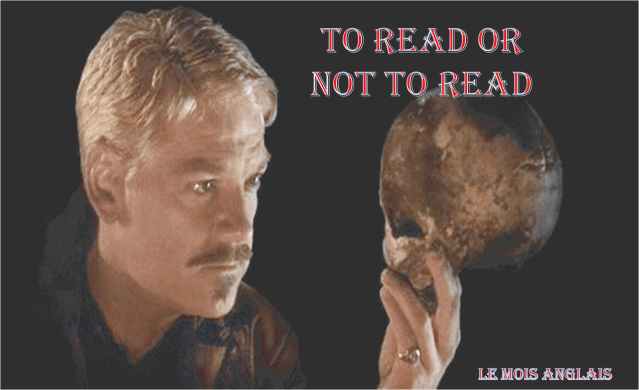Jour 1 (15 décembre):
- Elizabeth Gaskell était présente chez Cryssilda, Lou, Karine:), Eliza, Maijo et ici-même
- Soukee : Meurtre à l’anglaise de Cyril Hare
- Syl : la recette des muffins au fromage
- Somaja : Le secret de l’épouvanteur
- Choupynette : A short story of tractors in ukrainian de Marina Lewycka
- Maggie : L’entourloupe dans l’azimut de Ian Fleming
- Val : The full monty
- Maeve : Tant que brillera le jour d’Agatha Christie
- Perséphone : Cranford et Return to Cranford
- Sharon : Un Noël plein d’espoir d’Anne Perry
- Val : The intruders de Michael Marshall
- Mrs Figg : Un chant de Noël de Charles Dickens
- Lydia : Sourcerie de Terry Pratchett
- Hilde : La pluie avant qu’elle tombe de Jonathan Coe
- Malice : Tout change d’Anthony Browne
Jour 2 (16 décembre):
- Hérisson : L’étang aux libellules de d’Eva Ibbotson
- Eliza nous parle des traditions de Noël
- Enna : Un cadavre dans la bibliothèque d’Agatha Christie
- Malice : Lettres à Alice
- Syl : L’erreur de l’épouvante de Joseph Delaney
- Val’s blog : Frankenstein de Mary Shelley
- Pimpi : Mr Darcy’s obsession de Abigail Reynolds
- Perséphone : Le guide du voyageur galactique de Douglas Adams et elle vous a concocté votre programme de tv de Noël
- Lydia : Eric de T Pratchett
- Mrs Figg : Les mystères de la forêt de Ann Radcliffe
- Catherine : Les carnets d’une bourgeoise déchue de Diane Rauscher-Kennedy
Jour 3 (17 décembre):
- Perséphone : Rachel Ray d’Anthony Trollope
- Cranford toujours chez moi
- Alice : Au secours c’est Noël de Anne Fine
- Yueyin : How to marry a Marquis de Julia Quinn
- Karine:) : Macbeth de William Shakespeare
- Syl nous met l’eau à la bouche avec sa recette de Cornish pasties
- Pascale : This is England de Shane Meadows
- Lou : les épisodes de Noël du Doctor Who
- Lydia : Le dernier restaurant avant la fin du monde de D. Adams
- Somaja : Les hauts de Hurlevent de William Wyler
- Choupynette : Downton Abbey saisons 1 et 2
Jour 4 (18 décembre) :
- Cryssilda : Le tour d’écrou de Henry James
- Perséphone : The big over easy de Jasper Fforde
- Syl : le Pudding de Noël
- Sharon : Marple, Poirot Pyne … et les autres d’Agatha Christie
- Lydia : Cracking contraptions-Wallace & Gromit
- Lou a regardé « Esther Kahn d’Arnaud Desplechin
Jour 5 (19 décembre) :
- Eliza : Plus jamais d’invités ! de Vita Sackville-West
- Maijo : Le Docteur Who et Mme de Pompadour
- Karine:) : Le Docteur Who et Mme de Pompadour
- Malice : Le Noël du chat assassin de Anne Fine
- Val’s blog : Behind the scenes at the museaum de Kate Atkinson
- Emma nous montre ses lithographies de House Guards
- Je vous parle de Virginia Woolf de Michèle Gazier et Bernard Ciccolini
- Mrs Figg : The black butler-manga
- Hérisson : C’est pas du jeu (anglais)
- Catherine : Le trésor de M Brisher de HG Wells
Jour 6 (20 décembre) :
- Cryssilda : La rose et la bague de William Makepeace Thackeray
- Lou : Ivanohé à la rescousse ! de William Makepeace Thackeray
- Eliza a regardé The holiday
- Karine:) : Elizabeth et son jardin allemand de Elizabeth Von Arnim
- Maijo : Les sorcières de l’épouvanteur de Joseph Delaney
- Schlabaya : Autobiographie de Agatha Christie
- Malice : My fair lady de George Cukor
Jour 7 (21 décembre) :
- Yueyin : Cranford d’Elizabeth Gaskell
- Eliza nous donne envie de déménager dans un superbe cottage.
- Lydia : Le songe d’une nuit d’été de William Shakespeare
- Val’s blog : Billy Elliot de Stephen Daldry
- Hydromielle : Le secret de Lady Audley de Mary Elizabeth Braddon
- George nous donne la recette de sa grande-tante écossaise
- Val a regardé The Duchess
- Somaja : Carnet intime d’un vampire timide de Tim Collins
- Dorothée nous parle de thés anglais
- Hérisson : Les 4 de Baker Street-tome 2
Jour 8 (22 décembre) :
- Cryssilda, Lou et moi : En quête de rien de Wilkie Collins
- Arieste : Les aventures de Tom Bombadil de Tolkien
- Jainaxf : The cafe saison 1
- George et une recette de muffins à la poire
- Isil et sa citation du jeudi
Jour 9 (23 décembre) :
- Sharon : Allô, Hercule Poirot d’Agatha Christie
- Zarline nous présente David Attenborough
- Lydia : A ceremony of carols de Benjamin Britten
- Enna nous donne la recette des shortbreads
- Yueyin et sa citation du jeudi so english
- Maijo : The lord of scoundrels de Loretta Chase
- Somaja nous parle de Noël
- Dorothée nous présente ses marque-pages anglais
Jour 10 (24 décembre):
- Lou : Un Noël plein d’espoir d’Anne Perry
- Cryssilda : Le voyageur de Noël de Anne Perry
- Lydia : Un chant de Noël de Charles Dickens
- Jainaxf : La vallée de la peur de Arthur Conan Doyle
- Mélodie : Brunswick Gardens de Anne Perry
Jour 11 (25 décembre) :
- Maggie : Cartes sur table d’Agatha Christie
- Lou : Mon petit doigt m’a dit d’Agatha Christie
- Val : Le Noël d’Hercule Poirot d’Agatha Christie
- Ici même : Le Noël d’Hercule Poirot d’Agatha Christie
- Lydia : Les travaux d’Hercule d’Agatha Christie
- Enna : ABC contre Poirot d’Agatha Christie
- Perséphone : From time to time
- Val’s blog : Loin de vous ce printemps de Mary Westmacott
- Mylène : Une étude en rouge de Arthur Conan Doyle
- Les p’tits cartons d’Emma : La troisième fille d’Agatha Christie
- Malice nous parle de Noël chez Lewis Carrol
Jour 12 (26 décembre):
- Cryssilda : L’homme au complet marron d’Agatha Christie
- Perséphone : Just Henry
- Karine:) : Les épisodes de Noël du Docteur Who
- Sharon : En quête de rien de W. Wilkie Collins
- Somaja : Liberté, égalité, chocolat de Alex Shearer
- Malice : A l’aube du XXème siècle, journal de Flora Bonnington
- Catherine : Sentinelles (La Zone, tome 1) de Stalner
Jour 13 (27 décembre) :
- Lou : La révélation de Noël de Anne Perry
- Ici même : une nouvelle adaptation de Jane Eyre par Cary Fukunaga
- Perséphone : Elephants can remember d’Agatha Chrsitie
- Karine:) : The last letter from your lover de Jojo Moyes
- Céline : Downton Abbey saison 2
- Mylène poursuit son enquête en savourant un bon thé
- Malice : Nord et Sud de Elizabeth Gaskell
Jour 14 (28 décembre) :
- Choupynette : Acceptable loss de Anne Perry
- Perséphone : Downton Abbey Christmas special
- Pimpi : The mystery of the blue train d’Agatha Christie
- Jainaxf : The Doctor Who , the witch and the wardrobe
- Mrs Figg: Du sang sur la soir de Anne Perry
- Hérisson : La grande école du mal et de la ruse de Mark Walden
Jour 15 (29 décembre) :
- Isil : la citation du jeudi tirée de « Les tours de Barchester » de Anthony Trollope
- Céline : A room with a view de EM Forster
- Lou : Rebecca de Daphné du Maurier
- Ici même : La maison sur le rivage de Daphné du Maurier
- Karine:) : The Duke and I (Daphné et le Duc) – Les Bridgerton 1 de Julia Quinn
- Georges : L’affaire Prothéroe de Agatha Christie
- Somaja : Joyeuses funérailles de Frank Oz
- Hérisson : Bartimeùs : l’anneau de Salomon de Jonathan Stroud
Jour 16 (30 décembre) :
- Choupynette : ABC contre Poirot d’Agatha Christie
- Maggie : Créatures célestes de Peter Jackson
- Perséphone : A christmas carol de Charles Dickens
- Soukee : Frogs and owls de Michel Boucher
- Malice nous parle de la famille Terry (théâtre anglais)
Jour 17 (31 décembre) :
- Somaja : Christmas time in London
- Perséphone : January BBC programme
- Karine:) : The nature of monsters de Clare Clark
- Sharon : How to steal a dragon’s sword de Cressida Cowell
Jour 18 (1er janvier) : BONNE ANNÉE !!!
- Lydia nous parle des Monty Pythons
- Eliza : Le mystère d’Edwin Drood de Charles Dickens
- Hilde nous souhaite une bonne année anglaise
Jour 19 (2 janvier) :
- Cryssilda, Lou et ici-même : Le mystère d’Edwin Drood de Charles Dickens
- Karine:) : Oliver Twist de Charles Dickens
- Perséphone : Great expectations-BBC
- Maeve : La bonté, mode d’emploi de Nick Hornby
- Somaja : Becoming Jane de Julian Jarrold
- Touloulou : Agatha Raisin and kissing Christmas goodbye de MC Beaton
- Les p’tits cartons d’Emma nous parle de Londres
- Eliza : Un Noël plein d’espoir de Anne Perry
Jour 20 (3 janvier) :
- George : Toute passion abolie de Vita Sackville-West
- Perséphone : Sally Lockhart mysterie-The ruby in the smoke-PBS 2006
- Malice nous parle du grand designer William Morris
- Choupynette : ABC contre Poirot-adaptation ITV
Jour 21 (4 janvier) :
- Enna : From Hell de Alan Moore et Eddie Campbell
- Touloulou : Olivia Joule ou l’imagination hyperactive de Helen Fielding
- Ici même : Drood de Dan Simmons
- Karine:) : Doctor Who-Kim Newman
- Cryssilda : Rebecca de Daphné du Maurier
- Perséphone : Sally Lockhart mysteries-Shadow in the North
- Mrs Figg : Autumn de Philippe Delerm
- Val : Joue la comme Beckham de Gurinder Chada
- Somaja : L’affaire Jennifer Jones de Anne Cassidy
Jour 22 (5 janvier) :
- Karine:) : L’affaire Protheroe d’Agatha Christie
- Soukee : Seule contre la loi de Wilkie Collins
- Syl : Le scandale Modigliani de Ken Follett
- Perséphone : Crocodile on the sandbank de Elizabeth Peters
- Yueyin et sa citation austinienne du jeudi
- Jainaxf : The unladylike adventures of Kat Stephenson de Stephanie Burgis
- Eden : Mort d’une garde de Colin Dexter
- Lou : The woman in black de Susan Hill
- Cryssilda et sa citation du jeudi spécial chouchou
- Hérisson : Time riders 1 de Alex Scarrow
- Val nous parle de l’expo Beauté, morale et volupté dans l’Angleterre d’Oscar Wilde au musée d’Orsay
- Lilsa : La maison du péril de Agatha Christie
Jour 23 (6 janvier) :
- Karine:) : From Notting Hill with love … actually de Ali McNamara
- Enna : The house at Riverton de Kate Morton
- Lilsa : La maison du péril d’Agatha Christie
- Syl : Le sacrifice de l’épouvanteur VI de Joseph Delaney
- Soukee : Boys don’t cry de Malorie Blackman
- Arieste : A l’aube du XXème siècle : le journal de Flora Bonnington
- Lydia : Le vent des saules de Kenneth Grahame
- Yueyin : Oscar Wilde et le meurtre aux chandelles de Gyles Brandeth
- Eden : L’assassinat du roi Arthur de JB Livingstone
- Val : Sourires de loup de Zadie Smith
- Somaja : Peter Pan de Régis Loisel
Jour 24 (7 janvier) :
- Maeve : Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates de Mary Ann Schaffer et Annie Barrows
- Hydromiel : Les aventures d’Oliver Twist
- Ici même : Mari et femme de Wilkie Collins
- Lystig : Royaume désuni de James Lovegrove
Jour 25 (8 janvier) :
- Lou : L’hôtel hanté de Wilkie Collins
- Cryssilda : Profondeurs galcées de Wilkie Collins
- Sahron : Little Manfred de Michael Morpurgo
- Soukee : Mort sur le Nil d’Agatha Christie
- Pascale : Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates de Mary Ann Schaffer et Annie Barrows
- Karine:) : Angel d’Elizabeth Taylor
- Lydia : La vallée de la peur de Arthur Conan Doyle
- Somaja : Le baiser du serpent de Philippe Rousselot
Jour 26 (9 janvier) :
- Karine:) : Doctor Who saison2x3-Tooth and claws
- Syl : Le cauchemar de l’épouvanteur-VII de Joseph Delaney
- Malice nous parle de Sir Arthur Conan Doyle
- Val : L’auteur, l’auteur de David Lodge
- Mélodie : No name de Wilkie Collins
Jour 27 (10 janvier) :
- Enna : The Queen and I de Sue Townsend
- Syl : Le crime du golf de Agatha Christie
- Perséphone : Soulless de Gail Carringer
- Val : A year in the merde de Stephen Clarke
- Somaja : Les confessions de Victoria Plum de Anne Fine
- Malice : Demeures de l’esprit de Renaud Camus
- Ici même : La vie très privée de Mr Sim de Jonathan Coe
Jour 28 (11 janvier) :
- Karine:) : H2G2-The restaurant at the end of the universe de Douglas Adams
- Céline : Jane Eyre de Robert Stevenson
- Pimpi : Jane Austen made me do it de Laurel Ann Nattress
- Jainaxf : The song of the quarkbeast de Jasper Fforde
- Val : Variations cinématographiques autour de Roméo et Juliette
Jour 29 (12 janvier) :
- Cryssilda : Lady Susan de Jane Austen
- Lou : Persuasion de Jane Austen
- Enna : Tourte au poulet et aux poireaux
- Ici-même : Raining stones de Ken Loach
- Isil et sa citation du jeudi Trollopienne
- Val : La mort n’est pas une fin de Agatha Christie
- Lilas : Le crime d’Halloween de Agatha Christie
- Karine:) : Persuading Annie de Melissa Nathan
- Maggie : Le bras de la vengeance de Thomas de Quincey
- Sabbio : Le meurtre de Roger Ackroyd de Agatha Christie
- George : Beauté, morale et volupté au musée d’Orsay
- Mélodie : Orgueil et préjugé de Jane Austen
- Eliza : Emma BBC 2009
- Yueyin : Raison et sentiment de Jane Austen
- Somaja : Mensonges, mensonges de Stephen Fry
Jour 30 (13 janvier) :
- Touloulou : Orgueil et préjugé de Jane Austen
- Sabbio : La malédiction Shakespeare de Anne Ferrier et Régine Joséphine
- Karine:) : Noughts and crosses de Malorie Blackman
- Schlabaya : Nouvelles de Londres de Doris Lessing
- Les ptits cartons d’Emma : Emma de Jane Austen
Jour 31 (14 janvier) :
- Enna : Hand in glove de Robert Goddard
- Touloulou nous propose ze playlist du mois anglais
- Eliza nous parle de la mode edwardienne dans « Downton Abbey »
- Cryssilda : Mrs Muir et le fantôme de R.A. Dick
- Jainaxf : Sherlock saison 2
- Karine:) : Doctor Who-saison 6
- Choupynette : Affinity de Sarah Waters
- Mrs Figg : Downton Abbey
- Somaja : Sur la mauvaise pente de Graham Hurley
Jour 32 (15 janvier) :
- Enna : Le chat et les pigeons de Agatha Christie
- Touloulou : The Pythons, an autobiography by the Pythons
- George : Le mois anglais, c’est fini ! It’s so sad.
- Lou : Whitechapel-saison 1
- Marie : Récapitulatif de son mois Anglais
- Karine:) : The viscount who loved me de Julia Quinn et son bilan du mois Anglais
- Lydia : Les tribulations d’un mage en Aurient de Terry Pratchett
- Sabbio : Les oiseaux de Daphné du Maurier
- Val : Cheval de guerre de Michael Morpugo
- Catherine : Downton Abbey saison 1
- Lystig : Le meurtre de Roger Ackroyd de Agatha Christie
Des bilans du 16 janvier : Syl, Jainaxf, Perséphone et un dernier billet sur Downton Abbey chez Yueyin qui tire également son bilan. Et le dernier des derniers articles chez Eliza : Tess D’urberville de Thomas Hardy.