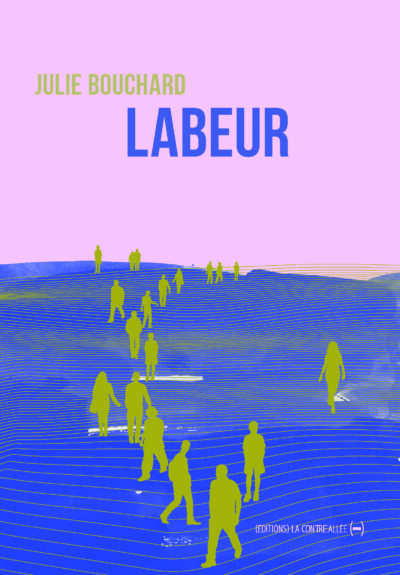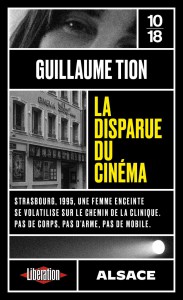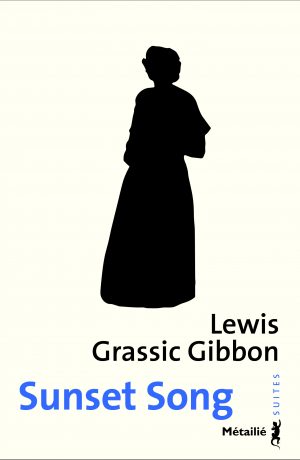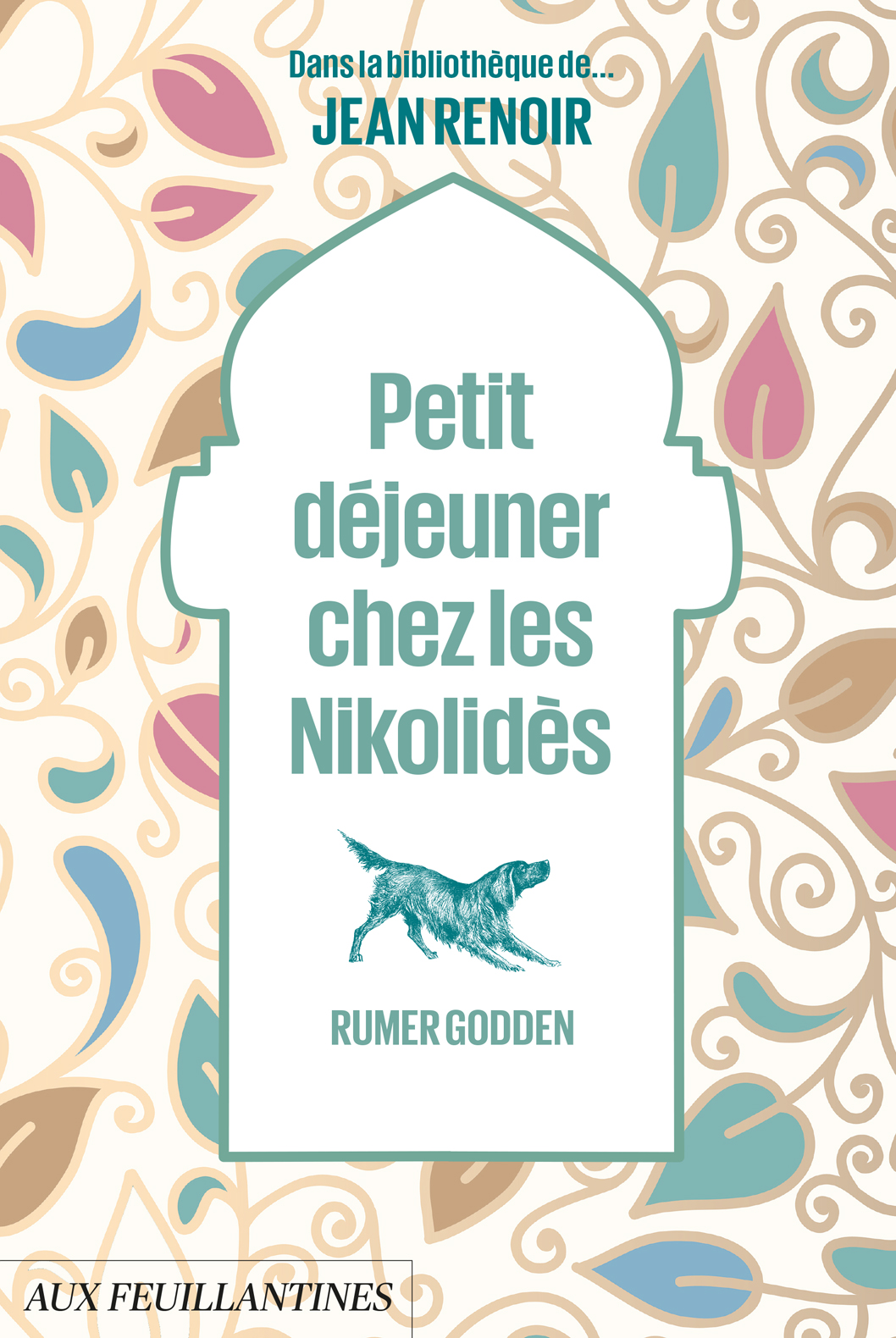Sept livres m’ont accompagnée durant le mois d’avril :
-« Le jeu de l’assassin » qui m’a permis de découvrir une autre autrice de l’âge du whodunit : Ngaio Marsh ;
-« Cinq contes » qui regroupent plusieurs histoires de la grande Posy Simmonds écrites entre 1987 et 2004 ;
-« Repentirs » qui est le deuxième roman de la très talentueuse Chloé Ashby ;
-« Labeur » de Julie Bouchard qui est un roman choral entrecroisant la vie de personnages ordinaires ;
-« Les sœurs Field » qui m’a enfin permis de découvrir la plume de la romancière anglaise Dorothy Whipple ;
-« Germaine Cellier, l’audace d’une parfumeuse » est une bande-dessinée retraçant la vie et la carrière de la très moderne Germaine Cellier dont certaines créations existent toujours ;
-« La paix des ruches » d’Alice Rivaz qui raconte les déconvenues d’une femme mariée et ses réflexions quant à la condition des femmes.
Côté cinéma, j’ai vu cinq films ce mois-ci dont voici mon préféré :

Sur une route forestière, une voiture roule de plus en plus vite. A bord du véhicule, une dispute éclate entre le chauffeur, Michael, et sa mère. Un terrible accident survient : Caroline, la petite amie de Michael qui était à l’arrière, est défigurée, sa mère décède. Michael, que l’on retrouve quelques années plus tard, portera le poids de cet accident toute sa vie. Il s’occupe de la ferme familiale, de ses moutons et de son acariâtre père. Caroline a épousé un autre berger et ils ont eu un fils Jack. La haine entre les deux familles est féroce et elle va s’aggraver après le vol de deux béliers du troupeau de Michael.
le premier long-métrage de Christopher Andrews est sombre, étouffant et aucune lueur d’espoir n’apparaitra pendant 1h46. La rude lande irlandaise est le lieu d’un règlement de compte, d’une vendetta qui se révélera sanglante. Michael est un personnage de tragédie qui semble embourbé dans la culpabilité. Christopher Abbott interprète cet homme en apparence calme mais dont la noirceur du regard inquiète. Sa fragilité fait de lui une cible et notamment pour Jack, jeune homme désœuvré, écorché vif, ce qui colle parfaitement au talent de Barry Keoghan. Des fils, des pères, ce sont autant de visions d’une masculinité toxique, brutale et destructrice. La construction du film participe pleinement à son intérêt puisque l’intrigue nous est montrée du point de vue de la victime puis du criminel. « Le clan des bêtes » est un film puissant, un thriller tendu et sombre.
Et sinon :
- « Vermiglio ou la mariée des montagnes » de Maura Delpero : Hiver 1944, le village de Vermiglio est protégé de la guerre grâce aux hautes montagnes du Trentin. Vivent là trois sœurs aux aspirations fort différentes. Lucia, l’aînée, fait les yeux doux à Pietro, un sicilien venu se cacher dans le village. Ada, la pieuse, s’invente les pires pénitences pour expier ses fautes. Flavia, la favorite du père instituteur, aura la possibilité de faire des études. Durant quatre saisons le destin des trois sœurs va se sceller. Le drame va frapper la famille et souligner la difficulté de la condition féminine. Le film de Maura Delpero m’a beaucoup fait penser aux romans de Maria Messina qui parlaient déjà des empêchements des femmes à s’épanouir. La modernité semble bien loin de Vermiglio figé dans les traditions. La beauté du film, outre les paysages, tient dans la profondeur psychologique de chaque personnage. Tragique, intense, « Vermiglio ou la mariée des montagnes » est la très belle chronique des désillusions des trois sœurs.
- « Deux sœurs » de Mike Leigh : Pansy est perpétuellement en colère contre la terre entière : la caissière du supermarché, sa dentiste, son mari, son fils, … Elle grogne, elle hurle sur tous ceux qui ont le malheur de croiser sa route. Sa sœur est son exact opposé : sociable, enjouée et vivant en harmonie avec ses deux grandes filles. Pansy est un personnage comme on en voit peu au cinéma, son caractère empêche l’empathie même si sa colère est le symptôme d’un profond mal-être, de névroses multiples. On plaint son entourage qui doit subir une personnalité aussi difficile. Marianne Jean-Baptiste est parfaite dans le rôle de Pansy et Mike Leigh est toujours aussi juste lorsqu’il filme des drames domestiques. Malgré ces qualités, je suis restée sur ma faim.
- « Bergers » de Sophie Deraspe : Mathyas a tout quitté du jour au lendemain pour venir s’installer à Arles. Malheureux dans son métier de publicitaire, le jeune québécois a décidé de devenir berger pour redonner du sens à sa vie. Il n’y connait rien, n’a vécu qu’en ville mais son enthousiasme et sa détermination séduisent certains propriétaires de troupeaux. Après un apprentissage à la dure et des déconvenues, il trouvera un couple prêt à lui laisser emmener leurs moutons en transhumance. Il partira dans les montagnes avec Elise, une fonctionnaire en quête également d’authenticité. Sophie Deraspe nous offre un joli film plein de fraîcheur mais ne masquant pas la dureté du métier de berger. Mathyas est un candide, poète et philosophe, qui se révèle très attachant. L’hostilité, la brutalité et l’âpreté de la vie de berger (la montagne, les loups, la misère sexuelle) sont parfaitement montrées. Tous les personnages croisés dans ce film sont touchants et j’ai beaucoup apprécié de les suivre.
- « Toxic » de Saule Bliuvaite : Marija et Kristina ont 13 ans et vivent en Lituanie dans un environnement désolé et décrépit. L’ennui, la misère sociale les amènent à prendre des drogues, de l’alcool. Elles sont bagarreuses, hargneuses et rêvent de quitter leur ville. Pour ce faire, elles s’inscrivent dans une soi-disant école de mannequins où leurs mensurations sont sans cesse vérifiées. « Toxic » est le premier film de Saule Bliuvaite et son atmosphère est frappante. Le rythme est très lent, l’histoire des deux filles se développe par bribes, par scènes de leur quotidien. Leur environnement est absolument glauque. Et les jeunes filles sont prêtes à tout pour s’en sortir (l’une d’elle avale des œufs de ver solitaire pour ne pas grossir). Un profond sentiment d’abandon et de désillusion habite ce film et nous saisit.