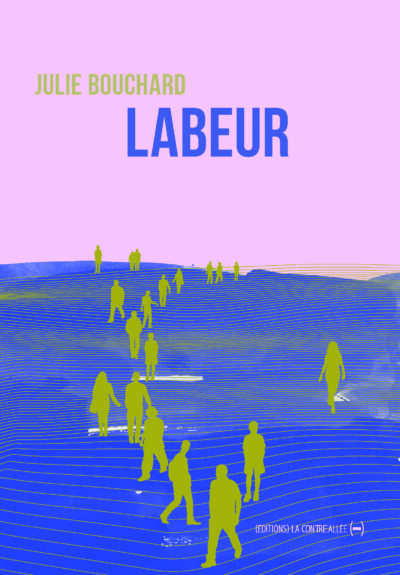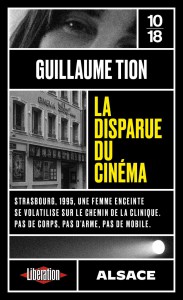Huit livres m’ont accompagnée durant le mois de mai et un certain nombre d’entre eux sentent bon le retour du mois anglais organisé chaque année avec ma chère Lou :
-« Trompeuse gentillesse » où Angelica Garnett revient sur son enfance au milieu du groupe de Bloomsbury créé autour de sa mère Vanessa Bell et de sa tante Virginia Woolf ;
-« En caravane » où Elizabeth Von Arnim n’a jamais été aussi drôle et ironique ;
-« Une bonne tasse de thé et autres textes » de George Orwell composé de onze articles célébrant les saveurs de la vie et la liberté des peuples.
J’ai également eu le plaisir de découvrir le premier roman de Sébastien Dulude qui parle si bien de l’enfance, le travail du dessinateur Will McPhail sur la difficulté de communiquer avec autrui, celui d’Aude Picault dans son « Moi, je » une autofiction pleine d’humour et celui de Cathie Barreau avec cette poignante et sensuelle « Lettre de Natalia Gontcharova à Alexandre Pouchkine ». J’ai également retrouvé une autrice que j’affectionne tout particulièrement : Maria Messina avec « Les pauses » de la vie », une nouvelle fois publiée aux éditions Cambourakis.
Le mois de mai a également été l’occasion de voir sept films dont voici mes deux préférés :
Hiver 1985 à New Ross en Irlande, Bill Furlong est le propriétaire du dépôt de bois et de charbon. Il travaille dur et continue à faire lui-même les livraisons. Il s’occupe d’ailleurs de celles du couvent. C’est là qu’il assiste à une scène déchirante, une adolescente est confiée de force par ses parents aux religieuses. Cela le renvoie à sa propre histoire puisque sa mère l’a eu très jeune mais a été prise en charge par la riche propriétaire terrienne chez qui elle travaillait. Que serait devenu Bill si sa mère avait été placée chez les religieuses ?
En 2002, Peter Mullan avait réalisé « The Magdalene sisters » sur la maltraitance, l’exploitation des filles-mères dans les couvents de la Madeleine. Le film de Tim Mielants reprend ce thème en adaptant le formidable roman de Claire Keegan « Ce genre de petites choses ». Peter Mullan avait réalisé un film choc montrant les violences subies par les jeunes filles. Ici, le propos est suggéré puisqu’il est montré par les yeux de Bill et non ceux des jeunes filles enfermées. Ce point de vue était l’atout majeur du roman et il l’est encore ici d’autant plus que Bill est interprété à l’écran par le formidable Cillian Murphy, poignant et tout en retenue. L’acteur incarne parfaitement le dilemme qui habite Bill : son empathie profonde pour les jeunes filles du couvent rentre en conflit avec ses responsabilités envers sa famille car les religieuses ont beaucoup de pouvoir à New Ross. La mère supérieure est d’ailleurs incarnée par Emily Watson, terrifiante et menaçante.
Le roman de Claire Keegan était bouleversant et remarquable. Le film de Tim Mielants l’est tout autant avec un impeccable Cillian Murphy.
Alertée par l’état de santé de son père, Cécile rentre dans le Loir et Cher en laissant son compagnon finaliser l’ouverture de son restaurant gastronomique. Elle fut lauréate de Top chef et voit ses rêves se concrétiser. Son amour de la cuisine, elle le doit à son père qui tient depuis toujours un relais routier avec sa femme et refuse d’arrêter son activité. Le retour n’est pas simple pour celle qui a si bien réussi, son père lui reproche certains propos méprisants tenus l’émission (il a tout noté dans un carnet). Cécile s’angoisse également pour l’ouverture de son restaurant car elle cherche toujours son plat signature, celui qui fera la différence et assoira sa réputation. Au milieu de ces questionnements, réapparait Raphaël, un ami d’enfance. Ils se sont quittés des années auparavant sur un amour inabouti. Leurs retrouvailles ne les laissent pas indifférents.
Certains films ont un charme irrésistible, presque magique. Le court-métrage d’Amélie Bonnin, également nommé « Partir un jour » et où les rôles étaient inversés, était déjà très réussi et très émouvant. La réalisatrice reprend son idée de départ en la développant. L’histoire d’amour des deux héros, restée en suspens, est toujours le cœur du film. Mais s’ajoutent d’autres thématiques : le rapport entre enfant et parents vieillissant, le choix d’avoir ou non des enfants. Cette comédie allie avec brio les moments joyeux, insouciants à une tonalité douce-amer et nostalgique. Amélie Bonnin a choisi de réunir à nouveau Juliette Armanet et Bastien Bouillon, un duo qui fonctionne à merveille, qui pétille à chaque scène. Elle a également rappeler François Rollin, dans le rôle du père bougon et pudique, et elle a offert à la formidable Dominique Blanc celui de son épouse. Les parties chantées rehaussent les sentiments, les situations.
L’alchimie entre les acteurs, l’équilibre entre l’insouciance des souvenirs d’enfance et les questionnements adultes, la fantaisie des passages chantés, tout concoure à faire de « Partir un jour » un film marquant, infiniment séduisant et touché par la grâce.
Et sinon :
- « Jeunes mères » de Jean-Pierre et Luc Dardenne : Le dernier film des frères Dardenne nous permet de suivre quatre jeunes filles qui viennent d’accoucher et sont accueillies dans une structure nommée « Maison maternelle » où on les aide à s’occuper de leurs bébés mais aussi à devenir responsables. Elles sont entourées par des puéricultrices, des psychologues qui accompagnent leur choix : garder l’enfant ou le placer. Contrairement à leurs films précédents, « Jeunes mères » ne se concentre pas que sur un seul personnage mais est fait de fragments nous permettant de faire connaissance avec chacune. Le talent des Dardenne est là dans leur capacité à dessiner un portrait de chacune, d’expliciter la situation de chacune (misère sociale et affective) rapidement. L’éclatement de la narration apporte de la vivacité mais on perd un peu de la tension, de l’intensité de leurs meilleurs films. Mais ces quatre jeunes filles sont infiniment touchantes et malgré les nombreuses embûches, les réalisateurs leur offrent une vraie lueur d’espoir.
- « Marco, l’énigme d’une vie » de Altor Arregi et Jon Garano : Enric Marco chercher à obtenir un certificat officiel de sa présence au camp de Flossenbürg. Il dit ne pas se souvenir de son matricule, ni du faux nom qu’il aurait donné aux nazis. Grâce à son charisme, il se fait reconnaître comme survivant des camps dans son pays, l’Espagne, qui avait occulté cette période de l’Histoire durant la dictature. Eric devient même président de l’Amicale de Mauthausen, il raconte son histoire dans les écoles, à la télévision. Pourtant en 2005, un historien prouve qu’Eric Marco n’est jamais allé à Flossenbürg, il a même fait partie des volontaires pour aller travailler en Allemagne. L’histoire d’Eric Marco est hallucinante et fascinante. Son besoin d’être dans la lumière a alimenté sa mythomanie pendant des années. Son charisme naturel a fait le reste. Ce qui est incroyable, c’est qu’après 2005 Enric n’a pas cessé de passer à la télévision, de donner des interviews pour raconter sa vie et continuer à se faire passer pour une victime. Une scène invraisemblable m’a marquée : Enric Marco intervient dans un festival littéraire où est invité Javier Cerca qui a écrit sur lui et il se permet de traiter l’écrivain de menteur ! Un personnage hors-norme qui semble effectivement tout droit sorti d’un roman.
- « Les musiciens » de Gregory Magne : Un stradivarius, disparu puis retrouvé, est mis en vente. Voilà de quoi réjouir Astrid qui le cherchait afin d’accomplir le rêve de son défunt père : organiser un concert unique avec quatre stradivarius sur une partition inédite. Après les instruments, la jeune femme doit réunir les interprètes de ce quatuor. C’est là que les choses se corsent et les egos des musiciens provoquent des étincelles. Astrid décide alors de faire appel au compositeur de la partition pour l’aider. « Les musiciens » est un film au charme délicat comme le quatuor de Grégoire Hetzel qui est répété par les musiciens. Le but d’un quatuor à cordes est de réussir à s’harmoniser, à s’écouter pour former un tout et non une somme de personnalités. Gregory Magne montre parfaitement ce travail compliqué pour ses musiciens solistes. Il nous offre de très beaux moments de musique, d’improvisations qui lient peu à peu les artistes. Les quatre interprètes sont de véritablesmusiciens ce qui apporte un vrai supplément d’âme au film. Frédéric Pierrot, qui incarne le compositeur, est comme toujours parfait.
- « Les règles de l’art » de Dominique Baumard : Dans la nuit du 20 mai 2010, cinq tableaux se volatilisent du musée d’Art moderne de Paris : un Picasso, un Matisse, un Modigliani, un Léger et un Braque. Le système d’alarme défaillant a profité à un habile voleur. Il va les fourguer à son receleur habituel, roi de la tchatche et des petites arnaques. Ce dernier ira chercher l’aide d’un expert de Drouot spécialisé… en horlogerie ! Dominique Baumard nous offre une très sympathique comédie autour de ce véritable casse. Les trois voleurs sont des pieds nickelés, dépassés totalement par l’ampleur de leur butin. La reconstitution des faits passe par la fantaisie et l’humour. Et l’atout majeur du film est son casting : Steve Tientcheu en monte-en-l’air talentueux, Sofiane Zermani en embobineur charismatique et Melvil Poupaud en candide inconscient. Ce qui est également très beau, c’est que ces trois-là vont succomber à la beauté des tableaux volés et en être fascinée.
- « Les indomptés » de Daniel Minahau : A son retour de la guerre de Corée, Lee décide de s’installer en Californie avec sa femme Muriel. Une maison neuve, un nouveau quartier, le couple prend un nouveau départ. Cet équilibre se modifie avec le retour de Julius, le frère de Lee, qui gagne sa vie en jouant. Sa venue, puis son départ, vont mettre à jour l’insatisfaction de Muriel. Le film montre une génération perdue qui cherche désespérément à s’évader pour Muriel et Julius ou à retrouver une forme de normalité pour Lee. Muriel et Julius se ressemblent, ils cachent leurs véritables désirs mais cela ne pourra pas durer. Daisy Edgar-Jones, Jacob Elordi et Will Poulter composent le casting glamour et flamboyant de ce film.