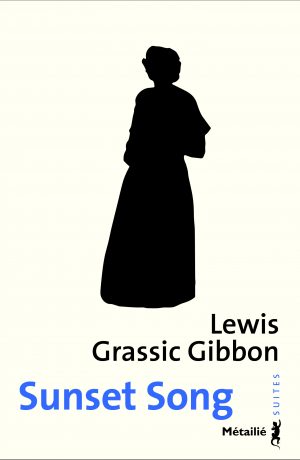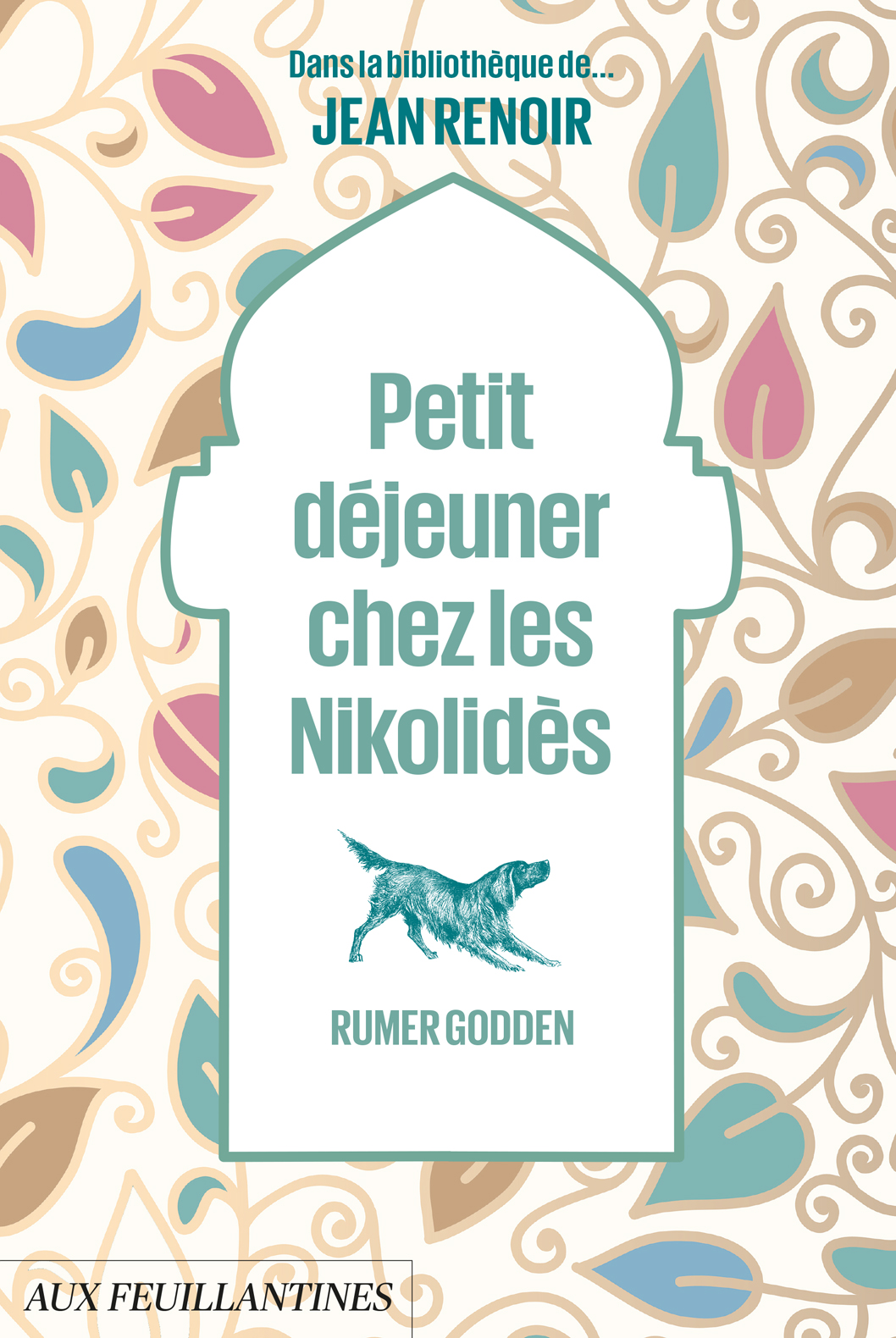Voici mon bilan de lecture du mois de mars :
-« Trois ans sur un banc » qui m’a permis de retrouver Jean-François Beauchemin dont j’apprécie énormément le travail ;
-« Sunset song » de Lewis Grassic Gibbon qui végétait dans ma pal depuis longtemps et qui est un classique de la littérature écossaise ;
-« Le mur invisible » de Marlen Haushofer qui prenait également la poussière depuis longtemps et que j’ai eu le plaisir de découvrir enfin ;
-« Dans la maison de mon père » où Joseph O’Connor nous entraine dans un thriller historique palpitant ;
-« Coucous Bouzon » d’Anouk Ricard ou une vision totalement barrée (et très drôle) du monde du travail ;
-« Irina Nikolaevna » de Paola Capriolo qui nous entraîne à San Remo à la fin du 19ème siècle avec délicatesse et élégance ;
-« Le grand tout » qui montre à nouveau le grand talent de conteur d’Olivier Mak-Bouchard ;
-« Minuit passé de Gaëlle Geniller aux dessins splendides et qui nous plonge dans un conte fantastique ;
-« La disparue du cinéma » de Guillaume Tion, les éditions 10/18 complètent leur collection de True crime aux USA avec des titres consacrés aux faits divers français.
Du côté du cinéma, j’ai pu voir sept films dont voici mes préférés du mois :

En ce mois de mai 1968, rue de Grenelle se cache une drôle de famille. Père-Grand y a son cabinet médical. Mère-Grand y travaille sur ses essais basés sur des entretiens réalisés uniquement dans son Ami 6. Grand-Oncle y tient des discours sur la linguistique incompréhensibles pour les autres et Petit Oncle s’y exprime par la peinture. Tout en haut de l’appartement est installée l’arrière-grand-mère, dite l’Arrière-Pays, qui revit son passé ukrainien au son des grands compositeurs russes. Un petit garçon, fils du troisième rejeton de Mère-Grand et Père-Grand, est le témoin de cette étonnante vie de famille qui s’épanouit à l’abri du tumulte du monde dans son cocon.
Je n’ai pas lu le livre de Christophe Boltanski, dont est tiré ce film, et je le regrette tant sa famille fantasque est attachante. Rien n’est ordinaire chez eux (les sardines à la chantilly est un de leur plat préféré notamment au petit-déjeuner !), ils réinventent sans cesse le quotidien et mettent l’imagination au cœur de leurs vies. La famille est incroyablement unie, presque inséparable, chaque membre semble ne pas pouvoir s’éloigner très longtemps de la rue de Grenelle. Ce lien si fort vient certainement de l’histoire des Boltanski, de la fameuse cache où Père-Grand a trouvé refuge durant la seconde guerre mondiale, pour échapper aux nazis. La légèreté, l’humour se teinte de mélancolie et de douleur. Mais la famille vit au présent, hors de question de s’appesantir sur le passé. La mise en scène de Lionel Baier rend hommage à cette famille grâce à sa fantaisie et son inventivité. Les acteurs sont également formidables : Dominique Reymond, Michel Blanc dans son dernier rôle, William Lebghill, Liliane Rovère, Aurélien Gabrielli et le jeune Ethan Chimienti. « La cache » est une merveilleuse bulle dédiée à l’imaginaire et à une famille anticonformiste.

David retrouve son cousin Benji pour un voyage en Pologne sur les traces de leur grand-mère récemment disparue. Ils rejoignent un groupe d’autres touristes qui vont visiter Varsovie, Lublin, le camp de concentration de Majdanek.
Jesse Eisenberg a trouvé l’idée de son film grâce à une petite annonce incongrue « Visite Holocauste, déjeuner compris ». Son film oscille sans cesse entre le rire et les larmes, un peu comme ce que peut provoquer la fameuse petite annonce. Il réussit à doser parfaitement les deux, évitant les écueils et le pathos trop appuyé. Les deux cousins forment un duo improbable. Benji, interprété par le formidable Kieran Culkin déjà bluffant dans « Succession », est aussi insupportable qu’il est charmant et attendrissant. Le double sens du titre symbolise bien ces deux facettes de sa personnalité. David, interprété par Jesse Eisenberg, est à l’opposé : discret, coincé, asocial mais ayant une vie plus équilibrée que celle de son cousin. Par petites touches, le réalisateur interroge notre manière de nous souvenir, la façon dont nous commémorons les évènements de la seconde guerre mondiale. Benji trouve indécent de voyager en 1ère classe pour se rendre à Majdanek mais il prend des poses burlesques devant le monument célébrant l’insurrection de Varsovie.
De la nuance, de la profondeur, de la tendresse et de l’humour sont les ingrédients de cet excellent film.

Juste avant les JO de Pékin en 2008, Lang rentre chez lui aux portes du désert de Gobi après avoir été incarcéré pour meurtre. Sa ville est désertique, laissée à l’abandon et envahie par des chiens sauvages. Lang, taiseux et harcelé par l’oncle de celui qu’il aurait tué, va trouver du travail dans une entreprise qui attrape les chiens. Mais il n’est pas très motivé et finit par adopter le plus sauvage d’entre eux : un lévrier noir qui aurait la rage.
Guan Hu nous propose un western aux allures de fin du monde. La région, les décors (comme ce parc d’attraction-zoo abandonné) sont formidablement bien exploités et ils donnent une tonalite singulière au film. Face au clinquant des JO, on constate ici la misère social, économique et l’abandon totale de cette ville par les autorités. Certaines scènes impriment durablement la rétine comme celle qui ouvre le film et nous montre une horde de chiens cavalant dans le désert. Ce qui fait également la beauté de ce film est la force de la relation qui unit Lang et son chien. Le trentenaire solitaire est particulièrement impassible et ne semble toucher que par cet animal qui le comprend sans mot.
« Black dog » est un film surprenant, peut-être un peu long mais superbement mis en scène.
Et sinon :
- « The insider » de Steven Soderbergh : Rien ne va plus dans les services secrets de sa majesté, une taupe s’y trouve. George Woodhouse, du National Cyber Security Centre, est chargé de l’identifier. Dans sa liste de cinq suspects potentiels figure sa femme Kathryn. Cette histoire de taupe et de possible fuite de données est évidemment un MacGuffin et l’intrigue est d’ailleurs bien inutilement compliquée. Ce qui intéresse Soderbergh, c’est le couple formé par George et Kathryn. Les dialogues sont ciselés, ironiques et savoureux. Le réalisateur a réuni un casting de haute volée : Cate Blanchett, Michael Fassbender, Tom Burke, Pierce Brosnan. L’ensemble est léché, un peu trop sans doute, et surtout beaucoup moins amusant que « Ocean’s eleven ».
- « Black box diaries » de Shiori Ito : Jeune journaliste stagiaire à l’agence Reuters, Shiori Ito a l’opportunité d’avoir un entretien avec Noriyuki Yamaguchi, en charge du bureau de la chaine TBS à Washington. Cette rencontre va très mal se terminer puisqu’il va droguer la jeune femme au restaurant et la ramener à son hôtel pour la violer. Au Japon, les victimes de violences sexuelles n’ont pas le droit à la parole mais Shiori Ito organise une conférence de presse pour dénoncer les actes qu’elle a subis. C’est d’autant plus courageux que Yamaguchi est un proche du premier ministre japonais. Après un livre, la journaliste réalise ce documentaire pour montrer son combat, ses doutes, les difficultés qu’elle a du surmonter durant huit ans. Elle a subi de nombreuses pressions, a été menacée et insultée. Son abnégation, sa ténacité, sa capacité à prendre du recul forcent l’admiration.
- « Mickey 17 » de Bong Joon-ho : En 2054, Mickey Barns est criblé de dettes et est menacé par un usurier. Pour lui échapper, il décide de participer à la colonisation d’une planète, Niflheim. Le seul poste qu’on lui offre est celui de consommable, autrement dit il va être utilisé dans des expériences de laboratoire. Il meurt à chaque fois et une nouvelle version de lui est ensuite imprimée en 3D. L’idée de départ de Bong Joon-ho est excellente, la farce fonctionne parfaitement et offre des scènes burlesques (le corps de Mickey tombe de l’imprimante comme une feuille de papier). La description de cette humanité du futur est pessimiste mais le grotesque l’emporte. Robert Pattinson est parfait dans le rôle de Mickey, grand naïf un peu benêt. Mais le film s’étire en longueur et le réalisateur semble éprouver des difficultés à trouver une fin à sa dystopie.
- « Lire Lolita à Téhéran » d’Eran Riklis : Le film d’Eran Riklis est l’adaptation du livre éponyme d’Azar Nafisi qui racontait son retour en Iran après la révolution. Elle va enseigner la littérature anglo-saxonne à l’université. Rapidement, elle déchante et voit les romans, qu’elle a choisis pour son cours, être interdits par le pouvoir en place. Elle décide alors d’inviter certaines étudiantes chez elle pour les étudier. Le film est très classique dans sa forme mais il vaut pour son casting d’actrices avec à sa tête une Golshifteh Farahani intense et profondément émouvante.