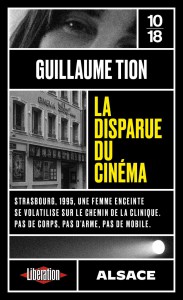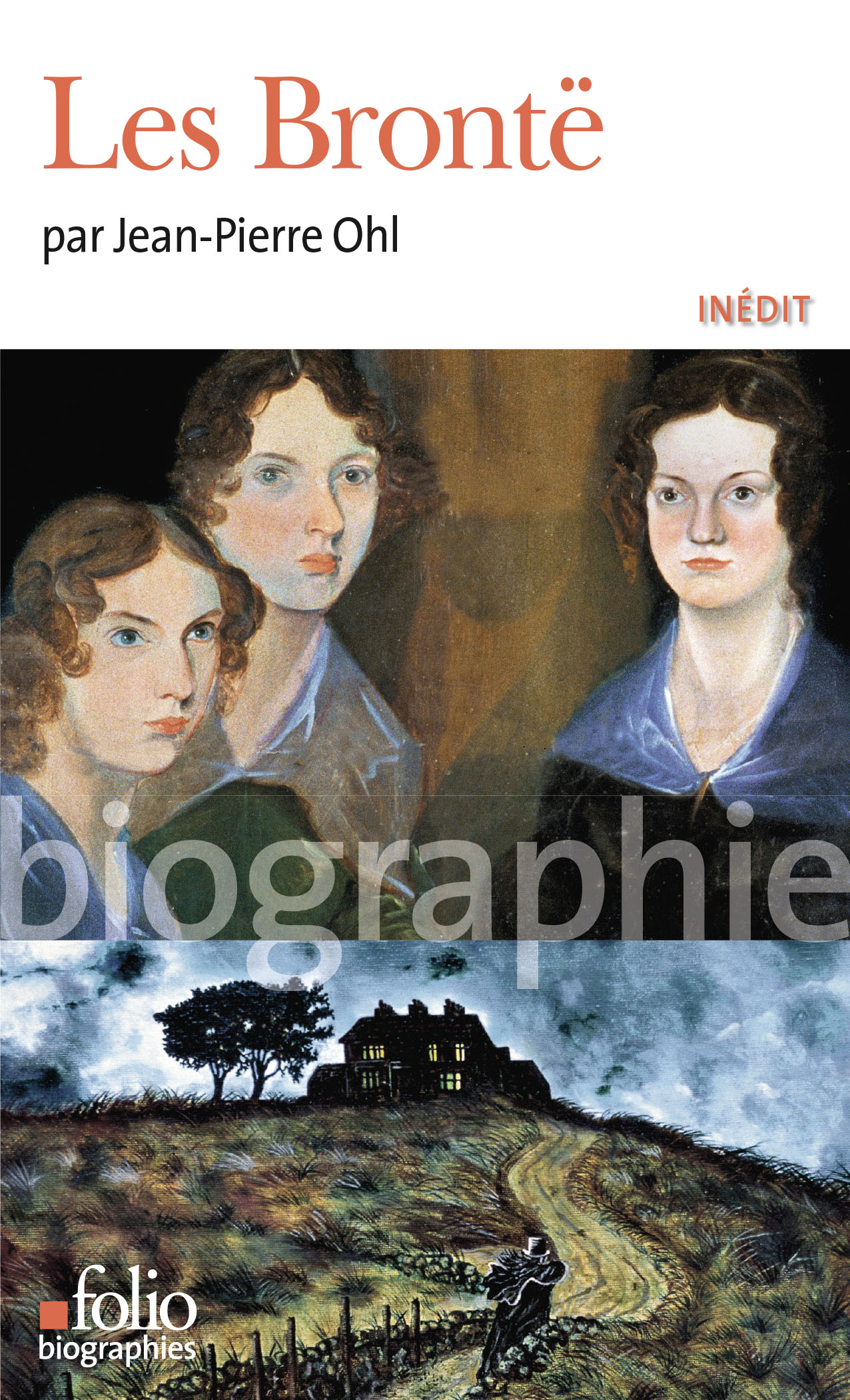Le 6 juin 2012, dans le quartier de la Croix Rousse à Lyon, une femme à vélo est percutée par une moto. Le conducteur, Saïd, roulait à 80 km/h en roue arrière et il perdit le contrôle de son véhicule. La cycliste décédera une semaine après l’accident. Cette femme était la mère de Paul Gasnier, aujourd’hui journaliste à Quotidien. Dix ans plus tard, lors de la campagne présidentielle, les propos d’un candidat d’extrême-droite vont l’emmener à interroger les faits douloureux vécus en 2012. « La correspondance entre mon vécu et son fantasme politique n’a pas cessé de me hanter depuis cette campagne présidentielle, où il faut martelé que l’immigration provoquait de la délinquance et qu’il était urgent d’en protéger les Français. Il fallait le reconnaître : l’extrême-droite avait mis le doigt, avec talent, sur cette confusion et cette colère que j’avais intimement vécu. » Pour dépasser cette colère, « pour comprendre à défait de pardonner », Paul Gasnier va enquêter avec rigueur sur le fait divers qui a bouleversé sa vie. Il s’appuie sur les rapports médicaux, de police, le dossier d’instruction, le récit de témoins pour essayer d’appréhender la généalogie de la violence urbaine. A partir de l’histoire de sa mère et de celle de Saïd, il élargit son propos, essaie de saisir ce qui fracture la France aujourd’hui. Paul Gasnier mélange le récit à l’enquête avec sérieux, sans pathos et avec humanisme. La sobriété et le recul, dont il fait preuve, n’empêchent pas l’émotion et l’on sent la douleur profonde, le deuil terrible qui frappa une famille unie et sans histoire.
« La collision » est un texte remarquable d’intelligence, de réflexion et de justesse où la colère ne met pas à mal les convictions de son auteur.