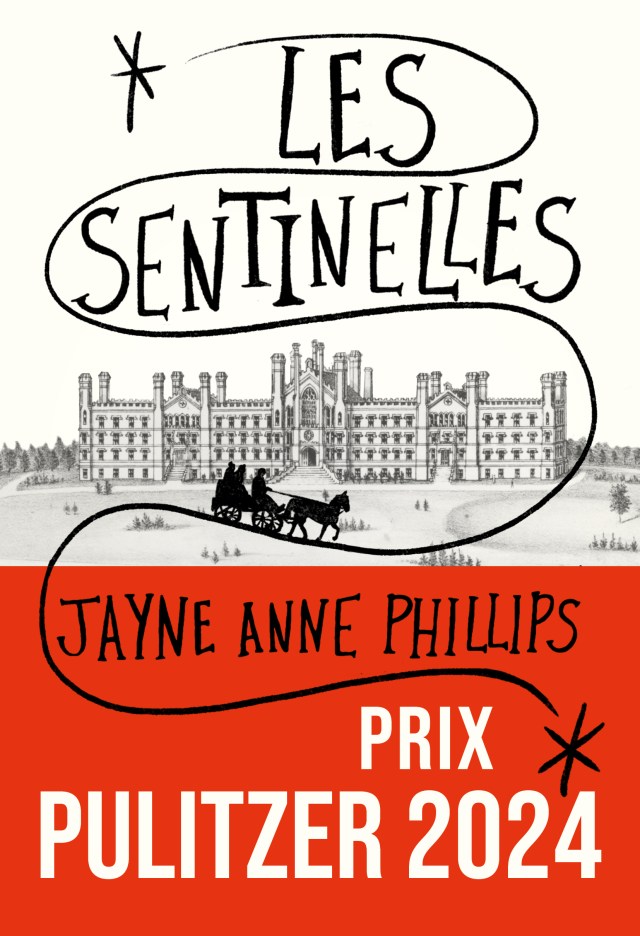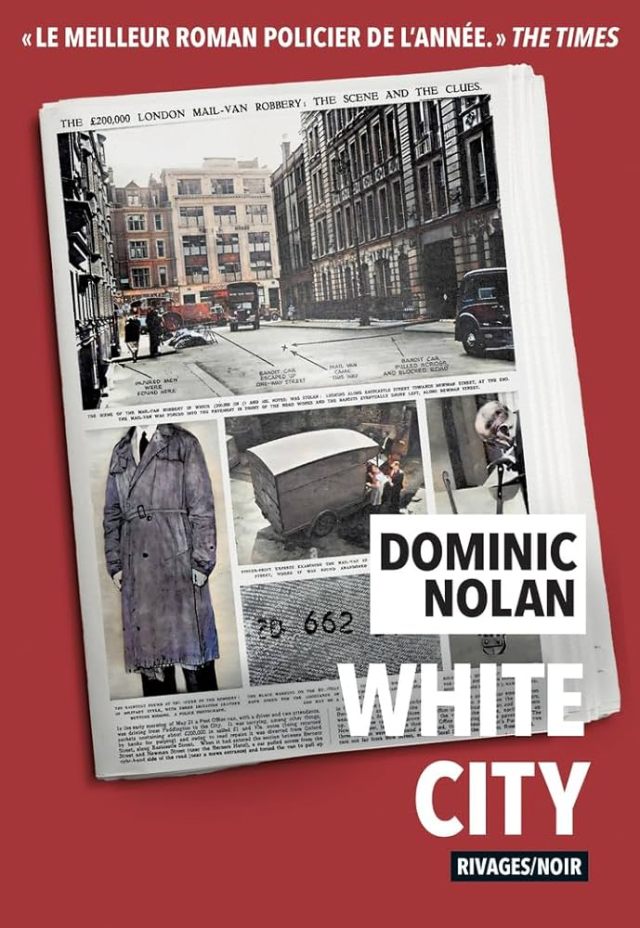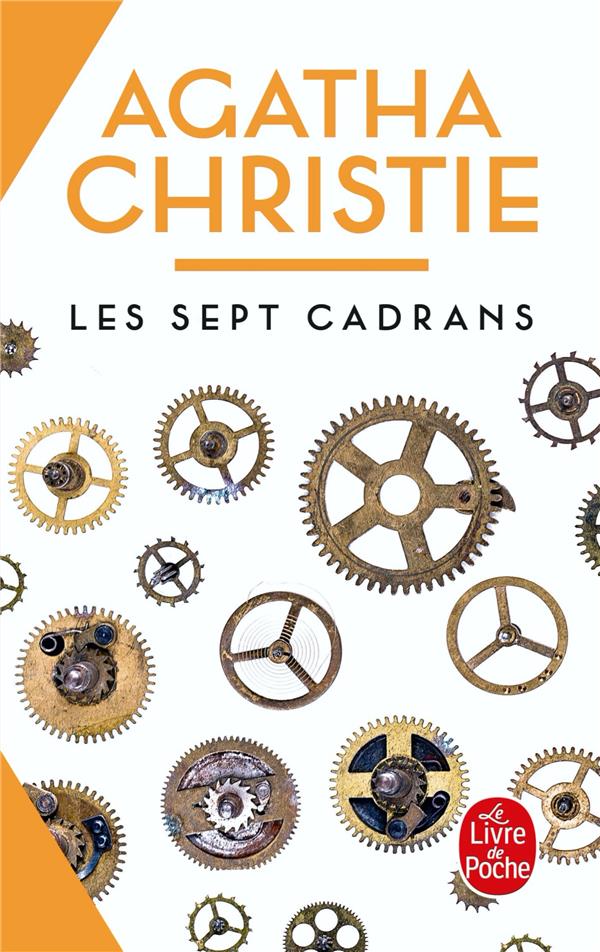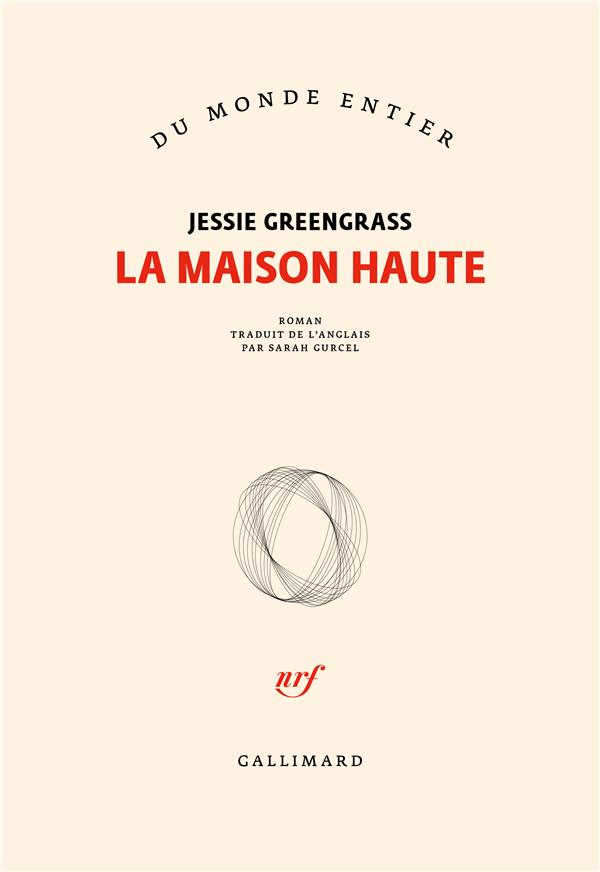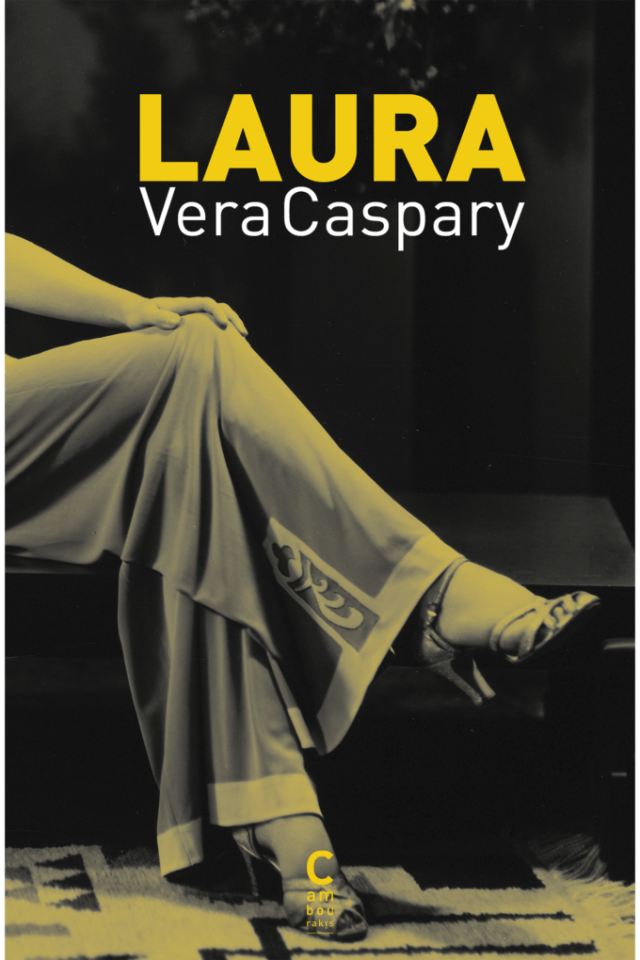Le 31 décembre 1941, James Paradine réunit toute sa famille à River House, sa magnifique demeure tenue par sa sœur Grace. Ce réveillon va se révéler moins festif que prévu. James Paradine, riche industriel dans l’armement, va annoncer durant le repas qu’un membre de sa famille l’a trahi et que cette personne a jusqu’à minuit pour venir se dénoncer dans son bureau. La stupeur gagne l’assemblée et plusieurs convives décident de rentrer chez eux avant minuit. Le lendemain matin, Lane, le majordome, découvre que M. Paradine n’a pas dormi dans sa chambre. Il se rend dans son bureau, découvre la porte vitrée donnant sur la terrasse entrouverte. En contre-bas, Lane aperçoit une forme immobile. Il s’agit du corps sans vie de James Paradine.
Etonnamment, je n’avais encore jamais lu d’enquête de Maud Silver alors que j’apprécie les cosy mysteries et en particulier ceux d’Agatha Christie. Maud Silver, ancienne préceptrice devenue détective privée, n’est pas sans rappeler Miss Marple. Les deux personnages naissent à la même époque : Miss Marple apparaît brièvement dans des nouvelles en 1927 et Miss Silver en 1928 dans « Le masque gris ». Beaucoup de similitudes les rapprochent : ce sont deux vieilles dames, discrètes, inoffensives en apparence mais possédant un sens aigu de l’observation. Maud Silver est également la championne du tricot qu’elle pratique tout au long du roman !
Le charme désuet et le cadre très anglais du roman m’ont bien évidemment séduite. Et j’ai également apprécié la construction du roman. Patricia Wentworth prend le temps d’installer son intrigue et de nous faire connaître chaque protagoniste. La découverte du corps de James Paradine n’intervient qu’à la page 76 et Maud Silver ne fait son entrée en scène qu’à la page 119. Elle n’est donc présente que durant la moitié du roman ce qui me semble être original et inhabituel.
Rien de révolutionnaire dans « Au douzième coup de minuit » mais une lecture douillette, agréable et la découverte d’un nouveau personnage de détective privé à l’anglaise.
Traduction Anne-Marie Carrière