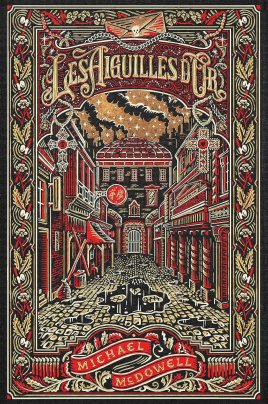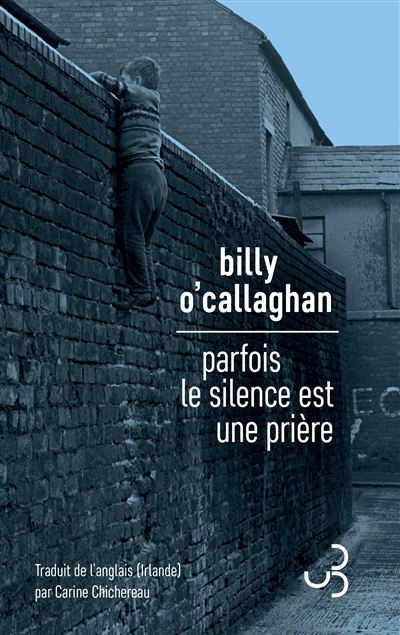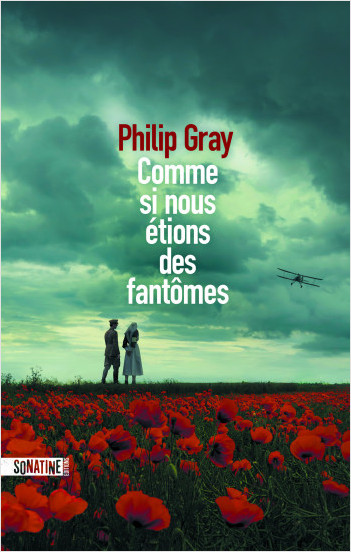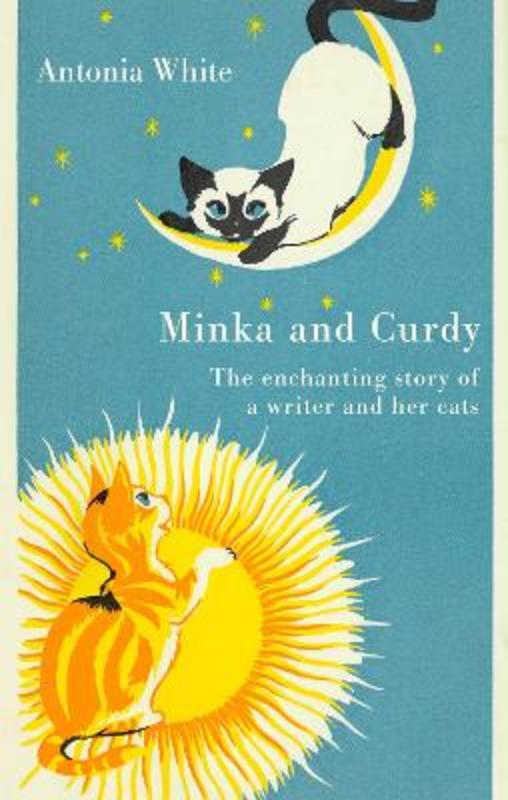J’inaugure l’année 2024 avec six romans et une bande-dessinée. J’ai retrouvé avec un immense plaisir Michaël McDowell avec « Les aiguilles d’or » un roman qui aurait plu à Charles Dickens et Vincent Almendros qui a l’art de la concision et de la chute ce qu’il prouve à nouveau dans « Sous la menace ». La langue de Cécile Coulon m’a encore une fois séduite dans son dernier roman « La langue des choses cachées » et j’ai apprécié de retrouver le talentueux David Park dans un livre qui se rapproche du travail de Graham Greene. J’ai également lu deux premiers romans : celui de Tom Crewe qui nous parle de l’homosexualité à l’époque victorienne et de l’impact du procès d’Oscar Wilde ; celui de Dario Levantino, « De rien ni de personne » qui est le premier tome d’une trilogie. Son second roman est d’ailleurs sorti en grand format. Enfin, je me suis lancée dans la série Paul de Michel Rabagliati que je souhaitais lire depuis longtemps.
Du côté du cinéma, j’ai pu voir neuf films dont voici mes préférés :

Dog vit seul dans un Manhattan peuplé d’animaux. Un soir ordinaire où il mange devant sa t.v., il voit une publicité pour un robot. Ce dernier lui est livré en pièces détachées et dès qu’il l’allume, Dog et lui deviennent inséparables. Tous les deux déambulent joyeusement dans les rues, mangent des hot dogs et font du patin dans Central Park au son de « September » d’Earth Wind and Fire. Les amis passent une journée sur la plage de Coney Island mais lorsque le soir advient, Robot tombe en panne. Impossible pour son ami de le porter jusqu’à chez lui. Il lui promet de revenir le lendemain avec l’équipement adéquat. Lorsqu’il revient, Dog découvre que la plage est fermé pour un an.
Quelle merveille de délicatesse que ce film d’animation ! Le thème de l’amitié puis celui de la séparation sont universels mais il y a tant de tendresse, d’affection entre nos deux héros que leur histoire est irrésistible. Au fil des saisons, la vie reprend son cours pour Dog qui pense de moins en moins à aller sauver son ami mais aussi pour Robot qui sert de nid à une famille d’oiseaux ou est victime d’un ferrailleur. On a le cœur serré à voir les deux amis s’éloigner, on aimerait tant les voir à nouveau réunis. Dog et Robot sont infiniment attachants, ils évoluent dans un New York des années 70-80 merveilleusement reconstitué. « Mon ami Robot » est aussi joyeux que mélancolique, un régal pour les grands et les petits.

Dans leur banlieue parisienne, Giselle et son fils Bellisha sont les derniers juifs à vivre là. Même l’épicerie casher a fermé ses portes. La mère ne cesse de ruminer qu’ils doivent déménager dans une autre ville pour retrouver leur communauté. Mais Giselle a une santé très fragile et c’est Bellisha qui s’occupe de tout : le marché, la cuisine, etc… Lunaire, le fils de 30 ans ne semble s’inquiéter de rien, un brin mytho pour enjoliver la vie pour sa mère, un brin vieux avant l’âge tant il est ancré dans ses habitudes.
« Le dernier des juifs » est le premier long-métrage de Noé Debré qui avait jusqu’à présent exercer ses talents comme scénariste. Il est sur un fil durant tout le film, le sujet abordé étant délicat. Giselle s’exprime régulièrement sur le fait qu’il y a beaucoup de noirs dans le quartier, beaucoup de médecins arabes à l’hôpital. Un tag pro-palestinien apparaitra dans l’immeuble mais pas sur la porte de Giselle, sur celle de ses voisins chinois ! Ce joyeux mélange de communautés pourrait être source de tension mais les habitants du quartier savent se soutenir quand le malheur frappe à leurs portes. La judéité est également questionnée puisque Bellisha doit la cacher puis prouver qu’il est bien juif. Le film oscille entre la comédie (les scènes où Bellisha tente de vendre des pompes à chaleur avec son cousin sont hilarantes) et le drame. C’est subtil, intelligent et servi par deux acteurs exceptionnels : Agnès Jaoui et Michael Zindel.
Et sinon :
- « Bonnard, Pierre et Marthe » de Martin Provost : En 1893, Pierre Bonnard invite une inconnue croisée dans la rue à poser pour lui. De cette rencontre va naître l’un des couples iconiques de la peinture du 19ème siècle. Le film de Martin Provost rend hommage à Marthe et Pierre Bonnard en racontant leur vie entre lumière (leur quotidien joyeux dans leur maison en bord de Seine) et ombre (l’infidèle Pierre et le suicide de Renée). La peinture n’est pas le cœur du film, le réalisateur nous montre plutôt ce qui a nourri l’œuvre du plus célèbre des Nabis. L’image est belle, lumineuse. Ce qui est le plus plaisant dans le film est la mise en avant de Marthe qui fut muse, amante, épouse (tardivement, Pierre refusant de se marier), âme sœur et surtout artiste quand Pierre la délaisse. Je regrette cependant une trop grand ellipse après le décès de Renée. On ne sait, par exemple, pas si Marthe a continué à peindre et comment la culpabilité a joué sur les relations du couple. Le duo Cécile de France/ Vincent Macaigne fonctionne d’ailleurs à merveille.
- « Making of » de Cédric Kahn : Au début de son tournage, Simon, un réalisateur reconnu, apprend qu’il a perdu la plus grande partie de son financement. Son film porte sur le combat d’ouvriers qui ont pris possession de leur usine pour éviter une délocalisation. Leur histoire ne se termine pas bien contrairement à ce que le producteur de Simon a raconté aux financeurs. Pendant que le producteur essaie de trouver de l’argent (et répond de moins en moins au téléphone), Simon doit continuer son tournage au milieu d’une star à l’ego démesuré, des techniciens qui se questionnent sur leur salaire et une directrice de production qui veut faire des coupes dans le scénario. Cédric Kahn est décidément un réalisateur surprenant qui n’est jamais où on l’attend. Après son formidable « Procès Goldman » sorti en octobre 2023, il nous propose une comédie sur le milieu du cinéma. Le tournage, comme la révolte des ouvriers, tourne au naufrage et Simon sombre dans la dépression (il faut dire aussi que sa femme le quitte). Ce que capte le jeune homme en charge du tournage du making of du film, mise en abyme savoureuse qui montre les déboires de Simon. Cédric Kahn s’est offert un casting cinq étoiles avec Denis Podalydès, Emmanuelle Bercot, Valérie Donzelli, Xavier Beauvois, Jonathan Cohen, les jeunes Stéphane Crepon (repéré dans « Le bureau des légendes ») et Souheila Yacoub. C’est drôle, ironique mais également touchant.
- « La fille de son père » d’Erwan Le Duc : Etienne a 20 ans, il rencontre Valérie et c’est le coup de foudre. Rapidement la jeune femme tombe enceinte. Une petite fille naît mais l’histoire tourne mal, Valérie s’enfuit sans explication. Étienne décide de vivre pour sa fille Rosa, d’être toujours présent pour elle. A 16 ans, elle est admise aux Beaux-Arts de Metz, à 300 km de son père. Comme va-t-il prendre cette future séparation ? Après « Perdrix », je retrouve la douce fantaisie d’Erwan Le Duc avec plaisir. Cette relation père-fille sort de l’ordinaire, ils ont quasiment grandi ensemble et on les prendrait presque pour des frère et sœur. Dans leur quotidien, tout est poétique et singulier. Rosa, plus mature que son père, est parfois dure avec lui pour essayer de le pousser à vivre sa vie, à dépasser le drame de l’abandon dont il ne s’est jamais remis. Céleste Brunnquell et Nahuel Pérez Biscayart sont plus que parfaits dans cet univers qui leur va si bien. Il faut aussi parler de Mohammed Louridi, qui interprète le petit ami de Rosa et qui pratique l’amour courtois, la poésie épique et préfère rentrer par la fenêtre que par la porte pour impressionner Rosa ! Son personnage est tout simplement fabuleux.
- « La tête froide » de Stéphane Marchetti : Marie, 45 ans, vit dans un mobil-home à défaut de pouvoir se payer autre chose. Elle est serveuse la nuit et pour arrondir les fins de mois, elle trafique des cartouches de cigarettes entre l’Italie et la France. Son amant, un policier aux frontières, lui indique la route à prendre avec sa marchandise sans être contrôlée. Lors de l’un de ses voyages de l’autre côté des Alpes, elle rencontre Souleymane, jeune réfugié qui veut rejoindre Calais, où se trouve sa sœur, avant de traverser la Manche. Marie le convoie dans sa voiture et l’héberge. Le jeune homme lui propose de faire passer d’autres clandestins. Marie a besoin d’argent urgemment pour payer son emplacement au camping, elle accepte mais ne le fera qu’une seule fois. Le premier film de Stéphane Marchetti fait preuve d’humilité dans sa réalisation. Pas de sensationnalisme ou de tire-larmes dans cette histoire. Le réalisateur cherche avant tout le réalisme et la justesse et il y parvient. Florence Loiret-Caille incarne Marie et c’est toujours un immense plaisir de voir cette comédienne au jeu sensible. J’aurais sans doute beaucoup plus apprécié ce film s’il ne m’avait pas tant rappelé « Les survivants » de Guillaume Renusson où Denis Menochet aidait une jeune afghane à traverser les Alpes pour rejoindre la France.
- « May december » de Todd Haynes : Gracie vit avec Joe avec qui elle a eu trois enfants. Elle avait une trentaine d’années et lui 13 ans lorsqu’ils furent surpris en plein ébat à l’arrière de l’animalerie où travaillait Gracie. A sa sortie de prison, elle épouse Joe et ils s’installent avec leurs enfants. Même si leur vie semble paisible et agréable, le couple reste sulfureux et dérangeant pour certains voisins. Les relations de Gracie avec sa première famille sont également délicates et douloureuses. C’est alors qu’arrive dans la vie du couple, Elizabeth, une actrice qui va interpréter le rôle de Gracie sur grand écran et vient étudier cette famille singulière. Todd Haynes s’est inspiré d’un véritable fait divers pour son dernier film mais c’est plutôt la relation entre Gracie et Elizabeth qui est au cœur du film. L’actrice devient de plus en plus le miroir de son modèle, vampirisant ses attitudes, ses manières de bouger. L’une semble très spontanée, naïve alors que l’autre est cérébrale, elle note et analyse tout. Le duo est étonnant, ambigu et un malaise profond surgit (ou resurgit) dans la vie du couple. Le personnage de Joe est également très intéressant, très révélateur de ce qui se passe sous la surface. Peut-être un peu trop froid, le film offre deux interprétations maîtrisées par deux grandes actrices : Julianne Moore et Natalie Portman.
- « Priscilla » de Sofia Coppola : 1959, sur une base militaire allemande, la jeune Priscilla, 14 ans, rencontre Elvis Prestley qui y faisait son service. Trois ans plus tard, la jeune fille s’envole pour Graceland et devient l’unique femme du king. Le film de Sofia Coppola s’est inspiré du livre de Priscilla Prestley et adopte son point de vue. Le traitement de son histoire rappelle d’autres films de la réalisatrice : l’ennui, la mélancolie de l’adolescence comme dans « Virgin suicides », la prison dorée comme celle de Marie-Antoinette. Comme ces héroïnes, Priscilla est perdue, elle semble isolée et loin du milieu du show business. On découvre un Elvis manipulateur, façonnant sa femme comme une poupée décorative, la bourrant de médicaments. Mais il est également un petit garçon vulnérable et influençable. Rien à reprocher aux acteurs mais j’ai trouvé que la mise en scène, les ellipses nous tenaient à distance de Priscilla et je n’ai pas ressenti beaucoup d’empathie pour elle.
- « La vie rêvée de Miss Fran » de Rachel Lambert : La vie de Fran est monotone et solitaire. Elle se rend à son travail mais ne communique pas avec ses collègues. Elle vit seule et ne semble pas avoir de loisir. Son quotidien va changer avec l’arrivée d’un nouveau collègue vers qui elle va avoir envie d’aller. Le film de Rachel Lambert a un certain charme : l’humour caustique Fran lorsqu’elle commence à s’ouvrir au monde, son imagination concernant les façons dont elle peut mourir. Fran est inadaptée à la vie sociale, une anti-héroïne comme les États-Unis aiment en créer. Néanmoins, je reconnais m’être un peu ennuyée face à l’histoire de Fran.