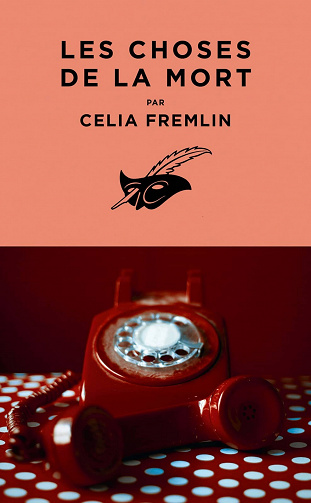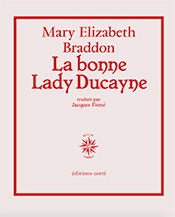« Une semaine plus tard, je m’appuie au dossier du siège et contemple les lumières qui défilent à la fenêtre tandis que le car démarre. Je souris prudemment en songeant à l’automne qui s’achève, semestre qui devait marquer le commencement de ma nouvelle vie. Rien n’a commencé. Humainement, je n’ai pas progressé. Ça ressemble plutôt à une régression. » Récemment bachelier, Aaro s’est précipité dans une grande ville pour poursuivre ses études à l’université. Il fuit une ville où tout le monde se connaît et où il a été harcelé pendant toute sa scolarité. Mais aussi sa famille, à laquelle il n’a rien avoué de ses souffrances, où il se sent très seul. Il a notamment beaucoup déçu son père en abandonnant les compétitions d’athlétisme où il excellait à la course. Trop de pression sur les épaules de ce jeune homme qui est si mal dans sa peau. L’anonymat de la ville ne change rien à son mal-être et à ses difficultés à créer des liens. L’alcool, les médicaments et des dépenses effrénées n’empêcheront pas Aaro de devoir faire face à la réalité.
Le premier roman d’Antti Rönkä est une plongée vertigineuse dans les pensées de son héros qui se méprise. Le récit se fait à la première personne. Aaro ne ne supporte pas. Il se recoiffe quinze fois par jour, s’achète des vêtements hors de prix, mais se trouve toujours aussi laid. Ses pensées, étouffantes, virent souvent à la paranoïa vis-à-vis des comportements et propos des autres. Il est tellement obsédé par lui-même, tellement aliéné par ses propres pensées que les autres n’ont pas de place. Et c’est tout le paradoxe de ce personnage qui voudrait pourtant aller vers les autres. On aimerait parfois l’arrêter, le secouer pour le sortir de ses questionnements, tergiversations incessantes. Le texte d’Antti Rönkä n’est d’ailleurs pas si sombre qu’il n’y paraît ; il y a aussi beaucoup d’autodérision chez Aaro.
« Sans toucher terre » est le premier roman saisissant d’Antti Rönkä qui nous raconte le difficile passage à l’âge adulte d’un jeune homme qui se déteste.
Traduction Sébastien Cagnoli