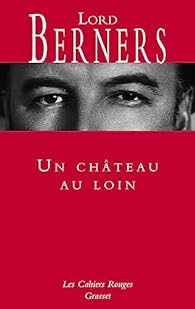Le mois de novembre s’achève et j’ai lu sept livres (6 3/4 en réalité, je n’ai pas encore terminé « Comme si nous étions des fantômes » !). Je vous ai déjà parlé de l’excellent livre de Marika Doux sur Elizabeth Siddal et Dante Gabriel Rossetti. J’ai également adoré le dernier roman de François Bégaudeau et le premier de Chloe Ashby. J’ai retrouvé avec bonheur l’humour so english de Lord Berners. J’ai eu l’occasion de lire le Prix Goncourt 2023 qui est fort plaisant mais un peu long. Et je crains d’avoir le même avis sur le premier roman de Philip Gray qui est néanmoins fort documenté. Je vous reparle de mes lectures de novembre très prochainement.
Côté cinéma, je suis allée six fois dans les salles obscures et j’ai eu deux coups de cœur :

On découvre Mona Achache au milieu d’un appartement vide de meubles mais rempli de photos, de manuscrits, de lettres, d’enregistrements audio, de carnets. Toutes ces archives ont appartenu à sa mère Caroline, qui s’est suicidée à l’âge de 63 ans. La réalisatrice va se plonger dans toute cette matière pour essayer de mieux comprendre sa mère et sa violente disparition. Son enquête va s’incarner de manière surprenante en Marion Cotillard qui arrive dans l’appartement.
Le dispositif choisi par Mona Achache est surprenant et se révèle saisissant. Marion Cotillard endosse littéralement l’identité de Carole, qui fut romancière et photographe de plateau. Elle commence par s’habiller avec les vêtements, les bijoux de la défunte, elle travaille sa voix en écoutant en boucle celle de Carole, elle rejoue des scènes en playback. La transformation se fait devant nos yeux, elle témoigne aussi du travail d’incarnation de l’actrice. C’est vertigineux. Les vies de Carole Achache, de sa mère (Monique Lange, figure incontournable de Gallimard) mais également de Mona se racontent sous forme de fragments, de reconstitution et leur histoire est bouleversante. La répétition des violences sexuelles est marquante comme si elles étaient une malédiction familiale inévitable. Carole subira la perversion de Jean Genet lorsqu’elle est enfant. De manière très ingénieuse, Mona Achache retrace la vie chaotique de sa mère : la drogue, la prostitution, l’écriture, la dépression. « Little girl blue » est un film étonnant qui retrace un destin singulier, une âme tourmentée et une lignée de femmes blessées qui chacune rendit hommage à sa propre mère au travers d’une œuvre. Le film émeut profondément notamment grâce à l’incroyable performance de Marion Cotillard.

1858, les brigades du pape-roi Pie IX viennent arraché à sa famille le jeune Edgardo Mortara. Né dans une famille de confession juive, l’enfant a été baptisé en secret par une servante inquiète pour son salut. L’enfant doit donc être élevé dans les préceptes catholiques. L’enlèvement fit scandale en Italie et ailleurs dans le monde. Les parents Mortara firent tout ce qui étaient en leur pouvoir pour récupérer leur fils, en vain. Même l’unification de l’Italie en 1870 et la déchéance du pape ne libéreront pas Edgardo.
Le film de Marco Bellocchio est passionnant et bien évidemment déchirant. Le réalisateur italien s’intéresse depuis longtemps à l’histoire de son pays, aux évènements marquants de celle-ci. Comme dans sa série sur l’enlèvement d’Aldo Mauro (« Esterno notte » aussi formidable que le film sur le même thème « Buongiorno notte »), il mêle l’intime et le politique. Pie IX est un personnage odieux, despotique et antisémite (la scène où il humilie et menace les représentants du ghetto de Rome fait froid dans le dos). L’enfant est soumis à un véritable lavage de cerveau par l’Église que Bellocchio fustige en tant qu’institution et dont il souligne la morbidité. La mise en scène est grandiose, maitrisée, elle possède un souffle extraordinaire. Marco Bellocchio n’a rien perdu de son mordant et il nous raconte ici un évènement sidérant de brutalité et d’inhumanité de la part d’une papauté en sursis.
Et sinon :
- « Le garçon et le héron » d’Hayao Miyazaki : A Tokyo, durant la seconde guerre mondiale, un hôpital est en feu. Un garçon de 11 ans s’y précipite car sa mère s’y trouve. Celle-ci périra dans l’incendie. Le jeune garçon, Mahito, est évacué à la campagne chez sa tante, qui est devenue la deuxième femme de son père. Il peine à s’adapter à sa nouvelle vie jusqu’à ce qu’un étrange héron cendré vienne perturber sa vie et lui ouvrir les portes d’un monde parallèle surprenant. « Le garçon et le héron » est très probablement le dernier film d’Hayao Miyazaki, âgé de 82 ans. On y retrouve les thèmes, les motifs chers au réalisateur : une partie réaliste avec un jeune garçon isolé, déraciné (comme Chihiro) et souffrant douloureusement du décès de sa mère, une partie fantastique qui nous entraine de l’autre coté du miroir. Cet univers mi-rêve, mi-cauchemar met Mahito à l’épreuve et lui permet de dire adieu à sa mère. Les créatures rencontrées par Mahito, les décors splendides sont encore une fois la preuve de l’imaginaire extraordinaire de Miyazaki (coup de cœur pour les warawara, qui ressemblent aux adiposes du Doctor Who, et pour les perruches colorées). Même si cette deuxième partie est toujours aussi flamboyante, elle m’a semblé s’étirer en longueur. Malgré tout, le film est visuellement épatant, dense et le destin de Mahito reste très touchant.
- « L’incroyable Noël de Shaun le mouton » de Steve Cox : Si comme moi, vous êtes fan des créations du studio Aardman, vous ne résisterez pas au retour du plus facétieux des moutons anglais. Deux courts métrages composent ce programme : Une surprise de Noël pour Timmy et L’échappée de Noël. Même s’ils s’adressent plutôt aux enfants, c’est un plaisir de retrouver la bande de moutons gaffeurs menés par un Shaun malicieux et futé. Les péripéties, les gags sont au rendez-vous dans un esprit de Noël réjouissant.
- « Vincent doit mourir » de Stéphan Castang : Vincent est graphiste dans une agence de pub lyonnaise. Sa vie est banale, il est célibataire, inscrit sur les réseaux sociaux, il sympathise avec ses voisins d’immeuble. Un jour, au bureau, un stagiaire le frappe violemment et sans raison apparente avec son ordinateur. Quelques jours après cette agression, un collègue lui plante un stylo dans le bras. Vincent se rend compte qu’un simple contact visuel provoque un déferlement de violence contre lui. Il décide de quitter Lyon pour s’isoler à la campagne à l’abri des regards de ses congénères. « Vincent doit mourir » est un film très original et totalement anxiogène. La raison de cette poussée de violence (Vincent n’est pas la seule victime) ne sera jamais explicitée et cela rend le film d’autant plus inquiétant. Notre société de plus en plus dure, de plus en clivante ne génère-t-elle pas déjà de la violence ? Stephan Castang ne se contente pas de réaliser un thriller paranoïaque et apocalyptique. L’humour est régulièrement présent par petites touches pour alléger la tonalité sombre de l’ensemble. L’arrivée de Margot dans la vie de Vincent apporte également de la légèreté et de la fantaisie. Sortir d’une telle intrigue n’est pas évident mais le réalisateur s’en sort à merveille. Vimala Pons et Karim Leklou forment un duo parfait dans ce film très réussi.
- « Simple comme Sylvain » de Monia Chokri : Sophia est professeur de philosophie à Montréal. En attendant un poste à l’université, elle donne des cours à des retraités. Elle est en couple avec Xavier depuis dix ans mais leur amour s’est transformé en tendre amitié. Aussi, lorsqu’elle fait la connaissance de Sylvain, le charpentier qui répare leur résidence secondaire, elle tombe totalement sous son charme. Leur relation sera placée sous le signe du désir ardent mais également sous celui de la différence de classe sociale. Le film de Mona Chokri est vraiment réjouissant. La réalisatrice s’amuse avec les clichés de la comédie romantique. Sofia et Sylvain évoluent longtemps dans une bulle, loin du monde et de leurs proches. Le choc des cultures se fera au travers de deux repas où chacun présente sa famille et ses amis à l’autre. Monia Chokri ne privilégie d’ailleurs aucun des deux milieux et se moque des préjugés et des manières de chacun. L’amour et le désir peuvent-ils résister aux différences de classe ? S’il y a beaucoup d’humour dans les dialogues et la manière de filmer, « Simple comme Sylvain » n’est pas exempt de mélancolie. Piquant, sensuel, enlevé, lyrique, voilà le cocktail que nous propose la réalisatrice québecoise avec un grain seventies qui ajoute au charme de son film.