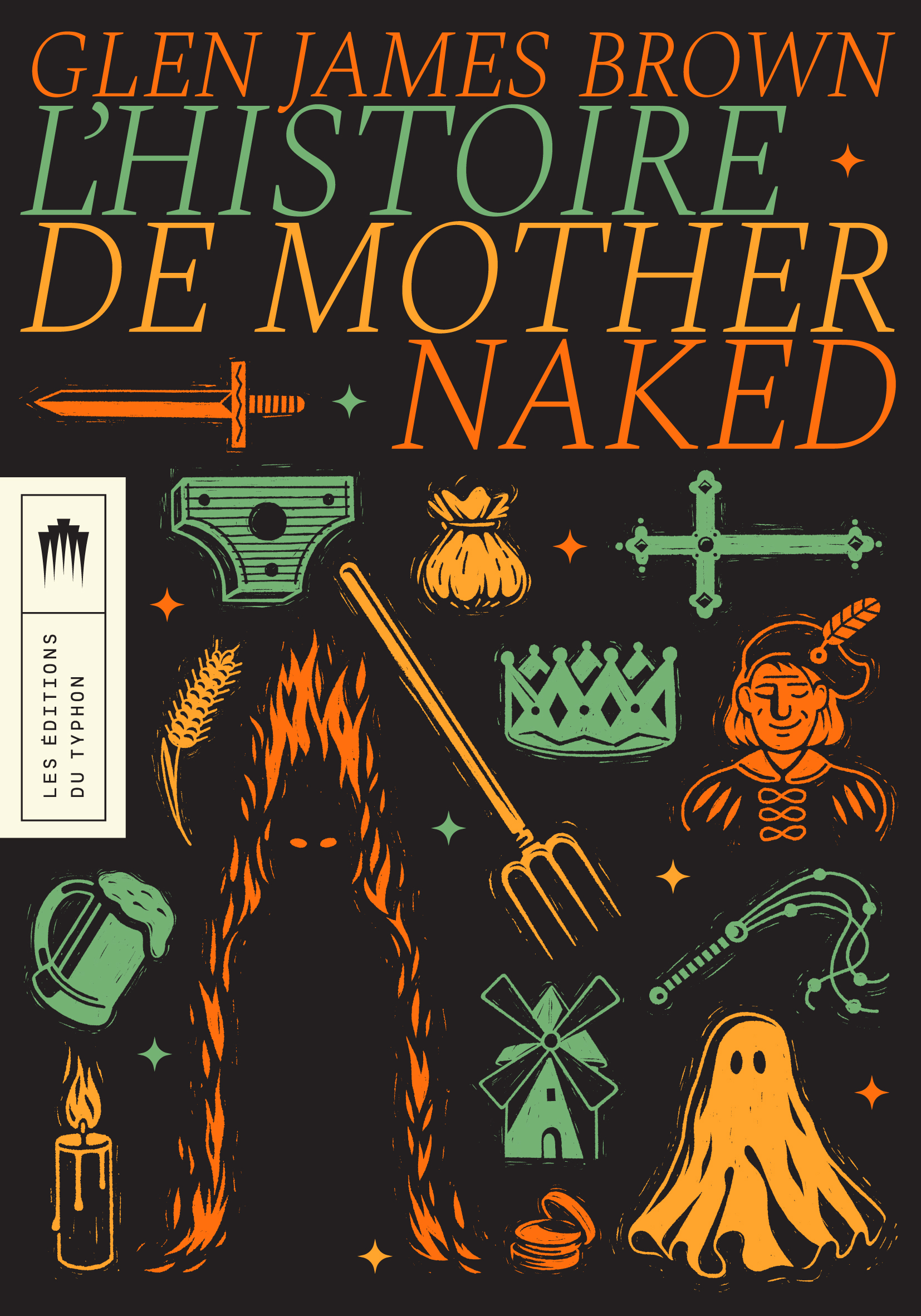Voici mon bilan de lectures du mois de septembre :
-« Les hommes de Shetland », premier roman de Malachy Tallack sorti en cette rentrée littéraire et qui est un roman touchant sur un homme solitaire ;
-« Un gentleman à la mer » est un court texte de Herbert Clyde Lewis et c’est une pépite d’humour grinçant ;
-Peter May a rajouté un volume à sa trilogie écossaise avec « Loch noir » où Fin McLeod revient à nouveau sur l’île de Lewis pour enquêter ;
-« L’appel » de Leila Guerriero dresse l’incroyable portrait de Sylvia Labeyru, otage de la dictature militaire argentine, et sa difficile libération ;
-« La violoniste » était la troisième nouvelle de Ferdinand von Saar que je lisais et je suis toujours séduite par sa plume mélancolique et délicate ;
-Gillian McAllister se lance un nouveau défi littéraire avec « L’instant d’après » et écrit deux romans en un ;
-Après avoir adoré « Ironopolis », j’ai eu un nouveau coup de cœur pour le deuxième roman de Glen James Brown « L’histoire de Mother Naked » ;
-« La méridienne » de Marghanita Laski est un court texte surprenant qui m’a beaucoup fait penser à « La séquestrée » de Charlotte Perkins Gilman ;
-Je termine le mois de septembre le sourire aux lèvres avec le dernier roman de Fabrice Caro « Les derniers jours de l’apesanteur ».
Côté cinéma, j’ai vu neuf films dont voici mes préférés :

Accompagné par son jeune fils Esteban, Luis recherche sa fille Mar qui a disparu depuis plusieurs mois. Sa quête l’a emmené au cœur de l’Atlas marocain où se déroule une rave sauvage dont sa fille était friande. Personne ne la connaît mais on lui indique qu’une autre fête va avoir lieu plus loin dans le sud du désert, il décide alors de suivre un groupe de teufeurs.
« Sirât » est un film dont on sort sidéré, Oliver Laxe nous fait vivre une véritable expérience sensorielle. La musique techno, que je n’apprécie pas spécialement, est ici la pulsation du récit, l’état de transe des danseurs devient presque le nôtre. Les paysages, dans lesquels se déroulent l’histoire, sont incroyables, arides et impressionnants. Voir un mur d’enceintes s’élever devant les montagnes de l’Atlas est l’une des images marquantes de ce film. Ces paysages, les camions mastodontes des teufeurs évoquent « Mad Max ». Et c’est bien une atmosphère de fin du monde dans laquelle sont plongés les personnages puisqu’il est question de guerre à la radio. Ces personnages sont d’ailleurs tous des marginaux déglingués, handicapés qui font entrer Luis et Esteban dans leur petite communauté. Ensemble, ils vont parcourir le désert, se confronter à des dangers extrêmes. Le suspense s’affirme alors dans le film qui nous réserve des coups de théâtre saisissants.
« Sirât » est un film hallucinant et halluciné. L’expérience se transforme en cauchemar pour les personnages devant nos regards stupéfiés.

Nora est une actrice reconnue pour son travail au théâtre. Solitaire, angoissée, elle éprouve des difficultés à vivre. Sa sœur cadette, Agnès, semble mieux avoir digéré leur enfance compliquée entre deux parents se déchirant sans cesse. Le père est un cinéaste de renom qui a été très absent pour sa famille et l’est encore. Il revient au moment de l’enterrement de son ex-femme pour proposer le rôle principal de son prochain film à Nora. Ces deux-là n’arrivent plus à communiquer depuis des années.
« Oslo, 31 août » et « Julie (en douze chapitres) » sont deux films que j’avais adorés et j’étais ravie de retrouver l’univers de Joachim Trier d’autant que Renate Reinsve y tient également le rôle principal. J’ai beaucoup apprécié la place donnée à la splendide maison à Oslo qui a toujours abrité cette famille. Chargée d’émotions positives mais également négatives (la grand-mère s’y est suicidée), elle se présente comme un fil rouge et une incarnation des relations familiales avec ses nombreuses fissures. L’exploration des liens entre père et filles évoque le cinéma d’Ingmar Bergman mais j’ai trouvé le film de Joachim Trier beaucoup moins sombre, moins plombant. La lumière vient de la relation infiniment touchante entre les deux sœurs qui se soutiennent contre vents et marée et malgré leur différence de caractère. L’affiche reprend d’ailleurs l’une des scènes les plus émouvantes entre Nora et Agnès. « Valeur sentimentale » est un drame familial subtil qui offre aux spectateurs de beaux moments chargés d’émotion.
Et sinon :
- « Nino » de Pauline Loquès : Nino a fait des examens médicaux en raison d’une douleur à la gorge. Mais il ne s’attend pas au diagnostic que lui révèle de façon abrupte le médecin : le jeune homme est atteint d’un cancer. Perturbé par la nouvelle, il perd ses clefs et erre dans Paris allant de proches en proches sans parvenir à leur apprendre sa maladie. Malgré sa thématique, le film de Pauline Loquès n’est que douceur et tendresse. Cela est dû au personnage de Nino, formidablement incarné par Théodore Pellerin, qui est un jeune homme réservé, un brin lunaire et d’un grand calme face à ce qui lui arrive. Son errance dans les rues de Paris évoque « Cléo de 5 à 7 » mais aussi « Oslo, 31 août » de Joachim Trier. Sa mère, ses amis sont là mais le diagnostic a installé une distance entre eux et Nino qui se sent bien seul. Sa déambulation l’amènera à rencontrer un veuf éploré aux bains douches, une ancienne camarade de classe mère célibataire qui l’accueillera une nuit. « Nino » est le très beau portrait d’un personnage infiniment touchant et attachant.
- « Ciutad sin sueño » de Guillermo Galoe : Toni et Bilal sont deux adolescents vivants dans la Cañada Real, le plus grand bidonville d’Europe. Ils sont amis et leur vie est sur le point de changer. La Cañada est proche de Madrid, la valeur des terrains a fortement augmenté et les pouvoirs publics veulent déloger les gitans, les roms et les marocains qui y vivent (notamment en leur coupant l’électricité). La famille de Bilal a décidé de partir. Mais le grand-père ferrailleur de Toni refuse de partir vivre en appartement. Patriarche imposant, il n’a connu que la Cañada, la nature sauvage qui l’entoure comme les trafics qui y règnent. Guillermo Galoe a très longtemps côtoyé les habitants de la Cañada pour gagner leur confiance et finir par leur proposer de jouer dans son film. Tous les acteurs sont donc non professionnels et cela donne bien entendu une épaisseur réaliste supplémentaire. La Cañada est un lieu invraisemblable où les communautés vivent ensemble an partageant leurs cultures et leurs légendes. Le lieu n’a bien sûr rien d’idéal, il est dur et rugueux. Mais Toni et Bilal savent y être heureux, ils réinventent leur quotidien en filmant avec un téléphone. « Ciutad sin sueño » est un formidable et saisissant film social.
- « L’intérêt d’Adam » de Laura Wandel : Adam, 4 ans, est hospitalisé pour malnutrition suite à une décision de justice. Sa mère célibataire est sans famille proche et a un droit de visite limité. Lucy, l’infirmière en chef du service de pédiatrie, doit s’assurer qu’elle respecte bien ses horaires de présence auprès d’Adam. Mais le profond désarroi de la mère la touche profondément et elle tente de l’aider au-delà de ce qui lui est demandé. Le film de Laura Wandel nous plonge en immersion dans ce service de pédiatrie, son dispositif est proche du documentaire. La caméra suit sans cesse Lucy rendant ainsi l’urgence de la situation et soulignant son très (trop) grand investissement dans son service. La tension nait de la confrontation entre la mère follement aimante mais perdue et une infirmière proche du burn out qui va finir par transgresser les règles. Le film est porté par deux extraordinaires actrices : Anamaria Vartolomei et Léa Drucker.
- « La femme qui en savait trop » de Nader Saeivar : Tarlan, enseignante et militante, s’inquiète pour Zara, sa fille adoptive. Celle-ci est professeure de danse et son mari veut l’obliger à arrêter son activité, mal vue du régime islamique. Il la maltraite, la frappe. Tarlan tente d’arranger les choses, tout en s’occupant de son fils, en prison pour malversations financières. Un jour, elle assiste à une scène violente dans la demeure de Zara. « La femme qui en savait trop » a été écrit par Nader Saeivar et Jafar Panahi et ils s’inscrit dans le mouvement « Femme, vie, liberté ». Il a été tourné de manière clandestine comme beaucoup de films iraniens en ce moment. Le film est le portrait d’une femme admirable qui a toujours combattu pour le droit syndical et celui des femmes et qui ne compte pas abdiquer devant les méthodes du régime. Ce dernier régit aussi bien la vie publique que la sphère privée et surtout celles des femmes. La danse est un symbole de l’oppression faite aux femmes et nous offre une splendide scène finale qui donne un peu d’espoir. L’interprète principale, Maryam Boubani, est formidable d’humanité et d’obstination.
- « Classe moyenne » d’Antony Cordier : Pendant l’été, la famille Trousselard vient vivre dans sa luxueuse villa du sud de la France. Lui est avocat d’affaires et elle une actrice dont la carrière bat de l’aile. Pendant le reste de l’année, la propriété est gardée par la famille Azizi. Les relations entre eux restent polies jusqu’à ce que la condescendance, les caprices et le mépris des Trousselard dépassent les bornes. La cohabitation entre les deux va se transformer en jeu de massacre. La lutte des classe n’est pas morte comme nous le montre le film d’Antony Cordier, elle est même particulièrement cinglante. Les coups bas, les humiliations et les mesquineries sont au menu (M. Trousselard se targue d’être un excellent cuisinier à longueur de temps) et sont servis par des dialogues ciselés. Le casting est absolument parfait avec en tête un Laurent Lafitte odieux à souhait, imbu de lui-même et pédant avec ses locutions latines. « Classe moyenne » se révèle cruel et réjouissant.
- « Downton abbey : le grand final » de Simon Curtis : La famille Crawley connait bien des problèmes en cette année 1930. Lady Mary vient de divorcer ce qui cause un véritable scandale dans les salons aristocratiques (elle sera obligée de se cacher sous un escalier avec ses parents pour ne pas croiser des membres de la famille royale lors d’une réception). L’argent de l’héritage de Lady Grantham a été mis en péril par le krach de 29 et les imprudences de son frère. Les choses changent à Downton Abbey avec la retraite de Mr Carson et Mrs Patmore. Une page se tourne à Downton et pour les spectateurs de la série dont je fais partie depuis le 1er épisode. Le plaisir du film nait des retrouvailles avec cette galerie de personnages que l’on suit et que l’on apprécie depuis si longtemps. Le plus de ce troisième film est la présence de l’irrévérencieux et sarcastique Noël Coward qui est un vent de modernité dans les salons de Downton. L’évocation des disparus (Matthew, Sybil) ne peut qu’émouvoir mais celle qui nous manque terriblement, c’est bien sûr Lady Violet (irremplaçable Maggie Smith) dont le fantôme fait monter les larmes aux yeux. Longue vie à Downton Abbey !
- « Connemara » d’Alex Lutz : Après un burn out, Hélène décide de retourner dans sa région natale entre Nancy et Épinal suivie par son mari et ses filles. Cette petite ville, trop étriquée pour ses ambitions, elle la retrouve comme si elle n’était jamais partie. Rien n’a véritablement changé. La preuve, son coup de cœur d’adolescente, Christophe, est toujours là et il va même rechausser les patins de hockey où il excellait. Hélène, qui a un grand besoin de légèreté, va entamer une liaison avec lui. Le film d’Alex Lutz est adapté du roman éponyme de Nicolas Mathieu qui évoquait le déterminisme social, l’opposition entre deux France, l’une plus populaire que l’autre qui passe le tube de Michel Sardou à chaque fête. Les deux héros sont interprétés par deux acteurs que j’apprécie beaucoup : la lumineuse et sensible Mélanie Thierry et le touchant Bastien Bouillon (dans un rôle un peu trop proche de celui de « Partir un jour »). Malgré leur performance et une certaine délicatesse dans le regard du réalisateur, l’émotion ne passe pas l’écran peut-être en raison de trop d’effets de mise en scène.