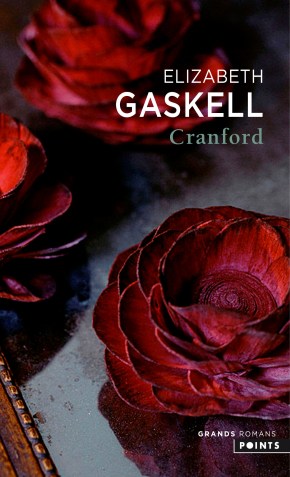Le 9 juillet 1864, un évènement fait basculer la tranquillité du royaume de la reine Victoria. En ce fameux été pestilentiel, le chef de gare Benjamin Ames fit une découverte macabre : un compartiment de 1ère classe de la North Londaon Railway est tâché de sang. A l’intérieur, il découvre également un sac de cuir, un chapeau et une canne à lourd pommeau maculé de sang. Après des recherches, le corps d’un homme est trouvé sur les voies. L’homme est sévèrement blessé à la tête et décèdera quelques heures plus tard. Les objets retrouvés dans la compartiment permettent d’identifier la victime, il s’agit de Thomas Briggs, employé de banque à la City. Un homme respectable, très probablement assassiné dans un train, voilà une affaire épineuse qui nécessite une résolution rapide pour calmer les esprits. Les enquêteurs de Scotland Yard ont un point de départ : le chapeau découvert dans le wagon n’est pas celui de M. Briggs. Tout le mystère réside dans cet objet : à qui appartient-il et où se trouve le chapeau de M. Briggs ?
L’historienne Kate Colquhoun s’est emparé de manière magistrale de ce fait divers qui en dit long sur l’époque victorienne. « La mort de Thomas Briggs signifiait que, pour la première fois depuis l’invention du chemin de fer, un meurtre avait eu lieu à bord d’un train anglais. » Le train est l’une des inventions majeures du XIXème siècle et on sait à quel point l’Angleterre y a passionnément adhéré. Il réduit les distances, le transport de marchandises, permet les loisirs et le développement des affaires. Des romanciers comme Charles Dickens en font l’apologie. Mais le train défigure les paysages (c’est une des peurs des habitantes de Cranford dans l’adaptation BBC) et les accidents frappent les esprits (Dickens ne se remettra jamais de son terrible accident à Stappelhurst). L’image du train est déjà fragilisée et le meurtre du banquier va augmenter l’angoisse des Anglais. La sécurité de ce moyen de transport est remis en doute. La rapidité, la brutalité de l’agression stupéfient mais pire que tout : personne n’a rien vu ou entendu. La méfiance s’installe.
Et ce sont des inspecteurs modernes qui sont chargés de enquête. Depuis 1842, existent les premiers détectives. « Encouragée par l’adulation que leur vouaient des auteurs comme Dickens, l’Angleterre s’était largement laissé convaincre de l’intelligence supérieure de ces inspecteurs en civil, perspicaces et obstinés. » De nouvelles techniques se mettent en place. Les faits sont étudiés de manière logique et méthodique. Par exemple, les échantillons de sang sont testés et l’on peut déterminer s’il est d’origine humaine ou non. Ce sont les balbutiements de la police scientifique et on constate d’ailleurs que les résultats priment totalement sur les faits.
L’affaire du meurtre de M. Briggs déchaîne l’opinion publique pour deux raisons. Tout d’abord l’engouement des romans à sensation. Les œuvres de Wilkie Collins et Mary Elizabeth Braddon connaissent un succès fou. Les Anglais aiment se faire peur d’autant plus que leurs livres se terminent toujours par la résolution du mystère et l’arrestation du meurtrier. Le cadre de cette littérature est, comme dans le cas de l’assassinat de la North London Railway, la haute société. Le crime sort littéralement du cadre des romans. La deuxième raison qui a rendu ce fait divers si connu, est le développement de la presse à scandale. Les journalistes s’emparent de l’évènement. Les faits sont analysés, décortiqués quotidiennement de manière pléthorique. Aucun détail morbide n’est épargné et le principal suspect est jugé coupable à la une de tous les journaux bien avant le véritable jugement. Le sensationnel l’emporte rapidement sur la véracité des faits. Ces journaux peu scrupuleux déchaînent la haine de l’opinion publique contre le pauvre suspect qui n’avait dès lors plus aucune chance.
« Le chapeau de M. Briggs » est un livre passionnant et haletant de bout en bout. Ce fait divers illustre parfaitement les évolutions engendrées par le progrès galopant et les peurs inhérentes à celui-ci. Kate Colquhoun nous éclaire intelligemment sur l’époque victorienne et l’incroyable retentissement de ce fait divers.