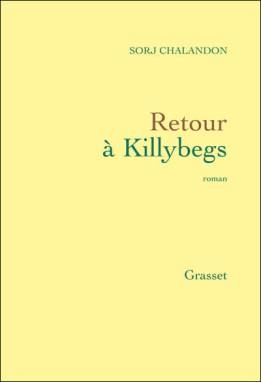
« Maintenant que tout est découvert, ils vont parler à ma place. L’IRA, les Britanniques, ma famille, mes proches, des journalistes que je n’ai même jamais rencontrés. Certains oseront vous expliquer pourquoi et comment j’en suis venu à trahir. Des livres seront peut-être écrits sur moi, et j’enrage. N’écoutez rien de ce qu’ils prétendront. Ne vous fiez pas à mes ennemis, encore moins à mes amis. Détournez-vous de ceux qui diront m’avoir connu. Personne n’a jamais été dans mon ventre, personne. Si je parle aujourd’hui c’est parce que je suis le seul à pouvoir dire la vérité. Parce qu’après moi j’espère le silence. » En 2006, alors que sa collaboration avec les services secrets anglais a été révélée, Tyrone Meehan décide de s’expliquer. Il est revenu dans son village natal de Killybegs pour attendre la mort. Il sait qu’il va être exécuté, pas par l’IRA qui a déposé les armes, mais par d’autres, ennemis ou amis.
Sa vie commence dans le petit village de Killybegs au milieu d’une famille nombreuse et d’un père brutal. Un père que Tyrone admire néanmoins pour son amour immodéré de son pays et son courage à le défendre. L’Irlande est toute la vie de Patraig Meehan et il en sera de même pour son fils Tyrone. Ce dernier rejoint l’IRA dès l’âge de 16 ans. Il est de tous les combats, il est mis en prison à de nombreuses reprises sans charge ni procès. Il y est torturé, il y rencontre des frères d’armes comme Bobby Sands. Tyrone Meehan a dédié sa vie à l’Irlande et pourtant un jour il accepte de donner des renseignements au MI5. Pourquoi ?
En 2008, Sorj Chalandon avait écrit « Mon traître » où un luthier français tombait amoureux de l’Irlande, adoptait son combat et rencontrait Tyrone Meehan. « Mon traître » racontait la stupéfaction du français face à la découverte de la trahison de son ami. L’histoire était inspirée de faits réels. Sorj Chalandon a couvert les conflits irlandais en tant de journaliste. Il s’y fait un ami, un frère, Denis Donaldson, qui s’avéra être un traître.
Dans « Retour à Killybegs », Sorj Chalandon poursuit le deuil de son ami et de sa relation avec lui. Il veut faire entendre la voix du traître pour tenter de comprendre. Un homme ne naît ni traître, ni héros, les circonstances l’amènent à choisir son camp. Là c’est la lassitude qui fait baisser les bras de Tyrone Meehan. Sorj Chalandon nous rappelle la violence, la dureté des combats menés : les tortures en prison, les grèves de la faim et de l’hygiène, la présence de l’armée britannique dans les rues, la misère. Tyrone Meehan porte le poids de toute cette souffrance depuis l’enfance et il finit par céder face au chantage des agents de sa majesté. Ce qui est frappant c’est la perversité du gouvernement britannique. Alors que le processus de paix est enclenché, il donne le nom des traîtres pour que la méfiance s’insinue dans le Sinn Féin. Il fallait casser la dynamique de ce parti qui était en passe de devenir le 1er en Irlande. Totalement écœurant comme le reste de leur politique menée avant le cessez-le-feu.
« Retour à Killybegs » est un roman très émouvant sans être dans le pathos. On veut comprendre Tyrone Meehan, on aimerait lui pardonner, on aimerait qu’il ne soit pas tombé dans le piège des britanniques. Sorj Chalandon rend un hommage vibrant et plein d’humanité à son ami, à son combat et à la complexité de l’âme humaine.


































