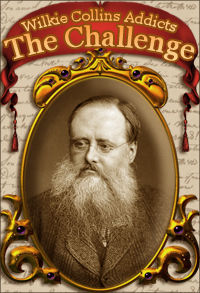Avec « La vie mode d’emploi », Georges Perec a réalisé un véritable tour de force littéraire. Rien d’étonnant pour ce membre de l’Oulipo (OUvroir de LIttérature POtentielle), mouvement littéraire (bien qu’il s’en défende) expérimental qui se propose d’écrire en s’inventant des contraintes, bien souvent fondées sur des problèmes mathématiques, faisant de l’auteur oulipien « un rat qui construit lui-même le labyrinthe dont il se propose de sortir ». Fondé par Raymond Queneau et par un mathématicien, Marcel Duchamp et Italo Calvino, pour les plus connus, en ont également fait partie.
Perec décrit un immeuble parisien de huit étages, au 11 rue Simon-Crubellier dans le 17ème arrondissement, tel qu’il se présente le 23 juin 1975 à huit heures du soir. Comme si la façade en avait été retirée et que son intérieur se dévoile à nos yeux, Perec nous raconte ce qu’il y voit à cet instant précis. Tout, des caves aux combles, en passant par le hall d’entrée, les escaliers et chaque pièce de chaque appartement, y passe : décoration, sols, meubles, tableaux, livres, le moindre objet, mais aussi les personnes qui s’y trouvent, leur physique, comment elles sont habillées, ce qu’elles font, leur attitude, tout est méticuleusement décrit. Mais fort heureusement pour le lecteur, cet inventaire maniaque alterne avec l’histoire de ses habitants actuels et de ceux qui les ont précédés. On trouve ainsi des nantis et des pauvres, des antiquaires, un médecin, une ancienne cantatrice, un artisan, un producteur de télévision, un expert international, un peintre, un chimiste, une concierge, un serveur, des domestiques, des retraités, et bien d’autres encore. Leur histoire personnelle ou celle de leurs ancêtres, l’évocation de leurs relations conflictuelles, amicales, amoureuses ou professionnelles se mêlent à des anecdotes, des légendes ou autres fictions tirées de livres ou de tableaux imaginaires, ou bien encore de l’esprit des personnages. Le sous-titre du livre, romans (vous avez noté le pluriel) s’en trouve pleinement justifié, tant les récits qui le composent sont nombreux.
Perec fait également référence à tous ces jeux de l’esprit chers aux oulipiens : échecs, énigmes, devinettes, rébus, jeux de mots, anagrammes, mots croisés, puzzle. Ce dernier offre d’ailleurs une métaphore utile à « La vie mode d’emploi » : comme les pièces au départ éparses du puzzle, toutes les histoires éparses, tous ces romans dans le roman, une fois assemblés, reliés les uns aux autres, finissent par composer un tableau d’ensemble qui donne alors son sens à chacun des éléments. Le puzzle achevé, c’est la vie d’un immeuble et de ses habitants depuis sa fondation en 1875 jusqu’à ce jour de juin 1975, les pièces, ce sont les hommes, les femmes, les animaux, les objets, les évènements, l’imaginaire, les actions, les pensées, toutes choses qui constituent la vie même.
On sent que Perec s’est beaucoup amusé avec cette œuvre monumentale, érudite et unique. Le jeu n’est-il pas, d’ailleurs, au cœur même du principe oulipien ? Cette lecture reste toutefois exigeante, on peut se perdre dans cette succession d’histoires et la pléthore de personnages. Mais cela vaut la peine de s’accrocher car on en sort avec la sensation d’avoir embrassé la totalité de la vie.
P.S. : sur le cahier des charges (les fameuses contraintes) qui ont présidé à la composition du texte (l’ordre des chapitres, les éléments, évènements, objets, personnages, histoires, etc. qu’ils doivent contenir), et pour ceux que ça intéresse, cliquez ici.
 4/4 : Challenge terminé aussi !
4/4 : Challenge terminé aussi !