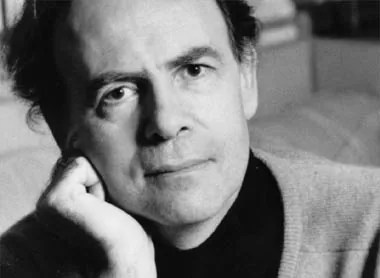« Si vous croyez, ami lecteur, découvrir dans cette introduction le prélude à une sorte de roman, vous ne vous serez jamais aussi lourdement trompé. Vous attendez-vous à du sentiment, de la poésie ou du rêve ? Espérez-vous de la passion, du mouvement, du mélodrame ? Ne vous emballez pas trop vite. Quelque chose de réel, de froid, de solide se présente à vous, quelque chose d’aussi peu romanesque qu’un lundi matin, lorsqu’on s’éveille avec la conscience qu’il va falloir reprendre le collier. »
« Shirley » est en effet la participation de Charlotte Brontë au courant des romans industriels de l’époque victorienne. Le roman s’ouvre sur la lutte qui oppose Robert Moore aux ouvriers de sa filature. Ces derniers refusent les machines modernes qui, forcément, vont les mettre au chômage. Les ouvriers veulent détruire toutes les machines arrivant dans les usines. Le roman de Charlotte Brontë se situe en 1811-1812 au moment des violentes révoltes ouvrières, mouvement appelé luddisme, du nom de John Ludd ouvrier ayant détruit des métiers à tisser en 1780. S’inspirant de ce personnage, les ouvriers sabotent les tentatives de « modernisation » des usines. Robert Moore voit ses machines détruites par des hommes du village qui craignent la misère. Notre héros est détesté de tous à cause de ses machines mais également car il est étranger. Venant des Flandres, Robert veut à tout prix réussir et effacer la honte de la ruine familiale. Cette idée l’obsède, le préoccupe à tel point qu’il ne se rend pas compte de la pauvreté qui l’entoure. Il est hautain avec les ouvriers, ne comprend rien à leur révolte. Mais fort heureusement Robert Moore est un coeur honnête qui ne demande qu’à s’ouvrir aux autres. Car, malgré son désir de s’éloigner du romantisme avec « Shirley », Charlotte n’est pas une Brontë pour rien et le romantisme prend rapidement le pas sur le roman industriel. C’est donc l’amour qui va rendre meilleur Robert Moore et qui est le centre du roman.
L’histoire se concentre sur deux jeunes filles : Caroline Helstone et Shirley Keedar. La première est la nièce du pasteur Helstone, elle est orpheline et ne possède aucun bien. Caroline est éperdument amoureuse de Robert Moore qui est trop occupé par sa filature pour s’en apercevoir. Elle incarne totalement l’héroïne romantique puisqu’elle se meurt littéralement d’amour. « Elle dépérissait, perdait sa gaieté et pâlissait de jour en jour. Le nom de Robert Moore l’obsédait comme une mélopée. Sans trêve, l’élégie du passé chantait à ses oreilles : les débris de son rêve détruit passaient, de plus en plus lourds, sur sa jeunesse ardente qui se pétrifiait lentement, comme si l’hiver envahissait peu à peu son printemps et enserrait dans la stagnation stérile de ses glaces, ses trésors les plus purs qu’elle recelait en elle. » Mais Caroline n’est pas qu’un coeur en souffrance, elle est aussi une jeune femme moderne. Elle soutient et comprend les ouvriers. Elle tente tout le long du roman d’adoucir les positions de Robert envers les pauvres. Sa condition sociale l’aide probablement à se sentir proche des démunis. Caroline est très consciente de sa position et elle compte y remédier en devenant préceptrice. Tout son entourage rejette cette idée mais la jeune femme souhaite devenir maîtresse de son destin.
Shirley Keedar est également un personnage très moderne. Elle est propriétaire terrienne et la filature de Robert Moore se trouve sur ses terres. Shirley est une jeune femme riche mais elle ne se contente pas du revenu de ses terres, elle aide Moore à gérer la filature. C’est un personnage extrêmement énergique, entier et attirant le respect par son charisme et son courage physique. Elle agit de même dans sa vie privée puisqu’elle refuse tous les riches prétendants proposés par son oncle. Shirley choisira son mari selon son coeur et non selon les diktats de la société. Il est bien entendu plus facile pour Shirley d’être indépendante puisqu’elle jouit de hauts revenus. La timide et discrète Caroline n’en est que plus méritante dans son envie d’indépendance.
« Shirley » n’est sans doute pas le meilleur des romans industriels, j’ai préféré celui de Elizabeth Gaskell qui d’ailleurs sera la biographe de Charlotte Brontë. Il n’en reste pas moins que ce roman est fort plaisant. Il dresse le portrait de deux jeunes femmes voulant suivre leurs aspirations, leurs désirs sans se plier aux volontés de leurs proches. Cette modernité des personnages m’a séduite et j’y retrouve un des thèmes privilégiés des soeurs Brontë. Contrairement à l’avertissement de départ, Charlotte a bien écrit un roman d’amour mais ce sont les femmes qui y mènent la danse et qui choisissent leurs maris ! La force du désir triomphe pour notre plus grand plaisir.
Lu avec Isil dans le cadre de notre club de lecture.



 Edith Wharton est celle qui me vient toujours en premier lorsque je pense à mes écrivains préférés. « Le temps de l’innocence », « Chez les heureux du monde » et « Ethan Frome » font partie de mes romans favoris. J’aime son univers, son écriture, sa modernité et la délicatesse des sentiments qu’elle décrit. Edith Wharton c’est également une ville : New York qui me fascine et c’est l’un des écrivains qui en parle le mieux.
Edith Wharton est celle qui me vient toujours en premier lorsque je pense à mes écrivains préférés. « Le temps de l’innocence », « Chez les heureux du monde » et « Ethan Frome » font partie de mes romans favoris. J’aime son univers, son écriture, sa modernité et la délicatesse des sentiments qu’elle décrit. Edith Wharton c’est également une ville : New York qui me fascine et c’est l’un des écrivains qui en parle le mieux. Dans mon esprit Edith Wharton ne va pas sans son cher maître Henry James. J’ai découvert ces deux auteurs en même temps et je suis totalement tombée sous le charme de l’un et de l’autre. Henry James a l’art des grandes fresques romanesques, il m’emporte totalement et j’apprécie tout particulièrement ses comparaisons entre l’Amérique et la vieille Europe qu’il aimait tant.
Dans mon esprit Edith Wharton ne va pas sans son cher maître Henry James. J’ai découvert ces deux auteurs en même temps et je suis totalement tombée sous le charme de l’un et de l’autre. Henry James a l’art des grandes fresques romanesques, il m’emporte totalement et j’apprécie tout particulièrement ses comparaisons entre l’Amérique et la vieille Europe qu’il aimait tant. Ah Marcel Proust… J’ai toujours su que j’aimerais l’univers de Proust et ça s’est confirmé à la lecture. J’aime son écriture envoûtante, sa culture pléthorique, son humour et son auto-dérision. Il ne me reste plus que deux tomes à lire et je sens qu’il va me manquer une fois « La recherche du temps perdu » achevée !
Ah Marcel Proust… J’ai toujours su que j’aimerais l’univers de Proust et ça s’est confirmé à la lecture. J’aime son écriture envoûtante, sa culture pléthorique, son humour et son auto-dérision. Il ne me reste plus que deux tomes à lire et je sens qu’il va me manquer une fois « La recherche du temps perdu » achevée !