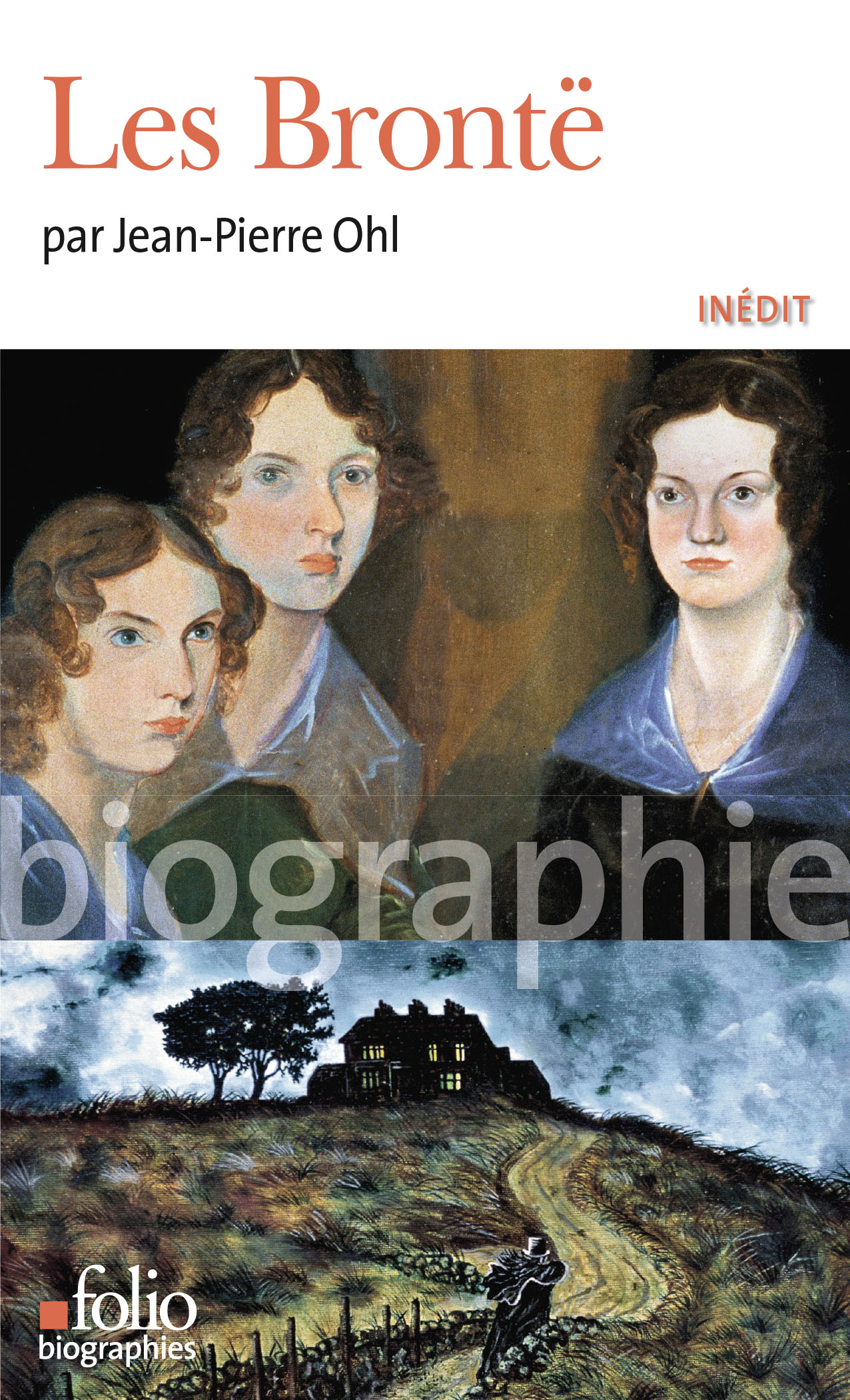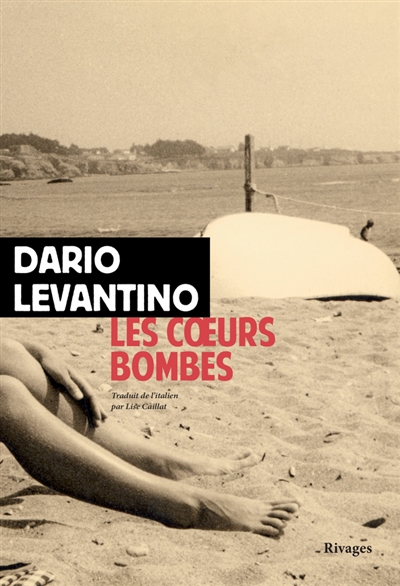Sept livres et une bande dessinée m’ont accompagnée durant ce mois de juillet. Vous pouvez déjà lire mes avis sur le second roman de Benjamin Stevenson qui réjouira les amateurs d’Agatha Christie, sur le premier roman d’Anita Brookner qui est en partie autobiographique et parle de sa jeunesse et de ses débuts dans l’âge adulte, sur le flamboyant « Senso » de Camillo Boito et sur la délicieuse bande dessinée d’Edith adaptée d’un classique de la littérature jeunesse anglaise. Je vous parle très bientôt de « La disparition de Chandra Levy » de Hélène Coutard qui fait partie de la collection True crime de 10/18 et Society, de « L’amour comme par hasard » de Eva Rice, de la biographie des sœurs Brontë par Jean-Pierre Ohl que j’ai relue en prévision de mes vacances dans le Yorkshire et du dernier roman traduit de Margaret Kennedy « Les oracles ».
J’ai également pu voir sept films en juillet dont voici mes deux préférés :

Des hommes épuisés, hébétés sont sortis d’un camion en plein désert. Ils viennent de sortir de la prison de Saidnaya en Syrie où ils ont été torturés. Deux ans après, on retrouve l’un d’eux à Strasbourg. Hamid travaille sur des chantiers. Mais sur son temps libre, il cherche un homme et tente de le retrouver en montrant sa photo dans les foyers de réfugiés, les restaurants syriens. Il pense le reconnaître et se met à le suivre. Hamid fait en fait partie d’un réseau qui poursuit les criminels syriens cachés en Europe. Mais comment être certain de ne pas faire d’erreur sur l’identité de son bourreau alors que l’on avait toujours les yeux bandés ?
« Les fantômes » est le premier film, remarquable, de Jonathan Millet. Venant du documentaire, il s’est beaucoup renseigné sur ces cellules de recherche de criminels ce qui donne beaucoup de solidité et de justesse à l’histoire d’Hamid. Comme dans un film d’espionnage, l’atmosphère est extrêmement tendue, lancinante. Le personnage d’Hamid y contribue, son visage fermé et buté ne laisse transparaître aucune émotion. Pour nous laisser percevoir malgré tout la souffrance profonde, la solitude du personnage, il fallait un acteur exceptionnel et Jonathan Millet l’a trouvé avec Adam Bessa, incroyablement magnétique. Inquiétant, troublant, tendu, « Les fantômes » est un grand film.

Après la mort de son mari policier lors d’une émeute, Santosh se voit offrir la possibilité de récupérer son poste puisqu’elle n’a ni travail ni enfant. Sa belle famille ne voulant pas entendre parler d’elle, elle n’a pas le choix et endosse les habits de policier. Elle va découvrir une institution corrompue et extrêmement machiste. Sa situation s’améliore un peu quand une commissaire prend la tête de l’équipe où travaille Santosh. Les deux femmes vont bientôt s’épauler lorsque le corps d’une jeune fille dalit, une communauté très pauvre et déclassée, est retrouvée dans un puit. Elle a été violée et assassinée.
Le premier film de Sandhya Suri est passionnant dans son analyse de la société indienne. Les personnages évoluent dans une zone rurale sous une chaleur accablante. La violence qui règne entre les différentes castes est très prégnante. Tout le monde se fiche de la jeune fille assassinée, seule Santosh s’obstine à vouloir faire la lumière sur cette affaire. Le mépris, l’intolérance entre les religions, la misogynie seront des freins dans son travail. Santosh et sa supérieure sont des personnages fascinants d’ambiguïté. La première se révèle une excellente policière à l’instinct sûr mais capable aussi d’une grande violence. La deuxième, sous couvert de défendre le droit des femmes, est capable d’avaler les pires couleuvres. « Santosh » est un thriller social, très réussi, qui nous montre la brutalité et l’inégalité de la société indienne.
Et sinon :
- « Vice-versa 2 » de Kelsey Mann : Nous avions suivi le quotidien de la jeune Riley dans le premier « Vice-versa » et nous la retrouvons adolescente cette fois. De nouvelles émotions s’ajoutent à sa personnalité : Anxiété, Embarras, Envie et Ennui ( qui a un accent français en vo !). Les sautes d’humeur de Riley se multiplient, l’envie de grandir et d’être prise au sérieux s’imposent. L’adolescente s’inscrit dans un stage de hockey sur glace participant aux sélections pour l’année suivante. Elle veut impressionner les filles plus âgées et leur coach, tant pis si cela doit la brouiller avec ses meilleures amies. Dans son cerveau, c’est Anxiété qui prend les commandes, expulsant bien loin Joie, Colère, Peur et Dégoût. Les studios Pixar réussissent parfaitement ce deuxième volet, le récit d’apprentissage de Riley se poursuit avec toujours autant de talent. L’adolescence, ce moment douloureux du passage de l’enfance à l’âge adulte, faite d’exaltation et de volonté d’intégration dans un groupe, est bien captée Les anciennes et les nouvelles émotions doivent apprendre à cohabiter et c’est toujours aussi drôle et touchant.
- « Gondola » de Veit Helmer : Employées d’un téléphérique reliant deux vallées géorgiennes, Iva et Nino se croisent plusieurs fois par jour dans les airs. Pour se séduire, elles commencent à s’envoyer des fruits en plein air, pour ensuite transformer leur cabine de manière de plus en plus perfectionnée : bateau, fusée, avion, etc… Elles s’offrent également des concerts suspendus. Le film de Veit Helmer est sans parole et d’une fantaisie poétique. Les deux amoureuses font preuve d’une créativité folle pour émerveiller l’autre et cela nous enchante. Les deux actrices, Mathilde Irrman et Nino Soselia, sont expressives, délicieuses de malice. Un film sans prétention, original et plein de charme.
- « El professor » de Maria Alché et Benjamin Naishtat : Marcelo est enseignant de philosophie à l’université de Puan. Lorsque son mentor décède, il est logiquement pressenti pour le remplacer. Mais le retour au pays du très populaire Rafael, qui enseignait en Allemagne, va compliquer la vie de notre héros. Maria Alché et Benjamin Naishtat nous offre un personnage très attachant, loin de l’image solennelle et sérieuse des professeurs d’université. Marcelo n’est pas sûr de lui en dehors de ses cours, il est maladroit (sa rencontre avec une couche de bébé usagée est mémorable). Il faut dire que son statut économique est précaire. Il doit trouver d’autres moyens de subsistance comme donner des cours à une vieille femme riche qui s’endort en l’écoutant. Devoir prouver sa valeur face à Rafael permettra à Marcelo de reconsidérer ses schémas de pensée et de s’ouvrir au monde. En passant, les deux réalisateurs nous montrent à quel point l’université n’est pas un lieu sanctuarisé en Argentine et cela n’a pas du s’arranger depuis l’élection de Javier Milei.
- « Juliette au printemps » de Blandine Lenoir : Juliette a trente ans et elle se remet tout juste d’une dépression. Elle part se réfugier dans la petite ville de son enfance où vivent toujours ses parents divorcés et sa sœur. Son père s’enferme dans sa solitude, sa mère s’est mise à peindre des tableaux érotiques et sa sœur, qui s’ennuie avec son mari, a pris un amant qui se déguise en lapin géant pour venir la voir. Pas sûr que ce soit le meilleur environnement pour que Juliette aille mieux. Le film de Blandine Lenoir est l’adaptation de la délicate bande dessinée de Camille Jourdy. Le point fort du film est son casting : Izia Igelin incarne l’héroïne, Jean-Pierre Darroussin en papa poule maladroit, Noémie Lovsky toujours parfaite en personnage fantasque, Sophie Guillemin en grand sœur fatiguée en quête de distraction. Le film oscille entre humour et émotion tout en restant un peu sage.
- « Le comte de Monte Christo » de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière : Comme « Les trois mousquetaires » précédemment, le destin d’Edmond Dantès fait encore l’objet d’une adaptation, à croire qu’il n’y a pas d’autres romans d’aventures dans la littérature française. N’ayant toujours pas lu le roman, je ne jugerai bien entendu pas la fidélité de l’intrigue. Le film dure 2h58 et il faut reconnaître que l’on ne s’ennuie pas et que les rebondissements s’enchaînent sans temps mort. Le casting est un atout essentiel, Pierre Niney s’en sort fort bien, les méchants (Bastien Bouillon, Laurent Lafitte et Patrick Mille) sont détestables à souhait, Anaïs Demoustier et Anamaria Vartolomei sont parfaites et émouvantes. « Le comte de Monte Christo » est un divertissement de qualité qui souffre néanmoins d’une musique et de mouvement de caméra grandiloquents.