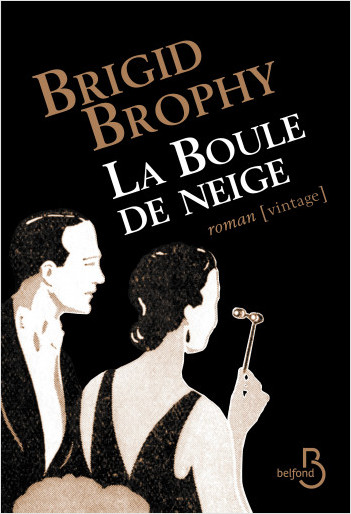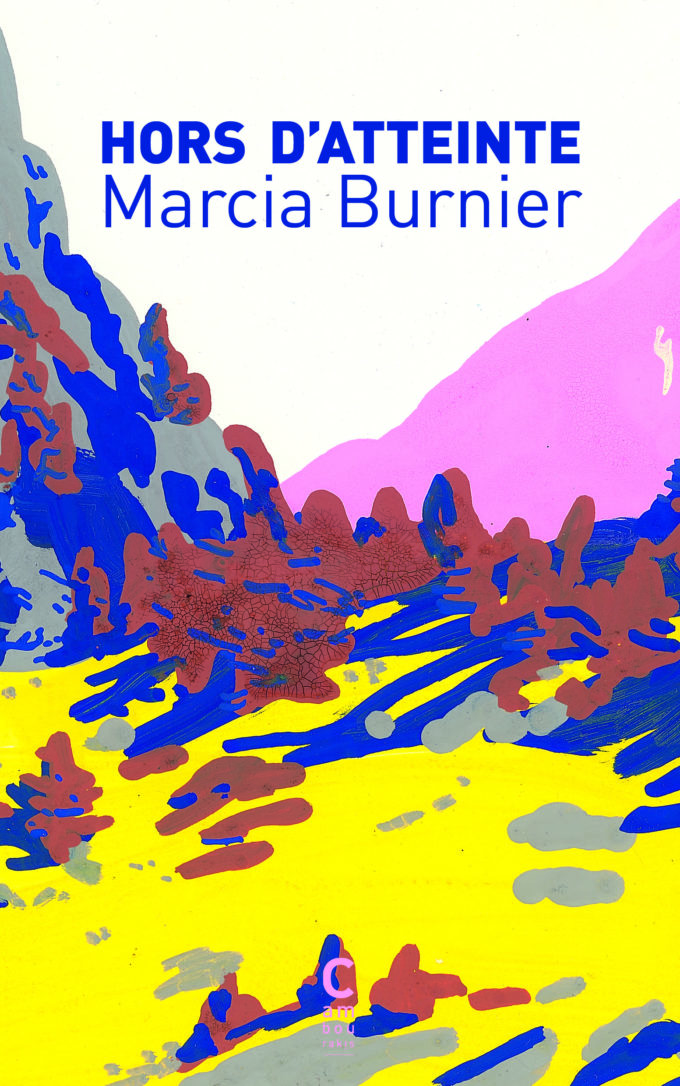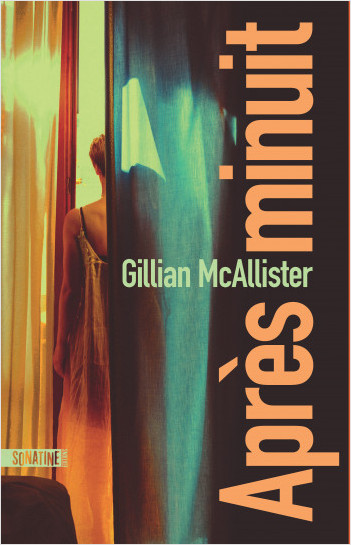Le mois d’avril s’achève et il fut bien rempli avec sept livres et trois bandes dessinées. Je vous ai déjà parlé de ma déception concernant « La boule de neige » et de mon ravissement à la lecture de « Rose à l’île ». Même si je n’en ferai pas la chronique, je vous conseille la série des Paul de Michel Rabagliati et le charmant dernier album de Camille Jourdy « Pépin et Olivia ». J’ai eu un grand plaisir à lire « Qui a écrit Trixie ? » de William Caine, un roman satirique très réussi sur la société anglaise, « Janvier noir » le premier volet de la série très sombre d’Alan Parks, « Le sang des innocents » le dernier roman de S.A. Cosby que je souhaitais découvrir depuis longtemps, « Mon fils, mon désastre » sur la relation de Suzanne Valadon et de son fils Maurice Utrillo et « Katie » de Michael McDowell qui nous offre un nouveau roman réjouissant, populaire et sanguinolent !
Côté cinéma, voici mes films préférés du mois :

Deuxième volet de la trilogie de Nicolas Philibert, « Averroès & Rosa Parks » s’intéresse à deux unités de l’hôpital Esquirol dans le Val-de-Marne. Nous assistons aux entretiens entre les patients et leurs psychiatres mais aussi à des séances de groupes où l’on peut discuter ensemble de sujets divers et de ce qui pourrait être amélioré à l’hôpital. Certains patients nous sont connus puisque nous les avions croisés sur la péniche l’Adamant. Ici, les situations sont plus lourdes, plus violentes. L’Adamant est un lieu où la créativité peut s’exprimer, où l’on participe à des activités ludiques. A l’hôpital, on sent les situations plus désespérées comme cette femme âgée atteinte d’une psychose paranoïaque effrayante. Certains ont été enfermés toute leur vie, ont des moments de lucidité sur leur situation et celle de l’hôpital. Et c’est également cela que montre le film, une psychiatrie qui manque de moyens financiers et humains pour accompagner mieux les malades. Beaucoup aimerait plus de tendresse de la part des soignants qui sont bien entendu débordés. Les psychiatres, comme Nicolas Philibert, montrent de l’empathie, une infinie patience et une écoute infaillible. Le film dure 2h23 et on en redemande ! Admirable d’humanisme et de sens du partage, « Averroès & Rosa Parks » est un documentaire à ne pas rater !

Surveillante de prison, Mélissa quitte la région parisienne pour la prison de Borgo, près de Bastia. Elle prend la prime insulaire pour repartir à zéro avec son mari Djibril et leurs deux enfants. En prison, Mélissa, surnommée rapidement Ibiza, sait se faire respecter tout en restant humaine et attentive aux besoins des prisonniers. En dehors, la vie quotidienne est difficile. Djibril galère à trouver du travail et il subit le racisme des voisins. Les retrouvailles de Mélissa avec un jeune détenu, Saveriu, vont bizarrement arranger tout. La jeune femme ne se rend pas compte qu’elle vient de mettre les doigts dans un terrible engrenage.
Le nouveau film de Stéphane Demoustier est un formidable thriller, extrêmement tendu. Petit à petit, Mélissa est prise au piège des tentacules de la pieuvre mafieuse. Insidieusement, elle pénètre dans sa vie alors que la matonne pensait seulement rendre service. Le film est également très bien construit. En parallèle de la vie de Mélissa se déroule une enquête sur un double assassinat à l’aéroport dont on ne prendra la mesure qu’à la fin. « Borgo » est porté par la talentueuse Hafsia Herzi qui rend son personnage troublant, ambigu, insaisissable au fur et à mesure que l’intrigue avance.
Et sinon :
- « La machine à écrire et autres sources de tracas » de Nicolas Philibert : Ce film clôt le triptyque documentaire de Nicolas Philibert sur le pôle psychiatrique de Paris-Centre. Après l’Adamant et l’hôpital Esquirol, nous pénétrons dans les chambres, les appartements des patients. Nicolas Philibert suit des soignants qui ne se contentent pas de soigner les âmes mais qui réparent les appareils électro-ménagers. Patrice a besoin de sa machine à écrire pour taper les poèmes qu’il compose chaque jour. Muriel fait réparer son lecteur CD, sans la musique les voix dans sa tête deviennent envahissantes. Ivan a besoin de faire réparer son imprimante et de comprendre comment fonctionne son lecteur Dvd. Tout en démontant les appareils, les soignants prennent le temps de discuter, de prendre un café et de combler un peu la solitude des malades. Cas à part : Frédéric, artiste peintre qui ne jette rien et a besoin d’aide pour faire le tri pour pouvoir à nouveau circuler dans son logement ! Nous avions déjà croisé sur l’Adamant certains des malades et c’est un plaisir de les retrouver, de voir où et comment ils vivent. Comme dans les deux autres documentaires, l’humanisme et l’empathie de Nicolas Philibert rendent le film sensible et les malades touchants. Contrairement à « Averroès & Rosa Parks », il se permet d’intervenir, de participer à la convivialité de certaines scènes.
- « L’homme aux mille visages » de Sonia Kronlund : Sonia Kronlund, productrice de France Culture, avait réalisé en une émission en 2017 sur un mythomane latin-lover. Elle a ensuite enquêté pendant cinq ans sur cet homme qui a vécu plusieurs vies en même temps. Il était ingénieur chez Peugeot, chirurgien thoracique, pilote de ligne et se prénommait Ricardo, Alexander, Daniel. De France en Pologne, il a fait croire au grand amour à plusieurs femmes qui témoignent dans le documentaire. Charmeur, affable, sociable, notre latin lover plait à tout le monde avec une facilité déconcertante. L’argent, parfois les cadeaux, passent d’une femme à l’autre alimentant ainsi ses mensonges. Sonia Kronlund tente de comprendre ce qui unit, ou non, ces victimes de la passion amoureuse. Y-a-t-il un profil type pour se laisser aveugler ? La réalisatrice retrouve à la fin le mythomane et se procure une petite vengeance que l’on sent jubilatoire chez elle même si elle est teintée d’amertume.
- « Le jeu de la reine » de Karim Aïnouz : Catherine Parr fut la sixième et dernière femme d’Henri VIII, la seule à lui survivre. Cultivée, ayant des sympathies pour le protestantisme, elle méritait bien que l’on s’intéresse à elle notamment parce qu’elle fut l’une des premières femmes à publier un livre. Elle s’occupa également des enfants qu’Henri VIII eut avec ses femmes précédentes, comme s’ils étaient les siens. Le film de Karim Aïnouz est une reconstitution minutieuse de l’Angleterre du XVIème siècle et des intrigues de la cour qui craignait son roi. Violent, paranoïaque, brutal, dévoré par la gangrène, Henri VIII a de quoi faire peur et Jude Law est ici méconnaissable et extraordinaire. Alicia Vikander interprète avec grâce et dignité Catherine Parr. Le film a choisi de créer un suspens autour de la possible exécution de la reine, c’est un peu artificiel et la fin est assez absurde et décevante.
- « Le mal n’existe pas » de Ryusuke Hamaguchi : Takumi est veuf, il vit seul avec sa fille au cœur de la nature. Il est homme à tout faire, il aide la communauté en puisant de l’eau pure qui sera utilisée pour la cuisine d’un restaurant, il coupe des bûches. Sa vie semble en parfaite harmonie avec l’environnement qui l’entoure. Un projet de camping de luxe dans la région va bouleverser la vie des villageois et surtout celle de Takumi. J’avais adoré « Drive my car » et j’ai retrouvé dans « Le mal n’existe pas » la contemplation, la parole rare et précieuse, la splendeur plastique des images. La nature, les paysages sont sublimés. Le projet de camping va rompre l’équilibre, les communicants vont abreuver de mots les habitants. Deux mondes, qui s’opposent, vont rentrer en collision et provoquer un drame. Jusqu’aux dix dernières minutes, le film de Ryusuke Hamaguchi est passionnant, intrigant par son jeu avec la musique et sa puissante mélancolie. La fin du film gâche un peu l’ensemble en étant opaque et incompréhensible.