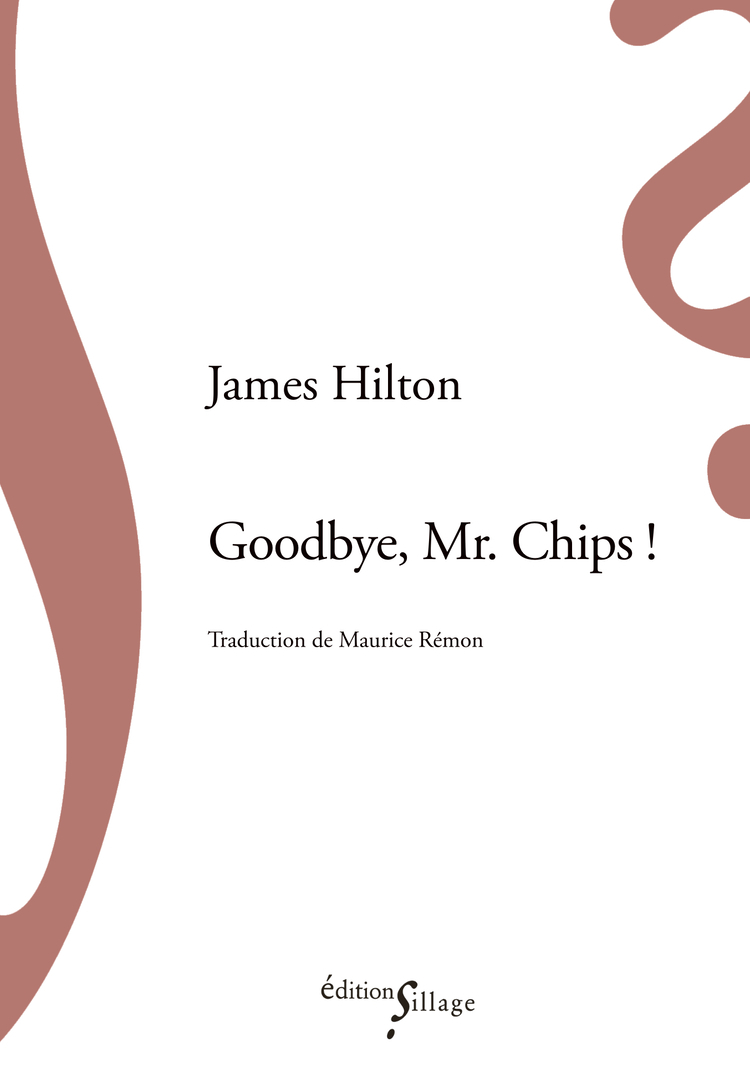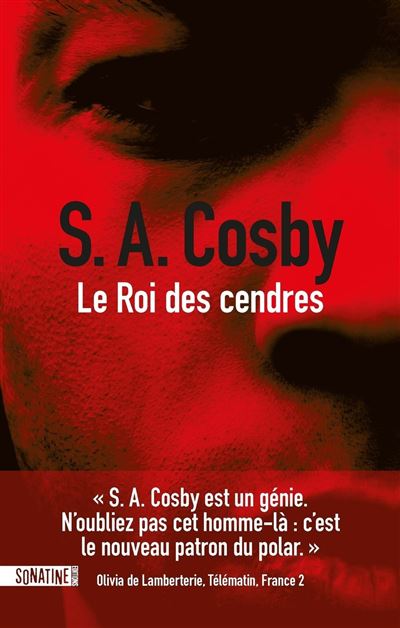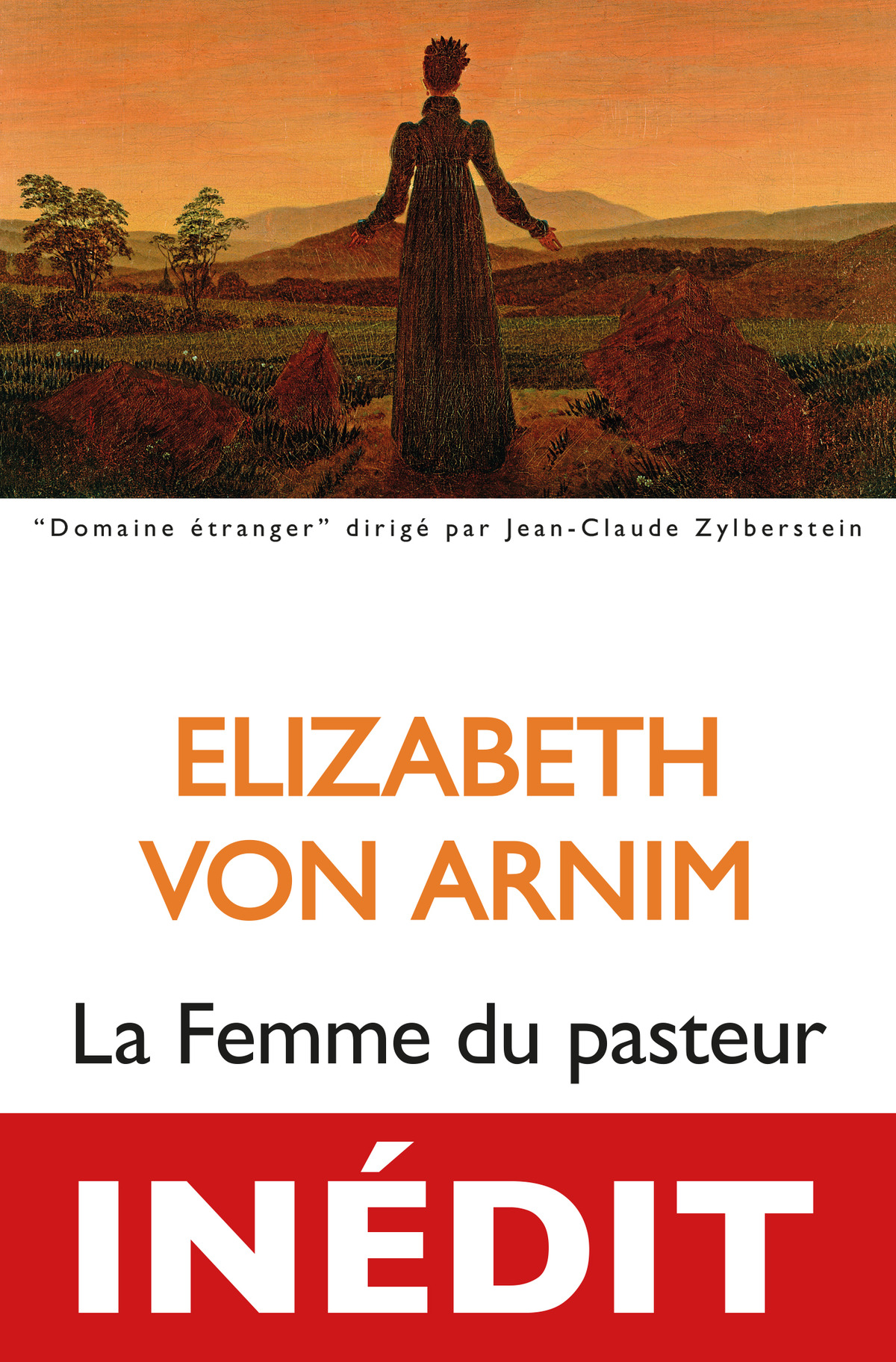Hiver est une petite fille qui vit seule avec son père dans un château glacé recouvert de mascarpone. Sa mère mourut le jour de sa naissance et elle lui laissa un coussin brodé et un coffre fermé à clef. Elle ne pourra l’ouvrir que le jour de ses douze ans. En attendant cette date, Hiver reste dans le château silencieux où son père, profondément triste, se transforme peu à peu en ours polaire.
De Fanny Ducassé, j’avais déjà eu le plaisir de lire « Rosalie et le langage des plantes » et « Un automne avec M. Henri ». « Hiver » est un récit d’apprentissage en forme de conte où une petite fille de douze ans va enfin découvrir le monde extérieur. L’histoire est infiniment poétique et originale : le nom des personnages (la marraine d’Hiver se nomme Rubis), le château recouvert de mascarpone, etc… Les dessins se déclinent en rouge et blanc et sont absolument splendides. Les détails foisonnent, même les encadrements des textes sont fins et délicats.
Le nouvel album de Fanny Ducassé est un enchantement visuel et l’histoire d’Hiver est touchante et pleine de charme.