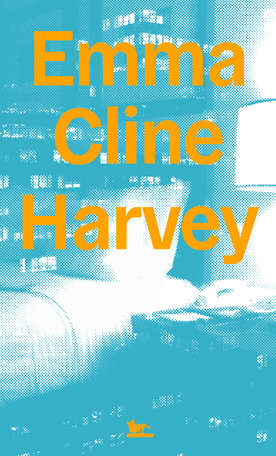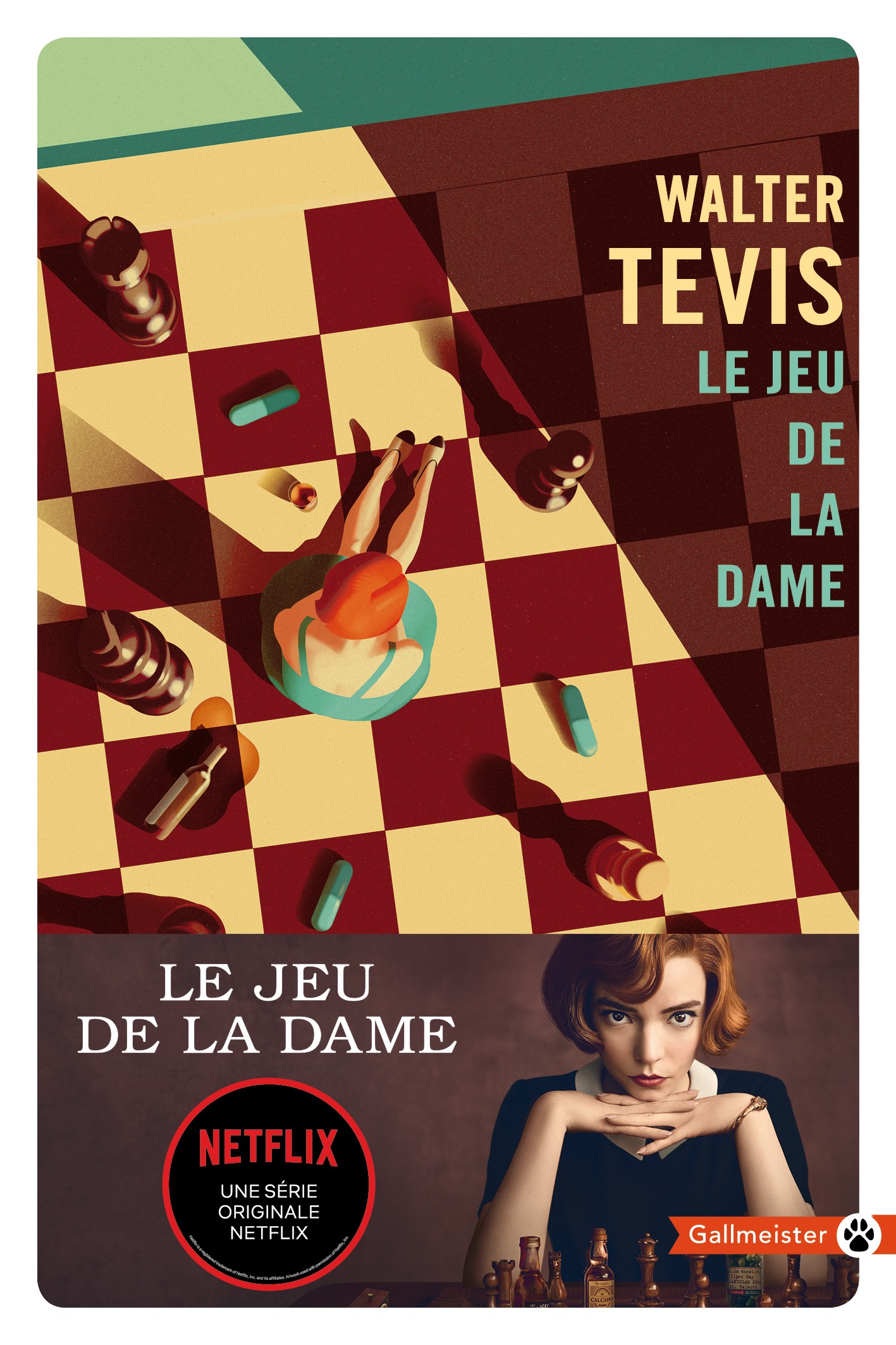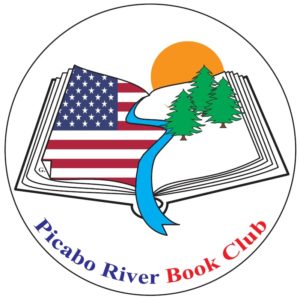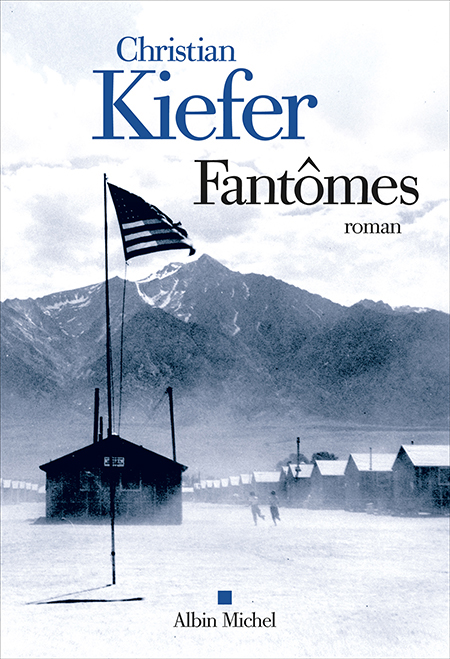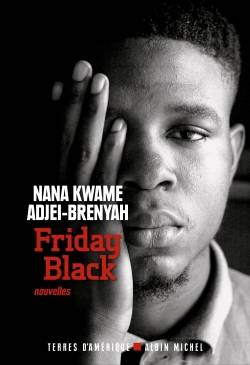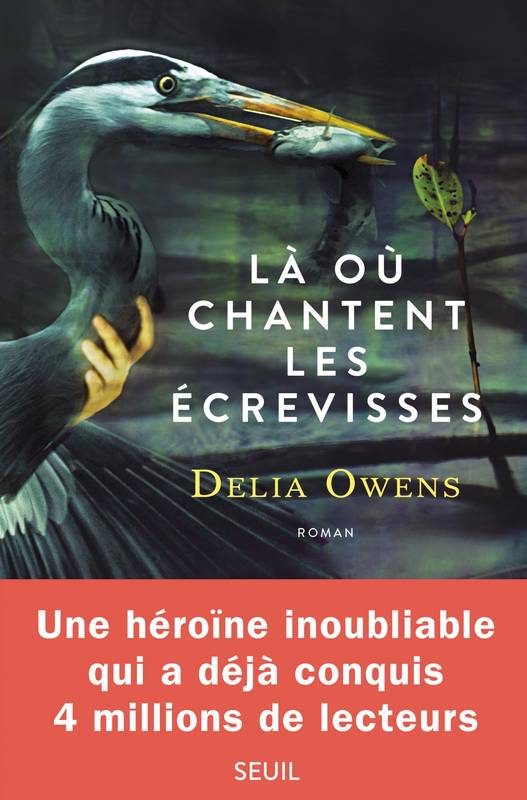Melody a 16 ans et ce soir, une fête est organisée pour célébrer son passage à l’âge adulte. Ses amis, ses parents, Iris et Aubrey, ses grands-parents maternelles, Sabe et Po’Boy, sont présents et la regardent descendre l’escalier sur la musique de Prince. Melody porte une robe blanche qui a le même âge qu’elle. Ce vêtement aurait dû être porté par sa mère lors de sa fête de 16ème anniversaire. Mais celle-ci fut annulée, Iris était alors enceinte.
« De feu et d’or » est le deuxième roman pour adultes de Jacqueline Woodson, qui a été récompensée à plusieurs reprises pour ses romans jeunesse (« Brown girl dreaming » a obtenu le National Book Award et c’est une merveille). Dans ce roman, chaque membre de la famille aura la parole à tour de rôle constituant ainsi une mosaïque de souvenirs. Jacqueline Woodson procède par petites touches et nous offre le portrait impressionniste d’une famille afro-américaine de la classe moyenne. Leur histoire, faite de lutte, d’incompréhension et de liens indéfectibles, s’inscrit dans celle plus vaste des États-Unis. Deux évènements encadrent le récit : le massacre de Tulsa de 1921 et les attentats du 11 septembre. Le premier marque profondément l’histoire des afro-américains, ce traumatisme perdure de génération en génération. Le second frappe les américains, qu’ils soient noirs ou blancs. Entre ces deux dates, Jacqueline Woodson aborde en peu de pages un grand nombre de sujets : la question de l’héritage et ce que l’on laisse à ses enfants, l’émancipation des femmes, le racisme, la classe sociale, les liens familiaux.
Lorsque j’avais lu « Un autre Brooklyn », qui était également composé de bribes de souvenirs et d’instants de vie, j’avais trouvé que les personnages manquaient de profondeur et que l’on ne réussissait pas à s’y attacher. Dans « De feu et d’or », le problème n’existe plus, l’empathie avec les différents personnages est très forte. A tel point que l’on quitte à regret Melody et sa famille en refermant le roman.
Dans un style fluide aux phrases courts, Jacqueline Woodson retrace, avec beaucoup de délicatesse et un sens aigu de l’ellipse, l’histoire d’une famille afro-américaine. Et ce qui domine, c’est l’amour qui demeure au fil des ans et malgré les tragédies.
Traduction Sylvie Schneiter