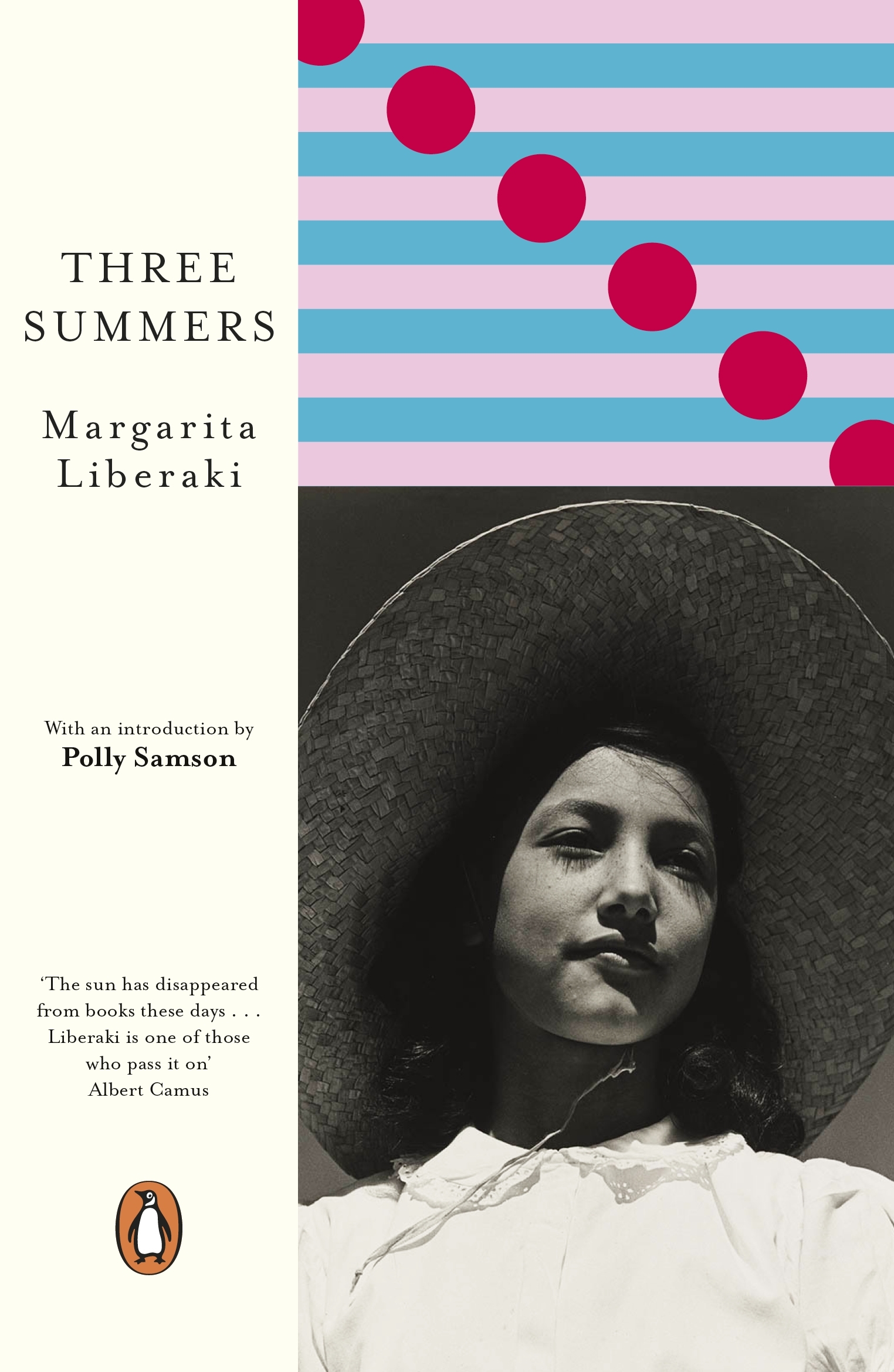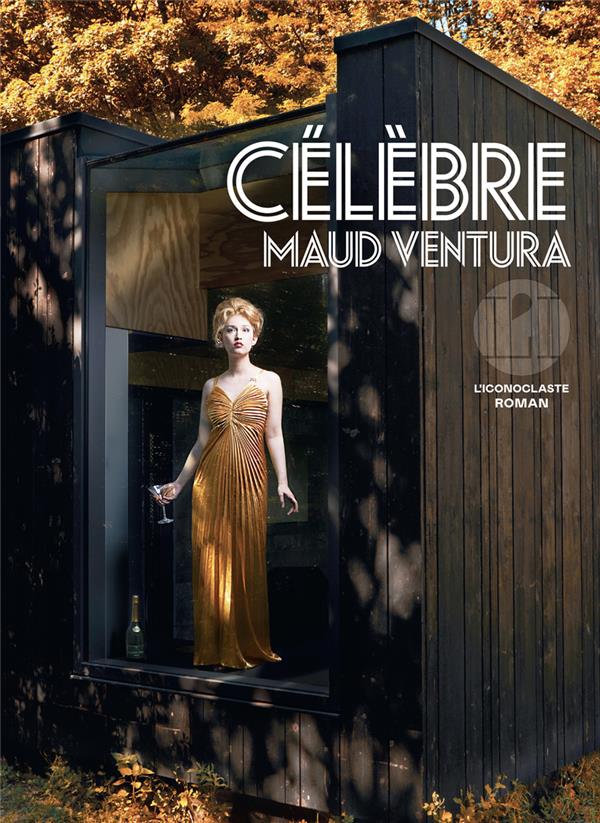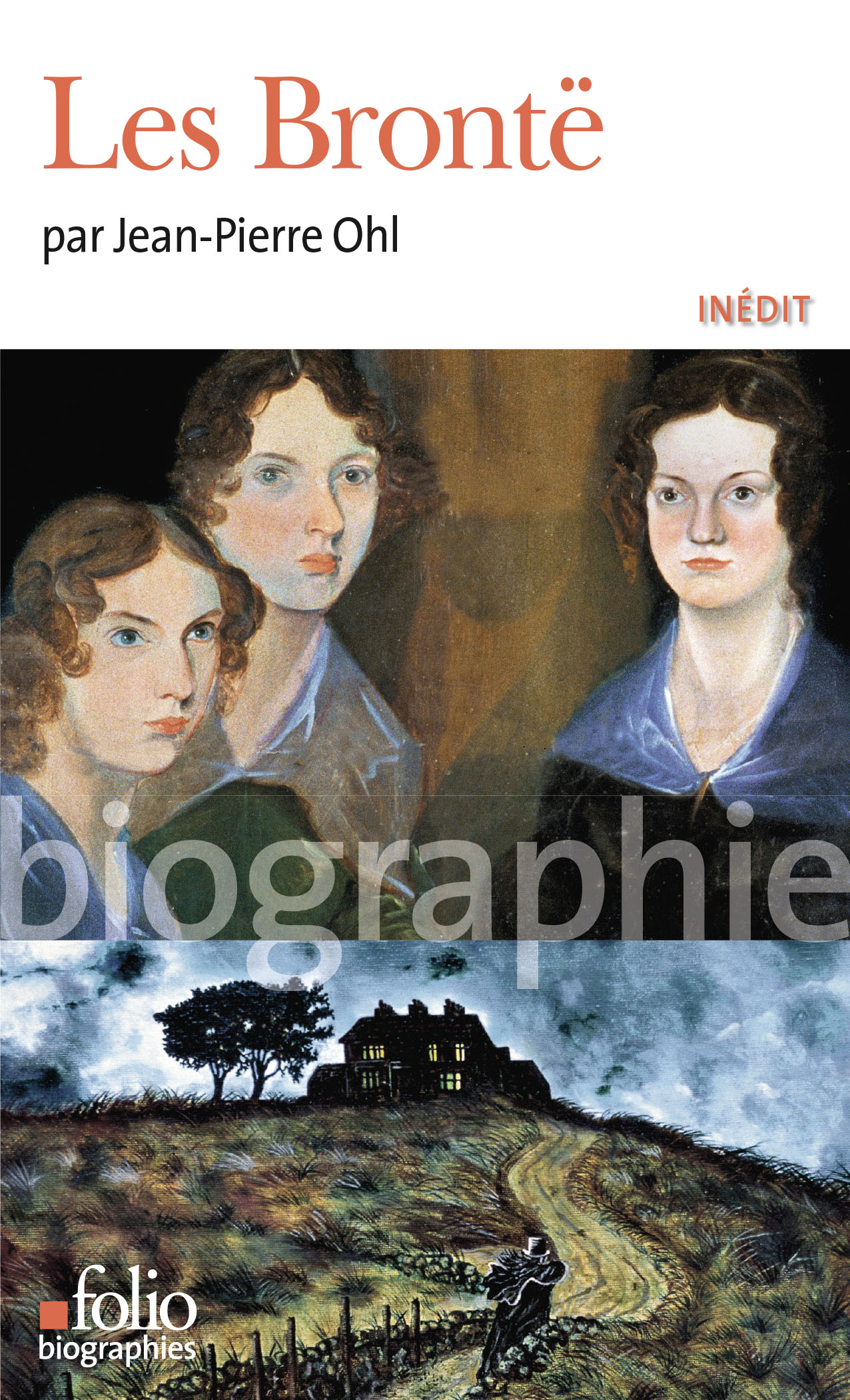Après des années à Atlanta, Toya Gardner décide de passer l’été chez sa grand-mère Vess Jones dans la petite ville de Sylva en Caroline du nord. Devenue artiste, Toya souhaite interroger les racines de sa famille et elle ne tarde pas à vouloir dénoncer l’histoire esclavagiste du comté de Jackson. Cela n’est bien entendu pas du goût d’une partie de la population qui honore toujours le passé sudiste de leurs ancêtres. Parallèlement aux actions menées par la jeune femme, Ernie Allison, adjoint au sheriff, interpelle un homme qui se balade avec un costume du Ku Klux Klan dans sa voiture et un carnet de noms de dignitaires de la région qui en seraient membres. L’insistance d’Ernie à vouloir creuser l’enquête ne plaît pas beaucoup à sa hiérarchie. Quelques semaines plus tard, deux terribles crimes vont venir assombrir le quotidien en apparence paisible des habitants de Sylva.
Dans son cinquième roman, David Joy continue à explorer son territoire, la Caroline du nord, où il est né et où il vit toujours. L’intrigue est ici parfaitement maîtrisée, haletante et elle ne cesse de nous surprendre. « Les deux visages du monde » est également une radiographie sociale de ce territoire. Toute la première partie m’a fait penser au dernier roman de S.A. Cosby, « Le sang des innocents », où la célébration du passé sudiste, symbolisé par une statue, était au cœur de l’intrigue. David Joy traite cette thématique de manière différente, sous l’angle de deux réalités qui coexistent sans se comprendre. Le titre original l’exprime d’ailleurs parfaitement : « Those we thought we knew ». Le shérif Coggins se rend compte lors des évènements que ses amis noirs, Vess Jones et son mari aujourd’hui décédé, n’ont pas du tout le même ressenti sur les années écoulées. Le shérif pensait le racisme éradiqué et voyait comme du folklore les manifestations autour du passé sudiste de Sylva. L’été, où Toya revient chez elle, va servir de révélateur pour beaucoup d’habitants de la profonde fracture qui existe toujours entre les communautés.
David Joy s’appuie, pour construire son intrigue, sur de très beaux et très forts personnages féminins comme celui de Toya, jeune femme déterminée et engagée, mais également celui de sa grand-mère Vess dont l’abnégation et le courage ne peuvent qu’émouvoir le lecteur. L’inspectrice Leah Green est également très intéressant car son enquête remettra profondément en cause sa carrière et ses convictions.
« Les deux visages du monde » est un excellent roman noir, éminemment social, parfaitement maîtrisé et qui ne cesse de surprendre son lecteur. Du très grand David Joy.
Traduction Jean-Yves Cotté