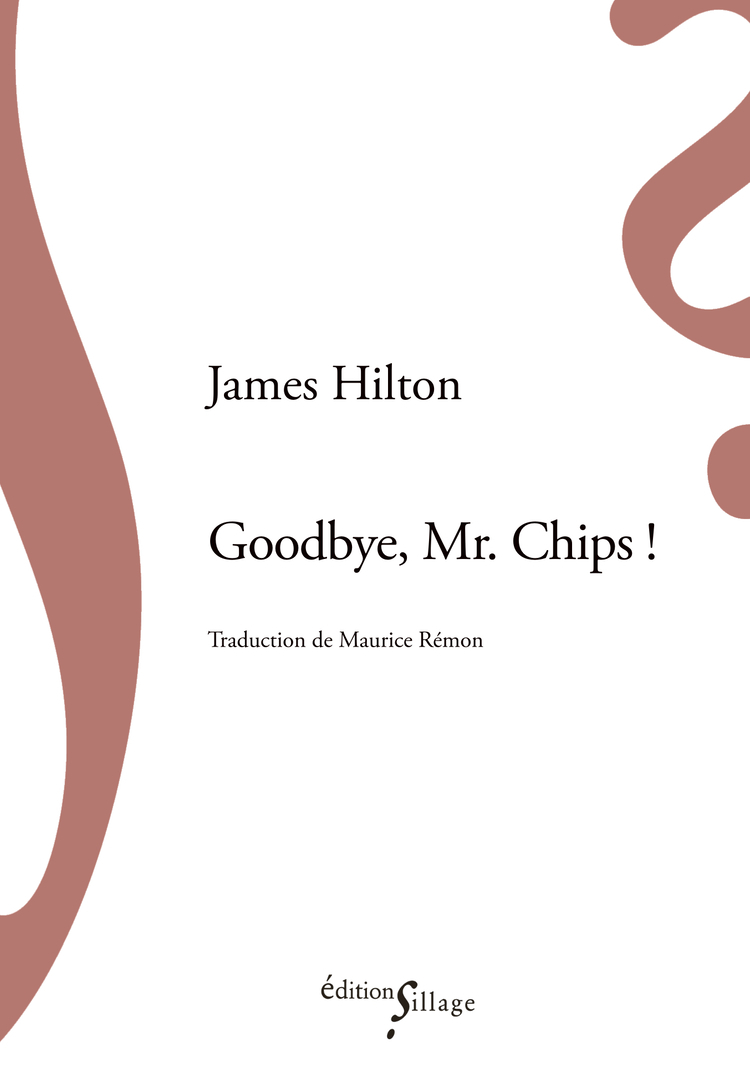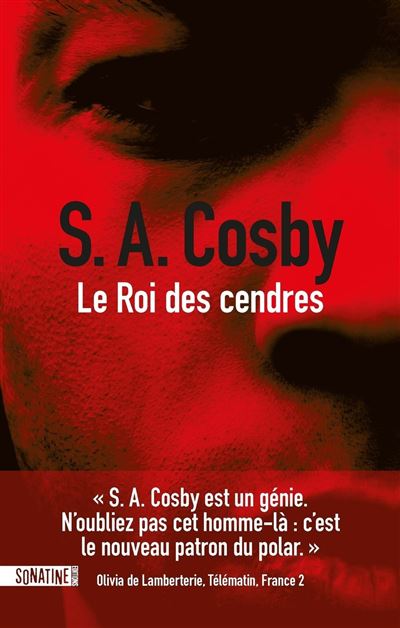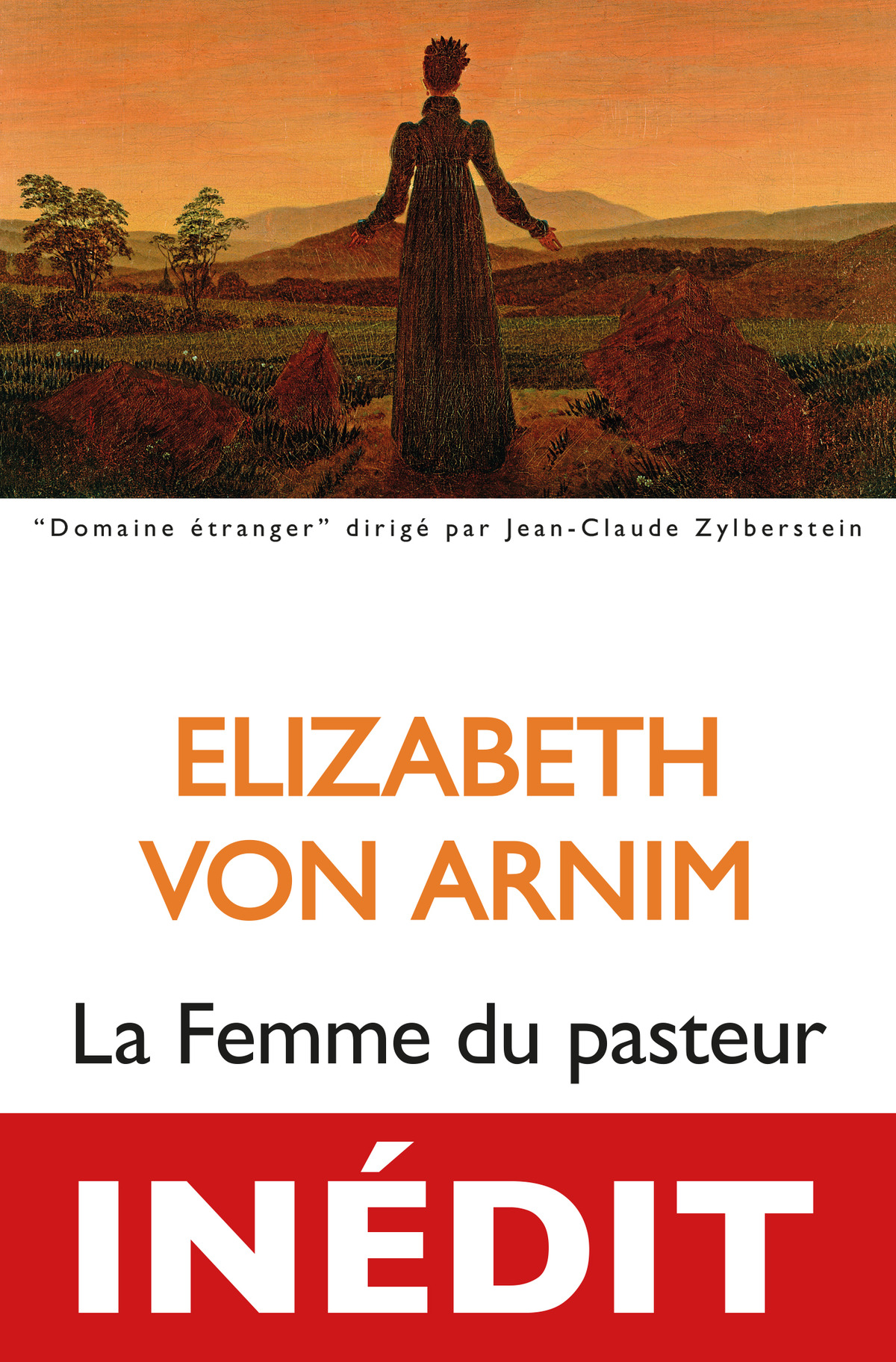Les toutes jeunes éditions Honorine nous propose un recueil de nouvelles sous le signe de l’hiver. S’y trouvent quinze écrivaines d’époques et de pays différents. Certaines sont très connues comme Edith Wharton, Elizabeth von Arnim, Margaret Atwood, Louisa May Alcott, Anaïs Nin, d’autres malheureusement sont oubliées comme Agnès Sapper, Selma Lagerlof ou sont de jeunes autrices comme Francesca Manfredi ou Geneviève Boudreau.
Plusieurs nouvelles portent bien entendu sur les fêtes de Noël, la joie des enfants et le bonheur de partager ces moments avec ceux qui sont plus pauvres. C’est le cas avec les filles du Docteur March ou « Un heureux réveillon » de Katherine Mansfield. J’ai beaucoup apprécié « Noël chez les Osborne » de Lucy Maud Montgomery où des enfants, blasés devant l’arrivée des fêtes, redécouvrent la magie de Noël en organisant une fête pour des enfants démunis de leur voisinage.
Mais les nouvelles du recueil ne sont pas que chaleureuses et réconfortantes. Edith Wharton nous entraîne aux frontières du fantastique avec « Ensorcelée », la plus longue nouvelle du recueil. La solitude et la mélancolie accompagnent les personnages de Francesca Manfredi dans « Ce qu’il reste » et l’héroïne d’Anaïs Nin dans « Les roses rouges ». Colette se remémore les Noëls passés, le temps qui s’écoule si vite dans « Rêverie du nouvel an ».
Parmi ces nouvelles, certaines m’ont séduite par leur ton ironique, leur humour glaçant. C’est le cas de « Matelas de pierre » de Margaret Atwood qui offre à son héroïne l’occasion de se venger en Arctique d’un homme surgi de son passé. Elizabeth von Arnim place son Noël traditionnel bavarois à l’aube de la seconde guerre mondiale jetant ainsi un voile sur les festivités familiales. Avec plus de légèreté, Stella Gibbons nous décrit le Noël solitaire d’une romancière, installée récemment à la campagne, qui ne souhaite aucunement se marier mais l’ironie du sort en décidera autrement.
« Un hiver au féminin » nous offre des nouvelles aux tons très variés, aux voix très affirmées et singulières. De quoi nous accompagner superbement durant l’hiver.