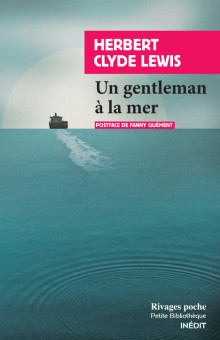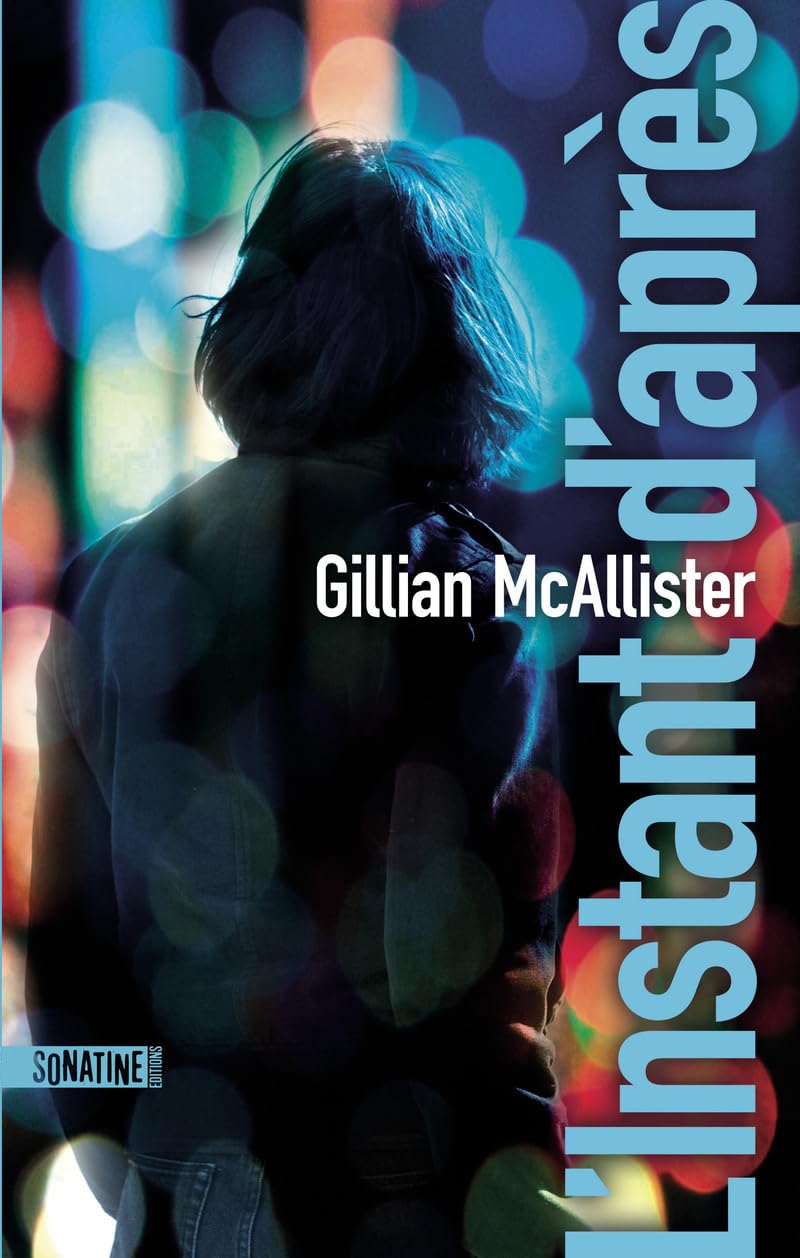De bien belles lectures durant ce mois d’octobre et plusieurs coups de cœur :
-« Migrations » de Charlotte McConaghy qui nous plonge dans un monde où la faune et la flore sont presque anéanties aux côtés d’une héroïne solitaire, meurtrie et terriblement attachante. L’écriture de Charlotte McConaghi est immersive et saisissante ;
-« Le grand horizon » de Lola Nicolle où l’on suit Vincent dans une course d’ultra-cyclisme : la Transcontinental Race. Par manque de temps, je n’ai pas chroniqué cette lecture qui pourtant m’a beaucoup plu notamment grâce à la très belle plume de son autrice ;
-« Baignades » d’Andrée A. Michaud, ma première lecture de l’autrice québécoise est un immense coup de cœur tant la narration m’a tenue en haleine et m’a surprise ;
-« Louve en juillet » de Gabrielle Filteau-Chiba qui inaugure la collection « Animales » des éditions Dépaysage et où l’autrice, que j’apprécie beaucoup, revient sur sa relation intense avec sa chienne Séquoia ;
-« L’affaire de la rue Transnonain » de Jérôme Chantreau nous transporte en 1834 durant la nuit du 14 avril durant laquelle les soldats de Louis-Philippe vont massacrer les habitants d’un immeuble. Entre document et roman, l’auteur mène une enquête passionnante dans un Paris pré haussmannien. Un régal !
-« Jane Austen, une vie entre les pages » de Janine Barchas et Isabel Greenberg que je déguste avec délectation et qui est une grande réussite aussi bien sur le fond que sur la forme ;
-« La femme du pasteur » de Elizabeth von Arnim qui est en cours de lecture car il est très dense et comme toujours c’est un grand plaisir de lire cette autrice que j’affectionne tout particulièrement.
Côté cinéma, j’ai pu voir huit films dont voici mes préférés :

Alger, 1938, Meursault travaille comme employé de bureau, il est consciencieux et sans ambition. Il apprend par un télégramme la mort de sa mère dans l’asile où il l’avait placée trois ans auparavant. Le voyage pour assister à l’enterrement est long, la chaleur pénible. Meursault veille le cercueil fermé de sa mère, n’exprime aucune émotion, ne laisse couler aucune larme. Cette indifférence lui sera reprochée lors de son procès, bien plus que la raison de sa présence au tribunal : le meurtre d’un Arabe.
Ayant beaucoup aimé le roman d’Albert Camus, lu il y a fort longtemps, j’avais hâte de découvrir l’adaptation de François Ozon et je suis sortie de la projection éblouie et fascinée. Le réalisateur réussit à être fidèle à l’œuvre originale tout en s’en affranchissant. Sa mise en scène est à la fois très sensuelle et très graphique. Il utilise un noir et blanc épuré qui rend avec puissance les implacables lumière et chaleur d’Alger. La ville, le contexte historique sont d’ailleurs très présents, l’intrigue est profondément ancrée dans ce lieu.
L’insondable Meursault est une énigme, un taiseux qui ne parle que lorsque cela est nécessaire et qui ne ment jamais. François Ozon construit son personnage autour du vide, du silence mais lorsque Meursault se décide à s’exprimer, c’est une déflagration (formidable scène avec Swann Arlaud). La performance de Benjamin Voisin est exceptionnelle, il est tout en intériorité mais également charnel. Il semble absent au monde et pourtant profite de chaque rayon de soleil, de chaque baignade. A ses côtés, la solaire Rebecca Marder donne de l’épaisseur au personnage de Marie à qui François Ozon donne plus d’importance que dans le roman. De même pour la sœur de la victime qui fait exister le peuple algérien nié par les français. Remarquable, brillant, « L’étranger » est une réussite totale que j’ai déjà envie de revoir.

Une mère célibataire, Shu-Fen, revient à Taipei avec ses deux filles : I-Ann qui a du arrêter ses études faute de moyens et la petite dernière I-Jing. Shu-Fen a réussi à avoir une échoppe dans le grand marché nocturne de la capitale taïwanaise. Sa fille aînée vend des noix de bétel pour aider sa mère. La petite est souvent laissée seule et elle explore les échoppes du marché. Son grand-père ne supporte pas qu’elle soit gauchère et lui dit que c’est la main du diable. La petite fille de cinq ans va prendre cette phrase au pied de la lettre.
Shih-Ching Tsou réalise ici son premier long-métrage après avoir longtemps collaboré avec Sean Baker. Ce dernier est d’ailleurs le co-scénariste du film. On retrouve dans « Left-handed girl » une énergie, un mouvement incessant que l’on avait pu voir dans « Anora ». Le marché de nuit est un cadre idéal, coloré et lumineux pour les aventures de cette adorable petite fille. L’effervescence du lieu, le charme de I-Jing ne masquent pas la dure réalité de la famille. La mère, dont les parents sont assez riches, doit se débrouiller seule et est souvent en conflit avec sa fille aînée. Drôle, attendrissant (mention spéciale à Nina Ye qui interprète I-Jing), le film nous réserve une scène finale d’anthologie lors de l’anniversaire de la grand-mère.

La petite dernière de la famille, c’est Fatima. Elle est en terminale, joue les dures dans la cour de l’école avec sa bande de potes mais elle travaille très sérieusement pour le bac, elle joue au foot tout en étant asthmatique, elle pratique scrupuleusement la prière et découvre peu à peu son attirance pour les femmes. L’appartement familial est un cocon où règne une mère affectueuse. Le père est en retrait, ne se mêlant pas des histoires de ses trois filles.
Hafsia Herzi adapte avec talent le très réussi premier roman de Fatima Daas. Les nombreuses contradictions dans la vie de l’héroïne sont au cœur de l’histoire. Le jeune femme, superbement incarnée par Nadia Melliti (Prix d’interprétation au dernier Festival de Cannes), va apprendre à se connaître, à s’accepter durant cinq saisons. Sa vie après le bac (une fac de philo à Paris) est un tourbillon de découvertes, de rencontres, de coups de cœur et de déceptions. Le personnage de Fatma est fermé, dur, solitaire mais on sent également une douleur, une sensibilité poindre. La réalisation de Hafsia Herzi est très vive, réaliste et empathique. Il y a beaucoup de douceur dans sa façon d’appréhender chaque personnage. Le casting mélange amateurs et professionnels et ils sont tous très justes. Avec beaucoup de finesse et sobriété, la réalisatrice met en scène ce récit d’apprentissage émouvant.
Et sinon :
- « Météors » de Hubert Charuel et Claude Le Pape : Dan, Mika et Tony passent une soirée au bowling en abusant de l’alcool et des joints. Les deux premiers rentrent en voiture. Dan, le roi des plans foireux, a l’idée de kidnapper un maine coon qu’il voit au bord de la route. Il se trouve que l’animal est un chat de compétition et son propriétaire se met à poursuivre les deux compères. Cela se termine au tribunal, Dan et Mika auront six mois pour trouver du travail et arrêter la drogue. C’est Tony, chef de chantier à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, qui va les embaucher. Le nouveau film d’Hubert Charuel et Claude Le Pape démarre comme une comédie potache mais le ton va peu à peu s’assombrir. Le cœur de l’intrigue est l’amitié puissante qui unit Dan et Mika. Mais les deux jeunes hommes vont prendre des directions différentes après leur procès. Paul Kircher et Idir Azougli interprètent avec intensité les deux copains. Le film se termine de façon plus politique avec la question du traitement des déchets nucléaires. Peut-être que « Météors » aborde trop de thèmes à la fois mais l’amitié de Dan et Mika vaut vraiment le détour.
- « Un simple accident » de Jafar Panahi : Une famille rentre à la nuit tombée en voiture. Un choc, certainement un chien, met à mal le moteur du véhicule. Le père de famille cherche de l’aide dans un magasin. Vahid, qui travaille dans la réserve, se fige en reconnaissant le bruit trainant d’une jambe boiteuse. L’homme, qui vient d’entrer, ne peut être qu’Eghbal, dit La Guibole, gardien de prison qui l’a jadis torturé. Après l’avoir suivi, Vahid le kidnappe mais au moment de le tuer il a un doute sur son identité. Tourné clandestinement, le dernier film de Jafar Panahi nous embarque à nouveau à bord d’un véhicule. Vahid va chercher d’autres opposants en capacité d’identifier formellement La Guibole. L’équipée est des plus hétéroclites : un couple de futurs mariés habillés pour une séance photo, la photographe, un homme particulièrement en colère. Ils ressemblent par moment aux pieds Nickelés et donnent au film un ton de comédie italienne. Mais leur journée ensemble est également l’occasion de se questionner sur leur humanité, leur sens de la justice et leur envie de vengeance. Les péripéties de cette troupe attachante se révèlent tour à tour amusantes, haletantes mais aussi glaçantes à l’image des dernières minutes du film.
- « Nouvelle vague » de Richard Linklater : 1959, Godard, Truffaut et Chabrol exercent leurs talents dans les Cahiers du cinéma. Mais leur envie de renouveau, de modernité doit s’incarner dans des films. Des trois amis, seul Godard n’est pas encore passé derrière la caméra. Il se décide enfin pour réaliser « A bout de souffle » qui deviendra l’emblème de la nouvelle vague. Richard Linklater montre le tournage de ce film iconique. La technique de Godard est aussi novatrice que ce qu’il va créer et déroute les techniciens et les acteurs. Le réalisateur américain a choisi l’évocation plutôt que la ressemblance pour son casting et ça fonctionne parfaitement (Guillaume Marbeck est plus vrai que nature en Godard). Richard Linklater réussit à rendre le bouillonnement, la spontanéité et l’innovation de ce courant cinématographique. « A bout de souffle » étant un de mes films préférés, j’attendais beaucoup de ce film et j’ai été séduite par les choix du réalisateur qui a su capter la magie créée par Godard.
- « Une bataille après l’autre » de Paul Thomas Anderson : En Californie, Bob Ferguson élève seul sa fille adolescente Willa. Ancien activiste de gauche, il vit dans la clandestinité depuis l’arrestation seize ans auparavant de la mère de sa fille Perfidia Beverly Hills. Leur groupe révolutionnaire était à l’origine d’actions violentes et Bob a élevé sa fille dans la paranoïa. Il n’a pas eu tort puisque leur pire ennemi, le colonel Lockjaw, réapparait et se met à leur recherche. Bob, plongé dans la fumée de ses joints, a perdu ses réflexes et doit se secouer pour protéger sa fille. Paul Thomas Anderson nous offre ici un divertissement très efficace qui va à cent à l’heure. L’intrigue est centrée surtout sur la fuite de Bob et Willa ce qui occasionne de nombreuses scènes d’action et de courses poursuites. Il y a des passages très drôles comme ceux où Bob a totalement oublié les codes de son Manuel de la Rébellion ou quand une société secrète nommée le Club des Aventuriers de Noël s’écrient « Loué soit St Nicolas ! ». Le trait est parfois forcé (le personnage de Sean Penn est too much) mais globalement les 2h42 passent sans encombre grâce au rythme et aux excellents acteurs. Mention spéciale à Benicio Del Toro qui incarne merveilleusement bien un prof de karaté qui fait passer des migrants en douce.
- « Berlinguer-la grande ambition » d’Andrea Segre : Enrico Berlinguer est une figure importante de la politique italienne. Leader du parti communiste, on le découvre ici entre 1973 et 1978, date de l’assassinat d’Aldo Moro. Berlinguer était très populaire et il réussit à rendre le PC très puissant notamment parce qu’il prend ses distances avec Moscou. Humaniste, porté par ses convictions, il tente de créer avec Moro un gouvernement d’unité nationale à un moment où le pays est menacé par les Brigades rouges et les groupuscules fascistes. Le réalisateur nous montre un homme au travail, impliqué et pragmatique. Le film porte sur une époque passionnante, un tournant qui malheureusement débouchera sur un échec. « Berlinguer-la grande ambition » est très classique dans sa forme et un peu trop austère à mon goût.