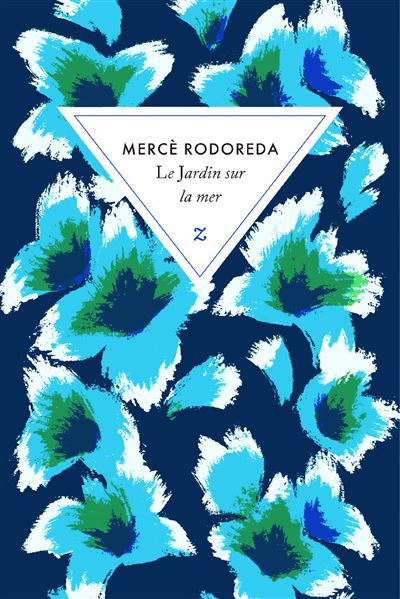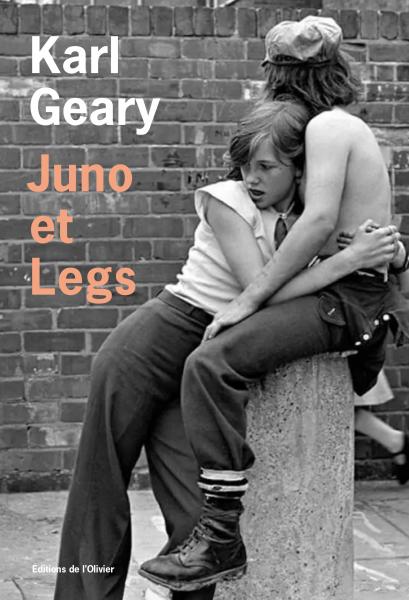Juin s’est terminé, le mois anglais également et j’ai achevé mes lectures pour celui-ci avec le surprenant « Woolf » d’Adèle Cassigneul, la très belle évocation d’Orlando dessiné par Montse Mazorriaga, « Une volière en été » où Margaret Drabble dresse une portrait nuancé de la condition féminine dans les années 60 et le nouveau roman de Deborah Levy qui suit le parcours d’une femme en quête d’identité. J’ai ensuite découvert la très talentueuse Mercè Rodoreda avec son « Jardin sur la mer » et le très amusant Karel Capek avec son « Année du jardinier ». J’ai terminé le mois de juin avec deux auteurs irlandais dont j’ai adoré les romans : « Fils prodigue » de Colin Barrett et « Juno et Legs » de Karl Geary.
Côté cinéma, j’ai vu sept films durant le mois de juin dont voici mes préférés :

Enzo, 16 ans, apprend la maçonnerie mais il n’est pas très doué. Son patron demande à rencontrer ses parents pour leur parler de son manque d’implication. A sa grande surprise, il découvre que le jeune garçon habite dans une villa somptueuse de la Ciotat. Il perd ses moyens devant les parents et promet de garder Enzo en le mettant sous la tutelle de Vlad, un ouvrier ukrainien.
L’histoire de « Enzo » est éminemment touchante puisqu’il s’agit du dernier film de Laurent Cantet, décédé en 2024, écrit avec son ami Robin Campillo qui a décidé de le réaliser. On retrouve dans ce film tout l’intérêt de Laurent Cantet pour le monde du travail et les classes sociales. Ce qui est passionnant ici, c’est le renversement du concept de transfuge de classe. Les parents sont ingénieure et professeur d’université, le frère ainé va intégrer Henri IV. Enzo est traité avec bienveillance, entouré par la tendresse de parents aimants et compréhensifs. Mais il a honte de son milieu social, ne s’y sent pas à sa place. Mais il peine aussi à s’insérer dans le milieu ouvrier. Robin Campillo ne s’est pas contenté de réaliser le film de Laurent Cantet, il y a également mis sa patte puisqu’il y est question de désir, de sensualité. Eloy Pohu, dont c’est le premier rôle, incarne Enzo avec beaucoup de talent et de sensibilité. « Enzo » est un récit inattendu sur un adolescent qui cherche sa place dans la société tout en rejetant les codes et attendus de sa classe.

Chaque mois, les deux frères Jae se retrouvent pour un dîner en famille dans un luxueux restaurant. L’aîné est un avocat sans scrupules qui a épousé en seconde noce une femme beaucoup plus jeune. Son frère cadet est un chirurgien pédiatrique de renom. Sa femme et lui ont accueilli leur mère sénile et ingrate dans la chambre d’ami de leur appartement. Il n’apprécie guère les valeurs capitalistes et le cynisme de son frère aîné. Leur relation va se compliquer lorsque leurs enfants vont être mêler à un crime particulièrement odieux.
» A normal family » est l’adaptation du « Dîner » d’Herman Koch et sa noirceur n’a rien à envier au « Parasite » de Bong Joon-Ho. Le portrait de la société coréenne est très amer. La barbarie, la violence ne sont jamais loin sous le vernis policé de la haute société où évoluent les personnages. Les valeurs et la morale sont plus faciles à défendre lorsque l’on est pas directement concernés. Le film s’ouvre sur une scène d’agressivité, d’une brutalité saisissante avec un carambolage en pleine rue et il s’achèvera sur une scène encore plus glaçante. Les quatre acteurs, qui interprètent les deux couples, sont formidables. Un thriller parfaitement mené et angoissant.

Amélie est un drôle de bébé. Silencieuse et immobile, elle est qualifiée de légume par le pédiatre. Mais un jour de tremblement de terre (sa famille vit au Japon), ce bébé si calme se met à hurler sans relâche, vexée que personne ne comprenne son babillage. Entre leurs trois enfants, les parents se trouvent vite dépassés et ils font appel à deux personnes qui vont changer la vie d’Amélie : sa grand-mère qui lui fait découvrir le plaisir du chocolat blanc et Nishio-san, une employée de maison qui s’occupera avec tendresse de cette petite fille singulière.
L’adaptation du roman d’Amélie Nothomb est un ravissement qui mélange le cinéma d’animation français et japonais. Le film est une splendeur à l’esthétique colorée et foisonnante. Amélie grandit dans un Japon qui l’émerveille par ses traditions, ses rites et la beauté de sa végétation. On pense parfois à l’univers de Miyazaki. Ce qui ressort surtout du film, c’est le plaisir de la découverte, la luminosité des paysages, l’infinie bienveillance de Nishio-san, l’incroyable vivacité de cette petite fille. Même si Amélie connaîtra des moments difficiles et douloureux (son père, consul, devra un jour retourner en Belgique), elle apprendra à les surmonter et à les sublimer (notamment par la littérature). « Amélie et la métaphysique des tubes » a une grâce, une poésie et je ne peux que saluer le formidable travail de Liane-Cho Han et Maïlys Vallade. Un vrai régal !
Et sinon :
- « Peacock » de Bernhard Wenger : Matthias est acteur et il travaille pour My companion, les clients peuvent le louer pour jouer un petit ami cultivé, un fils aimant ou pour s’entrainer à s’engueuler avec un mari. Il est très doué et reçoit régulièrement les meilleurs commentaires sur le site internet de sa boite. Il est tellement impliqué dans ses rôles qu’il finit par s’oublier. C’est ce que lui reproche sa copine qui ne le trouve plus « vrai ». Elle le quitte et Matthias commence à se remettre en question. Bernhard Wenger signe ici une comédie très grinçante. Dans le monde de Matthias tout est téléguidé : la lumière dans sa superbe maison, la musique, son téléphone, ses propres émotions. Son chien n’est lui-même pas « réel » puisqu’il est loué ! Matthias est comme une page blanche, disponible uniquement pour ses missions professionnelles. Et lorsqu’il part en vrille, personne ne semble le croire. C’est réjouissant de voir ce personnage s’enfoncer de plus en plus dans l’absurdité de sa situation.
- « Indomptables » de Thomas Ngijol : Yaoundé, le corps d’un officier de police est retrouvé, il a été assassiné. Le commissaire Billong va mener l’enquête malgré le cruel manque de moyens. L’homme est bourru, défend une certaine droiture mais est capable de brutaliser ses suspects. Le commissaire a également bien du mal à se faire respecter par ses propres enfants qui le trouvent autoritaire. Dans son nouveau film, Thomas Ngijol change de ton et nous propose une histoire plus sombre. Le personnage principal est complexe, nuancé et il est formidablement incarné par Thomas Ngijol. Il tente de donner une image de la société camerounaise prise entre modernité et traditions. L’intrigue policière est noyée dans la peinture sociale et son intérêt se dilue quelque peu.
- « The Phoenician Scheme » de Wes Anderson : Anatole « ZsaZsa » Korda échappe une nouvelle fois à une mort certaine. Ce très riche homme d’affaires a des procédés très controversés. Pour sauver l’un de ses fastueux projets, il doit courir à travers l’Europe pour trouver des financements. Pour l’accompagner, il fera sortir sa fille du couvent où elle s’apprêtait à prononcer ses vœux. Celle-ci accepte en espérant éclaircir la mort de sa mère. Le casting du dernier Wes Anderson est étincelant : Benicio del Toro, Mia Threapleton, Tom Hanks, Riz Ahmed, Mathieu Amalric, Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson, les caméos se multiplient au fil des voyages de Zsa Zsa. J’ai mis beaucoup de temps à rentrer dans le film qui est extrêmement bavard et finalement assez répétitif. Si le film reste plaisant à regarder, c’est grâce aux performances des acteurs et à l’univers vintage et pop du réalisateur.
- « Chime » de Kiyoshi Kurosawa : Dans un cours de cuisine, un élève se suicide devant tout le monde en sa tranchant la gorge. L’angoisse gagne le professeur, atteint son quotidien. La violence semble le contaminer. Kiyoshi Kurosawa réalise un moyen métrage étrange où le mal reste inexpliqué. L’ambiance est très inquiétante mais l’intrigue est trop décousue pour convaincre.