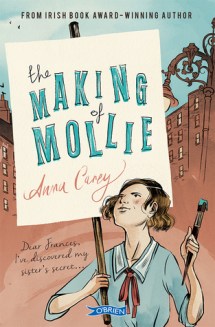Août 2011, l’ouragan Irene s’abat sur les Etats-Unis et notamment sur le Vermont où de nombreux dégâts sont recensés. Des personnes ont également disparu. C’est le cas de Bonnie qui est sortie de chez elle le soir de la tempête après avoir pris de la drogue. Sa fille Vale, qui vit à la Nouvelle Orléans, apprend la nouvelle par sa tante Deb. Elle, qui n’a pas mis les pieds dans le Vermont depuis 8 ans, se précipite pourtant pour essayer de retrouver sa mère. A Heart Spring Mountain, elle retrouve donc sa tante Deb, ancienne hippie, et la vieille Hazel, la tante de sa mère. Toutes deux vivent en plein cœur de la nature sauvage où leurs ancêtres s’étaient eux-mêmes installés. Vale va se confronter à ses propres souvenirs mais également à ceux de sa famille.
« Les femmes de Heart Spring Mountain » est le premier roman de Robin MacArthur après un recueil de nouvelles. Elle dépeint, dans son livre, une lignée de femmes et en fait un roman choral. Chaque court chapitre est dédié à l’un des personnages : Bonnie, sa fille Vale, sa mère Lena, sa tante Hazel et sa belle-fille Deb. Les liens entre tous les personnages sont au début un peu difficile à établir mais ils s’éclairent au fur et à mesure de la lecture. De plus, Robin MacArthur nous fait voyager dans le temps de la fin des années 50 à 2011. Les hommes ont parfois voix au chapitre mais ils sont en minorité, ils disparaissent assez vite, s’éloignent géographiquement ou ont des destins tragiques. Robin MacArthur écrit donc un roman au féminin qui commence même avant Lena avec l’ancêtre Marie dont Vale découvre une photo. Une femme mystérieuse aux longues tresses noires qui pose la question des origines indiennes de la famille. Les Abénakis peuplaient effectivement la région avant l’arrivée des colons blanc. Les femmes de Heart Spring Mountain sont toutes plus ou moins fantasques, décalées et bohèmes. C’est sans doute cela qui les rend si attachantes. L’une d’elles l’est tout particulièrement : Lena, la grand-mère de Vale. C’est d’ailleurs la seule dont l’histoire nous est racontée à la première personne du singulier. Elle vit dans une cabane avec une chouette qu’elle a soignée et elle est en parfaite adéquation avec la nature.
Cette dernière est d’ailleurs l’autre grande thématique du roman de Robin MacArthur. Cette lignée de femmes est totalement ancrée dans le territoire de Heart Spring Mountain, ce sont leurs ancêtres qui ont nommé ainsi cette terre où ils s’installèrent. Il y a un attachement viscéral à cet endroit que redécouvre Vale en y revenant. « Vale se lève et sort pour s’éclaircir un peu les idées. Il fait froid. Un vent mordant au parfum de résine monte de la rivière. Elle s’enveloppe dans son gilet, rabat le chapeau de Lena sur ses yeux et ses oreilles. Un peu plus haut dans la montagne, la fumée d’un feu de bois s’élève du chalet de Deb ; la lumière du soleil se reflète sur la fenêtre de la cuisine de Hazel. « Chez moi », murmure-t-elle, le paysage lui apparaissant sous un jour nouveau. » Le récit est émaillé de descriptions du paysage et les événements souligne la puissance des éléments. Mais Robin MacArthur parle aussi beaucoup de ce qui détruit notre environnement, du danger qui menace des lieux comme Heart Spring Mountain. La beauté, la rudesse de la nature appelle ici à sa défense, à sa protection.
Les thématiques du roman de Robin MacArthur m’ont séduite et intéressée. Il s’agit là d’une belle découverte et d’une auteure à suivre à l’avenir.
Merci au Picabo River Book club et à Léa pour cette découverte !