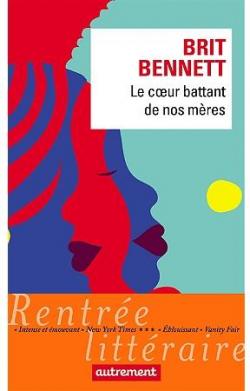Voilà, la 9ème édition du Festival America est terminée. Retour sur mon weekend au cœur de la littérature américaine.
-Day 1 :
J’ai commencé en douceur avec deux cafés des libraires : l’un sur la jeunesse tronquée auquel j’assistais essentiellement pour Jacqueline Wodson que j’ai trouvée particulièrement pertinente et intéressante aux différents débats où j’ai vue ; l’autre était consacré au « monde selon Garp » avec un John Irving éloquent et qui regrettait que son roman soit toujours autant d’actualité en ce qui concerne l’intolérance envers les personnes LGBT. Il a également souligné l’importance de sa mère dans son intérêt pour les minorités et la lutte contre les violences qui leur sont faites.
J’ai ensuite écouté Patrik DeWitt parler de ses romans et de sa façon utiliser des époques passées pour se mettre à distance et se protéger. Son premier roman était en effet autobiographique. L’humour, la drôlerie lui permettent également de regarder la réalité de manière différente. L’auteur a l’élégance et l’ironie qui sont le propre de ses romans.

La journée se termina avec une rencontre au sommet autour de quatre écrivains ayant reçu le prix Pulitzer : Jeffrey Eugenides, Michaël Chabon, Richard Russo et Colson Whitehead. Les quatre auteurs ont fait montre d’un humour tout à fait réjouissant. Tous les quatre ont raconté le plaisir, le bonheur d’avoir reçu ce prix (qui permet semble-t-il de s’offrir de splendides chaussures !) mais également que le prix n’écrit pas le livre suivant et que chacun se retrouve seul devant les pages blanches. L’engagement politique des écrivains et le gouvernement américain ont également été évoqués. Pour Jeffrey Eugenides, Trump serait un symptôme de ce qui dysfonctionne dans la politique américaine. Pour Colson Whitehead, il s’agit seulement d’un cycle dans l’histoire américaine, il y a sans cesse un va-et-vient entre bien et mal. Pour lui, l’élection de Trump n’a rien d’étonnant puisque les États-Unis restent un pays profondément raciste. Michaël Chabon et Richard Russo s’engagent d’autant plus que ce président entache l’image de l’Amérique et leur fait honte. La soirée se termine sur les influences de ces quatre écrivains qui vont de Conan Doyle à Faulkner en passant par Joyce.

-Day 2 :
La journée commença par une conférence très intéressante sur des portraits de femmes avec Wendy Guerra, Laura Kasischke, Claire Vaye Watkins et Leni Zumas. La place des femmes est essentielle chez ses romancières. Wendy Guerra écrit volontairement sur des femmes fortes comme Anaïs Nin, des femmes libres dans un pays machiste, Cuba. Laura Kasischke explique qu’elle ne sert pas consciemment des femmes dans ses romans, c’est uniquement parce que les femmes sont ce qu’elle connait le mieux. Elle est fille unique et sa mère venait d’une famille composée uniquement de filles. Laura Kasischke pense qu’elle aurait du mal à adopter le point de vue d’un homme même si elle aimerait essayer. Toutes ont en commun un féminisme marqué et parfois militant. Laura Kasischke n’a lu que de la littérature féminine jusqu’à ses trente ans. Elles notent également que la condition des femmes est toujours précaire et les violences qui leur sont faites sont fortes. Elles sont exploitées, utilisées, manipulées par des gourous chez Claire Vaye Watkins dans « Les sables de l’Armagosa » ou dans « Eden spring » de Laura Kasischke. Leni Zumas montre dans son roman que les droits des femmes , notamment le droit à l’avortement, étaient toujours menacés et le poids de la société est toujours fort en ce qui concerne le rôle de la femme. Chacune pense qu’il faut rester vigilant quant à ses questions et face à la misogynie de la société américaine.

J’ai poursuivi ma journée avec une conférence sur l’adolescence et ses possibles avec Jacqueline Woodson, Brit Bennett et Gabriel Tallent. Les trois auteurs ont dépeint dans leurs romans des adolescentes ayant perdu leur mère, des jeunes filles devant faire face à des situations difficiles et devant apprendre à prendre soin d’elles. Les trois auteurs étaient tout à fait intéressants, je n’ai malheureusement pas encore lu « My absolute darling » mais le brillant Gabriel Tallent m’a convaincue de le faire rapidement.
La conférence suivante portait sur la middle class avec Jonathan Dee et Jeffrey Eugenides et elle n’a pas été très bien menée par l’intervenant. Les deux auteurs ont vu la diminution des classes moyennes, l’écart grandissant entre les classes sociales qui apportent beaucoup de ressentiment et de désespoir face aux dégâts provoqués par l’ultralibéralisme. Jeffrey Eugenides, né à Detroit, a vu les revers du rêve américain et de la vénération de l’argent.
La dernière conférence s’intitulait « Quand tout s’effondre » et réunissait Claire Vaye Watkins, Christian Guay-Poliquin et James Noël. Que la catastrophe soit réelle (le tremblement de terre qui a ravagé Haïti en 2010) ou de l’ordre de la dystopie, elle permet de rappeler aux hommes leur vulnérabilité, leur insignifiance face à la puissance de la nature. Pour James Noël, elle permet également de mieux profiter de la vie, de la rendre plus précieuse. Pour Claire Vaye Watkins, la catastrophe, qui pourrait balayer l’ancien monde, ne change rien aux rapports de force et aux inégalités. Pour Christian Guay-Poliquin, la dystopie est un bon moyen de regarder le présent en faisant un pas de côté.

-Day 3 :
Lauren Groff, Michaël Chabon et Michaël Winter étaient réunis pour la conférence « Pour le pire et le meilleur » dans la salle des mariages de la marie de Vincennes. Dans les trois romans de ces écrivains, le mariage reste une aventure périlleuse. Chez Lauren Groff, le secret, le mensonge permet la paix des ménages et pour qu’il dure il faut savoir vivre dans une bulle, loin de la famille et des amis. Michaël Chabon évoque, quant à lui, un mariage très long, peu souvent vu dans la littérature. Un mariage à l’ancienne, avec des hauts et des bas, mais qui réussit à perdurer. Michaël Winter parle, dans son roman « Au nord-est de tout », du peintre Rockwell Kent qui partit sur l’île de Terre-Neuve avec femme et enfants pour s’isoler de tout. Mais le peintre connaîtra plusieurs divorces, plusieurs échecs sentimentaux qu’il voit comme des expériences enrichissantes. Chacun avait envie de présenter des relations sortant de l’ordinaire.

J’ai ensuite assisté à une conférence intitulée « Quand l’utopie vire au cauchemar » surtout pour écouter Jean Hegland dont le roman « Dans la forêt » me fait dangereusement de l’œil ! d’ailleurs, elle considère son roman comme étant plus une utopie qu’une dystopie. Elle s’agissait surtout pour elle de montrer l’apprentissage de deux jeunes filles, de les placer dans un milieu hostile et de les voir évoluer. Jean Hegland voulait également souligner l’importance de la reconnexion avec la nature et de la quête de sens. La dystopie reste un miroir qui permet d’observer le présent et de l’analyser.

Prochain arrêt : New York avec Jacqueline Woodson, Vivian Gornick et Kristopher Jansma. Chacun avait une vision différente de la ville en raison de son histoire personnelle. Jacqueline Woodson est arrivée à l’âge de 7 ans à New York comme beaucoup d’afro-américains qui ont quitté le Sud en masse dans les années 50-70. Kristopher Jansma est né dans le New Jersey mais ses parents n’aimaient pas New York et il n’y venait qu’occasionnellement. Ce n’est que pour ses études universitaires qu’il est venu habité dans la grosse pomme. Vivian Gornick est quant à elle né dans le Bronx et elle réside aujourd’hui à Manhattan. Mais les trois écrivains ont un sentiment de forte appartenance à cette ville qui est également au cœur de leurs derniers livres. New York est une ville idéale pour la littérature, bouillonnante, foisonnante, bruyante, diverse et surtout bigger than life.

J’ai ensuite retrouvé mon cher Jeffrey Eugenides avec Lauren Groff et Julie Mazzieri. A travers la ville de Detroit où il est né et l’histoire de son père, Jeffrey Eugenides a pu voir la gloire et la chute du rêve américain basé sur l’argent et la réussite matérielle. Ce lien à l’argent est au cœur de ses nouvelles qui viennent d’être traduites en France. Le sens de la perte, d’une époque perdue du à la ruine de Detroit est probablement à l’origine de « Virgin Suicides ». Lauren Groff ne conçoit pas la réussite sous forme de valeurs sonnantes et trébuchantes même si elle est née dans une famille bourgeoise. L’important pour elle est la réalisation des rêves, une vie heureuse qui n’est pas forcément liée aux conditions matérielles. L’argent est sans aucun doute nécessaire mais il est trop lié au pouvoir pour être une composante du bonheur. D’ailleurs, il est souvent à l’origine de problème dans les mariages.
Pour terminer ce Festival America, j’ai retrouvé Michael Chabon et Vivian Gornick pour une conférence sur l’héritage mais je vous avoue avoir arrêté de prendre des notes, je commençais à fatiguer !
Encore une fois, il faut saluer la qualité remarquable du Festival America et remercier les organisateurs, les bénévoles pour leur extraordinaire travail. Vivement 2020 !