Dans le voisinage de la maison de Rebecca, dix ans, revient s’installer Mrs Sybil Jardine. La vieille femme n’était pas revenue sur sa propriété depuis de nombreuses années. Mrs Jardine était très amie avec la grand-mère de Rebecca mais par la suite les liens furent rompus entre les deux familles. Rebecca est très intriguée par la vie de Mrs Jardine et elle est enchantée lorsqu’elle celle-ci l’invite avec sa sœur à lui rendre visite. Entre Rebecca et Mrs Jardine une affection mutuelle se développe. L’enfant devient la confidente de la vieille femme qui lui raconte les épisodes marquants de sa vie mouvementée. Dans le même temps, Rebecca devient amie avec la petite fille de Mrs Jardine, Maisie. Rebecca est totalement fascinée par l’histoire de la famille.
« La ballade et la source » est un roman très mélodramatique. Il y est question de suicide, de folie, possiblement d’inceste, d’abandon d’enfants. Le sceau du malheur s’abat sans cesse sur la famille de Mrs Jardine comme pour la punir de son péché originel : avoir quitté son mari pour un autre homme. Le personnage de Mrs Jardine est très fort. C’est une femme de caractère, indépendante qui sacrifie tout à sa liberté et est prête à en payer le prix. Mais c’est également un personnage ambigu. En tentant de récupérer sa fille, elle l’entrainera à sa perte. Mrs Jardine est une femme très manipulatrice grâce à son charme qu’elle exerce sur son entourage. Rebecca est totalement envoûtée et se retrouve, à dix ans, la confidente d’évènements terribles et souvent scabreux.
Malgré un personnage central complexe, mon avis est mitigé sur ce roman. L’histoire de Mrs Jardine, puis de sa fille Ianthé, est uniquement racontée par des dialogues. Au milieu du livre, le lecteur se retrouve à devoir ingérer plus de cinquante pages de dialogues entre Rebecca et Mrs Jardine. J’ai réellement peiné à en venir à bout, j’ai trouvé ce biais de narration assez indigeste. Et malheureusement la fin du roman reprend ce procédé entre Maisie et Rebecca. Un autre problème du livre me semble-t-il est justement le personnage de Rebecca. Elle n’existe que comme confidente, elle n’est qu’un prétexte à la narration et n’a aucune épaisseur. Il m’aurait paru intéressant d’étudier l’impact des révélations de Mrs Jardine sur une si jeune enfant.
« La ballade et la source » fut donc un rendez-vous manqué avec Rosamond Lehmann malgré le fort pouvoir d’attraction de son personnage principal.



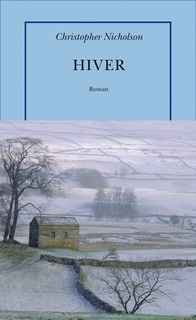

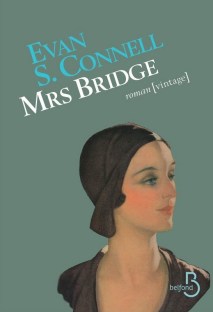

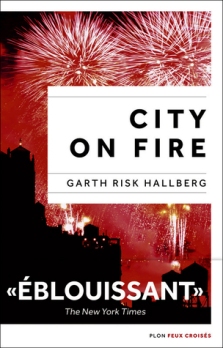
 © Leiloona
© Leiloona













