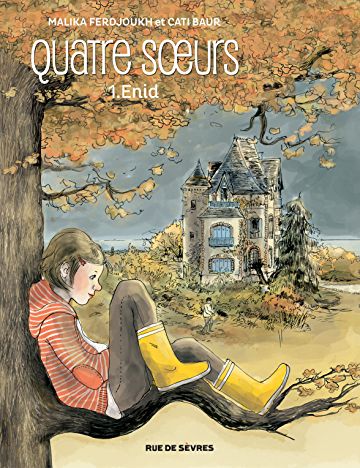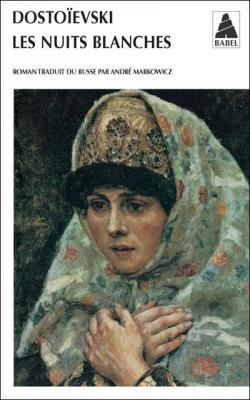Ce mois d’avril fut un mois de découverte ou de redécouverte : relire Zweig fut un bonheur, découvrir la plume de Willa Cather avec deux courts textes, l’univers étonnant de Police lunaire, l’histoire de Tamara de Lempicka, un auteur russe du XIXème siècle et lire un grand succès de librairie en Angleterre Chère Mrs Bird. De jolies lectures et des découvertes à poursuivre notamment en ce qui concerne Willa Cather, si vous avez lu certains de ces romans je suis preneuse de vos conseils !
Deux spring reading challenge en perspective qui vont m’occuper jusqu’au mois de juin, celui organisé par le forum Whoopsy Daisy pour lequel je dois lire les ouvrages suivants :
Et l’autre challenge de printemps se fait avec mes copines The Frenchbooklover et Emjy et je dois lire :
De bien belles lecture en perspective pour célébrer le printemps !
Et côté cinéma, que s’est-il passé en avril ?
Mes coups de cœur :

Staline est terrassé par une attaque cérébrale le 2 mars 1953. Il attend pendant des heures sur le tapis de son bureau que quelqu’un vienne le secourir. Mais les gardes sont trop terrifiés pour oser ouvrir la porte ! Autre problème, une fois le bureau ouvert, qui va le soigner ? Les plus grands médecins de Russie ont tous été liquidés par les purges ! Staline finit par décéder et les tractations commencent pour sa succession. Veulent le pouvoir : Gueorgui Malenkov, secrétaire général adjoint du parti, Lavrenti Beria, patron de la police politique, Nikita Khrouchtchev, ministre de l’agriculture. Tout ou presque est vrai dans ce film adapté d’une bande-dessinée de Fabien Nury et Thierry Robin. Armando Iannuci transforme la mort et la succession de Staline en farce. Les personnages sont poussés jusqu’à la caricature et sont proprement hilarants. Certaines scènes flirtent avec le burlesque et les acteurs semblent se régaler à incarner de tels personnages. La lutte entre eux est féroce, les coups bas sont permis et parfois le film se fait glaçant. La satire de Armando Iannuci montre aussi la terrible cruauté de l’empire stalinien et sa violence sans pitié. Le rire l’emporte néanmoins sur la tragédie.

Brady était une étoile montante du rodéo à Pine Ridge dans le Dakota du Sud. Une chute de cheval a ruiné sa carrière. Sa grave blessure à la tête lui interdit de monter à cheval. Mais Brady ne peut imaginer sa vie loin des chevaux. Il a passé toute sa vie auprès d’eux comme tous ses amis et sa famille. Il doit se réinventer, imaginer une autre vie et cela va être extrêmement compliqué pour lui. tous les acteurs du film sont non professionnels et ils jouent leur propre rôle ce qui rend « The rider » extrêmement poignant. La réalisatrice Chloé Zhao filme avec beaucoup d’empathie et de délicatesse ces indiens Oglalas attachés à leur terre, à la nature. les paysages filmés à l’aube ou au crépuscule sont splendides. Cette nature, qui se déploie jusqu’à l’horizon, est grandiose et remet les hommes à leur juste place. La réalisatrice montre le lien fort qui existe entre ces cow-boys et les lieux où ils vivent. L’acteur principal, Brady Jandreau, est confondant de naturel alors qu’il doit être assez difficile d’incarner son propre rôle. Son histoire, son renouveau nécessaire à ce qu’il aime le plus est très émouvant.

Les chiens sont banis de Megasaki City sous prétexte de grippe canine. Le maire Kobayashi mène une campagne contre les anciens meilleurs amis de l’homme alimentée par de fausses informations. Les animaux sont envoyés en exil sur une île décharge. Un enfant va changer les choses. Le neveu orphelin du maire veut à tout prix retrouver son chien Spot. Il atterrit sur l’île aux chiens et sera aidé par une bande de chiens errants. Wes Anderson réalise ici son deuxième film d’animation après « Fantastic Mr Fox ». Son film se déroule dans un Japon futuriste qui pourtant évoque le présent. Car sous ses airs enfantins, « L’île aux chiens » possède un sous-texte politique qui parle du rejet de l’autre, de l’exclusion d’un groupe d’individus. Le film est visuellement foisonnant, il fourmille d’idées. Cela va vite, très vite et il faudrait le revoir une deuxième fois pour ne rien manquer. On y retrouve les thématiques chères au réalisateur : l’enfance, la famille que l’on se choisit et la loufoquerie visuelle. « L’île aux chiens » est une fable parfaitement maîtrisée au ton décalé et à l’inventivité débridée.
Et sinon :
- « America » de Claus Drexel : Si vous vous demandez comment Donald Trump a pu être élu, ce documentaire vous donnera des pistes de réflexion. Le documentariste de Claus Drexel est allé voir ce qui se passait en Amérique un mois avant les élections de 2016. Il choisit d’interroger les habitants d’une petite bourgade d’Arizona. Ici, les gens ont une religion : les armes à feu. Le droit à l’auto-défense est une évidence pour eux, certains ont tout un arsenal chez eux, d’autres donnent des surnoms à leur arme favorite. Ce que l’on ressent des entretiens est une haine de Hillary Clinton qui incarne la vieille politique et ses travers. Les images de carcasses de voitures, de lieux abandonnés nous montrent le déclassement, la pauvreté. Les habitants de Seligman sont loin du pouvoir, loin du rêve américain. Ils ont vu en Donald Trump un espoir de renouveau, un homme politique qui s’adressait directement à eux, les oubliés du fin fond de l’Amérique. Ce documentaire est fait avec beaucoup d’empathie, de compréhension et nous montre un autre visage de l’Amérique.
- « A l’heure des souvenirs » de Ritesh Batra : Tony Webster est un sexagénaire qui tient une minuscule boutique de vieux appareils photos pour s’occuper. Il est divorcé et sa fille attend son premier enfant. Une vie calme qui va être troublée par un courrier inattendu : la mère d’une ancienne petite amie vient de mourir et elle lui lègue un journal intime. Celui-ci s’avère être celui d’Adrian, un ancien camarade de classe qui s’était suicidé. Pour obtenir ce journal, Tony va devoir revoir son ancienne petite amie Veronica et se replonger dans ses souvenirs. Pour être honnête, ma première motivation pour aller voir ce film était d’essayer de mieux comprendre le livre dont il est tiré : « Une fille, qui danse » de Julian Barnes. A la sortie du film, les mêmes interrogations sont demeurées, il est donc bien fidèle au roman ! Comme dans ce dernier, j’ai aimé la manière dont sont traités les souvenirs, la mémoire qui peut être trompeuse. La tonalité du film est mélancolique et douce-amère. Jim Broadbent a enfin un premier rôle à la hauteur de son talent, tout en subtilité et en ambiguïté. Il est accompagné par la toujours captivante Charlotte Rampling.
- « Après la guerre » de Annarita Zambrano: A Bologne en 2002, un juge est assassiné. Un ancien brigadiste, Marco, est soupçonné d’avoir commandité ce meurtre. Celui-ci vit en France grâce à l’amnistie offerte par François Mitterand aux membres des Brigades Rouges. Marco avait été condamné pour meurtre et risque maintenant d’être extradé. Il s’enfuit avec sa fille Viola âgée de 16 ans. La réalisatrice s’intéresse à l’après Brigades Rouges et à la manière dont la France a traité ses membres. Le film montre aussi les dégâts collatéraux de l’engagement radical de Marco. La première victime est sa fille qui doit quitter sa vie en France, ses amis et ses passions pour vivre cachée. Mais l’on voit également la famille restée en Italie qui est encore traquée par les journalistes. Des incompréhensions, des silences ont aussi creusé des fossés entre les différents membres de la famille. Viola n’a d’ailleurs jamais mis les pieds en Italie et ne connait pas sa famille. Annarita Zambrano traite le sujet avec beaucoup de réalisme et aucune empathie avec les anciens brigades rouges.
- « Mme Hyde » de Serge Bozon : Mme Géquil est professeure de sciences physiques dans un lycée technologique de banlieue. Autant dire que ses élèves n’ont que peu d’intérêt pour ce qu’elle enseigne et elle a bien du mal à s’imposer face à eux. Elle s’intéresse néanmoins à un élève handicapé, Malik, chez qui elle décèle un fort potentiel. Un soir, à la suite d’une expérience, Mme Géquil reçoit une décharge électrique qui va la transformer. Voici un film très singulier où règne une atmosphère étrange. Les personnages eux-mêmes sont très particuliers à l’image du proviseur interprété par Roman Duris qui semble quelque peu fêlé. Mme Géquil, jouée par isabelle Huppert, semble quant à elle indifférente au monde, toujours à distance. « Madame Hyde » est un film complètement décalé, étonnant, souvent drôle, peut-être un peu trop conceptuel par moments et qui met à l’honneur la passation du savoir.