La jeune Mary Reilly réussit à se faire embaucher comme bonne dans une excellente maison : celle du Dr Jekyll. Après subi les maltraitances de son père alcoolique durant toute son enfance, Mary est devenue est une personne discrète, effacée se consacrant entièrement à sa tâche. Mais le Dr Jekyll la remarque et devine en elle une certaine sensibilité, une intelligence. La bienveillance de son maître réconforte la jeune femme qui se sent enfin chez elle quelque part. Sa loyauté envers le Dr Jekyll est à toutes épreuves et lorsqu’il lui demande de faire d’étonnantes courses dans des quartiers malfamés, Mary se plie à ses demandes malgré sa peur. Intriguée et fascinée par le docteur, elle espionne ses moindres faits et gestes et s’inquiète en raison des longues expériences qu’il pratique dans son laboratoire. Jekyll y passe de plus en plus de temps s’épuisant à la tâche. Et c’est pour cela qu’il engage un nouvel assistant : Mr Hyde. Ce dernier effraie Mary lorsqu’elle le croise. Répugnant et provocateur, il est tout l’opposé du Dr Jekyll et il semble totalement dominer ce dernier.
J’avais vu le film de Stephen Frears à sa sortie en 1996 mais je ne savais pas qu’il s’agissait d’une adaptation. Ayant gardé un bon souvenir du film, j’étais ravie de pouvoir découvrir le roman. L’excellente idée de Valérie Martin est de nous raconter cette histoire que nous connaissons tous par le biais de Mary Reilly. Le récit est à la première personne et est le journal qu’elle écrit chaque soir. Mary a reçu une éducation dans une école mise en place par le Dr Jekyll pour les défavorisés. Son point de vue sur le Dr Jekyll est naïf, innocent et éperdu d’admiration. A ce titre, Mary Reilly symbolise les premiers lecteurs du roman de Robert Louis Stevenson, ceux qui ne connaissaient pas Mr Hyde. Quelle surprise cela avait du être pour eux, Stevenson ne révèle que dans les dernières pages la double identité de son personnage principal. Valérie Martin reprend d’ailleurs cette construction. Mary Reilly ne comprend qu’à la fin même si elle pressent la vérité bien avant. L’ambiance troublante et inquiétante du roman est fidèle à celle de l’original, le charisme et la perversité de Hyde repoussent et attirent tout à la fois Mary.
« Mary Reilly » est, en plus d’une réinterprétation, un beau portrait de femme. Il n’y a pas de personnage féminin important dans le roman de Stevenson. La science, la médecine sont une affaire d’hommes. Ici, c’est la voix d’une femme du peuple, fragile, maltraitée par la vie que l’on entend. Une femme qui, grâce à l’attention que lui porte le docteur, réussit à s’épanouir, à écrire un journal, a créer un jardin. « Je me disais que la vie me deviendrait insupportable si je perdais ce sentiment de sécurité que j’avais toujours éprouvé dans cette maison, avec ce Maître, qui s’était occupé de moi et m’avait parlé, qui m’accordait une valeur que personne d’autre ne me reconnaissait. » Cette phrase souligne bien également à quel point les serviteurs étaient des gens de l’ombre à l’époque victorienne. Relayés dans les étages inférieurs, leurs rudes tâches devaient se faire en toute discrétion. Valérie Martin montre l’envers du décor, l’harassant labeur de ces domestiques.
De manière originale, Valérie Martin revisite le chef-d’œuvre de Robert Louis Stevenson en nous présentant l’histoire à travers le regard d’une femme de chambre fascinée par le Dr Jekyll et son double maléfique. Une belle réécriture parfaitement maîtrisée.
Une lecture commune avec ma copine Lou.







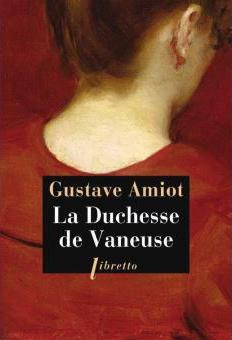


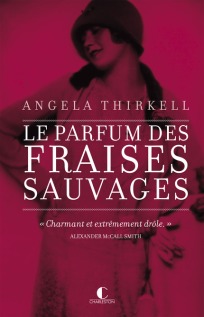

 © Vincent Héquet
© Vincent Héquet




