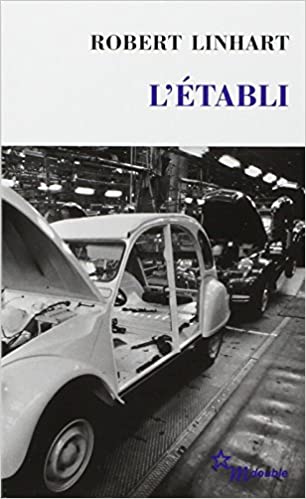La famille Oppermann est très prospère. Leur ancêtre, Immanuel, s’est installé à Berlin et a fondé une entreprise de meubles ainsi qu’une fabrique. Ses petits enfants ont tous des parcours brillants : Gustav est un intellectuel dilettante qui sait profiter de la vie, Edgar est un laryngologue réputé, Martin gère l’entreprise familiale et leur sœur Klara a épousé un fin homme d’affaires, Jacques Lavendel. Nous les suivons, ainsi que leurs enfants, de l’automne 1932 à l’été 1933, dans une Allemagne au bord du gouffre et du chaos.
Lion Feuchtwanger a écrit son roman en 1933, en temps réel. Lui-même a du fuir l’Allemagne cette même année pour la France et ensuite rejoindre les États-Unis en 1940. L’auteur cherchait à alerter ses compatriotes sur les dangers du mouvement völkish et sur la prise de pouvoir d’Hitler en janvier 33. La première partie du roman, intitulée « Hier », se termine sur cet évènement. Les deux autres parties, « Aujourd’hui » et « Demain », extrapolent sur ce qui risque d’advenir. Lion Feuchtwanger est extrêmement lucide, il montre à quel point tout était en germe, les prémices de la catastrophe et de l’horreur étaient bien visibles.
Mais, comme il le montre au travers de ses personnages, beaucoup ne voulaient pas voir. « Arrêtez avec vos histoires à dormir debout. Il n’y a plus de pogroms en Allemagne. C’est fini. Depuis plus de cent ans. Depuis cent quatorze ans, si vous voulez le savoir. Vous croyez que ce peuple de soixante-cinq millions de personnes a cessé d’être civilisé sous prétexte qu’il a laissé la parole à une poignée de fous et de canailles ? Pas moi. Je refuse qu’on fasse cas de cette poignée de fous et de canailles. » Gustav a tellement foi en la culture allemande qu’il fait fi du contexte économique. Pourtant, comme les autres membres de la famille Oppermann, il va voir la violence, la brutalité et l’antisémitisme s’insinuer peu à peu dans leur quotidien.
Gustav est l’un des plus beaux personnages de ce roman, avec son neveu Berthold. Lion Feuchtwanger crée des personnages bouleversants, plongés dans le tourbillon des évènements historiques. Il nous montre comment chacun réagit face à la haine et à la fin du roman il expose un débat très intéressant entre Gustav et son autre neveu Henrich. Que faut-il faire face à la violence et à l’humiliation ? Survivre à tout prix en perdant sa dignité ou relever la tête même s’il faut le payer de sa vie ?
Passionnant, édifiant, nécessaire, il y aurait encore beaucoup d’autres qualificatifs positifs pour décrire ce roman. Une chose est sûre, il faut impérativement le lire.
Traduction Dominique Petit