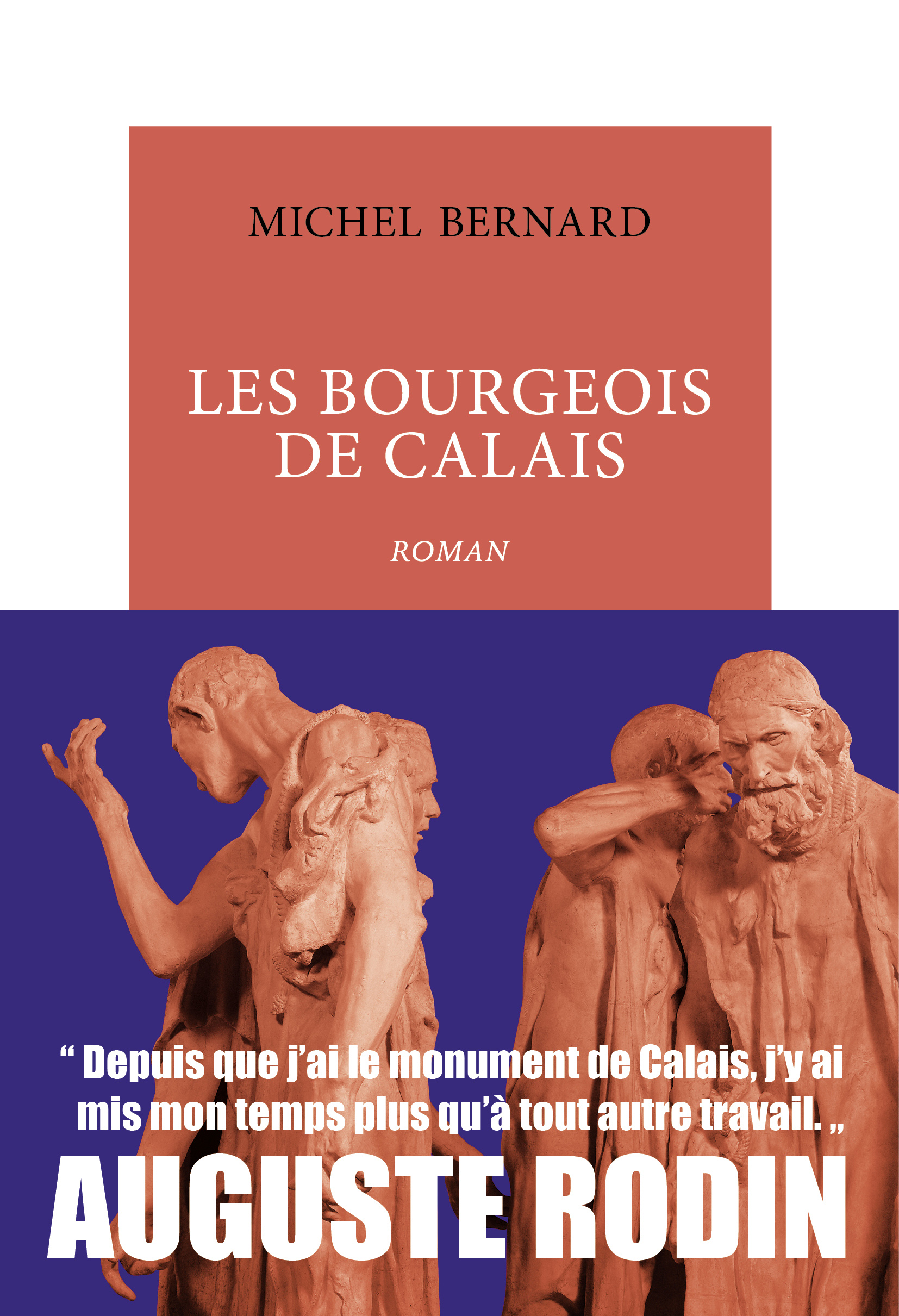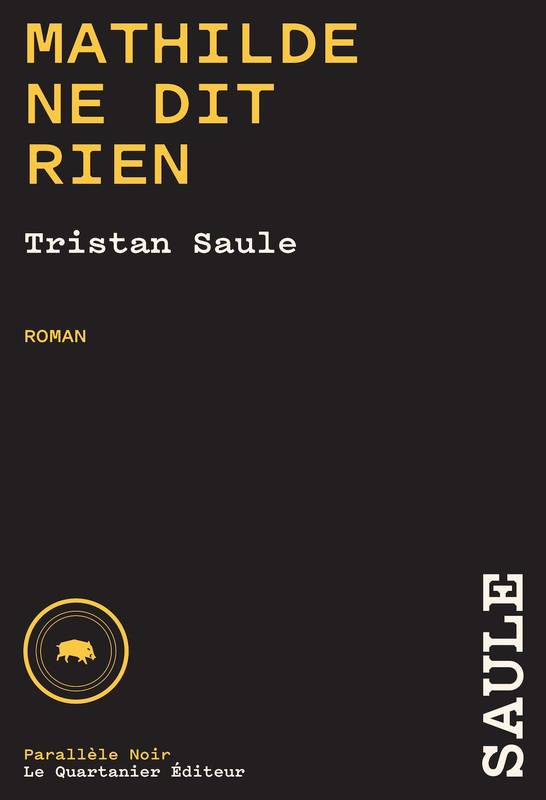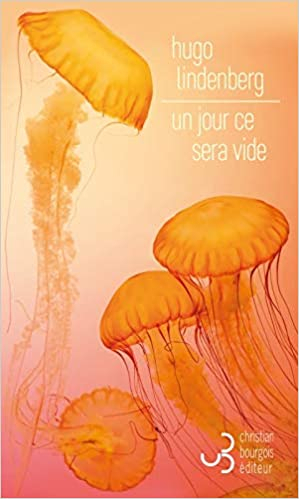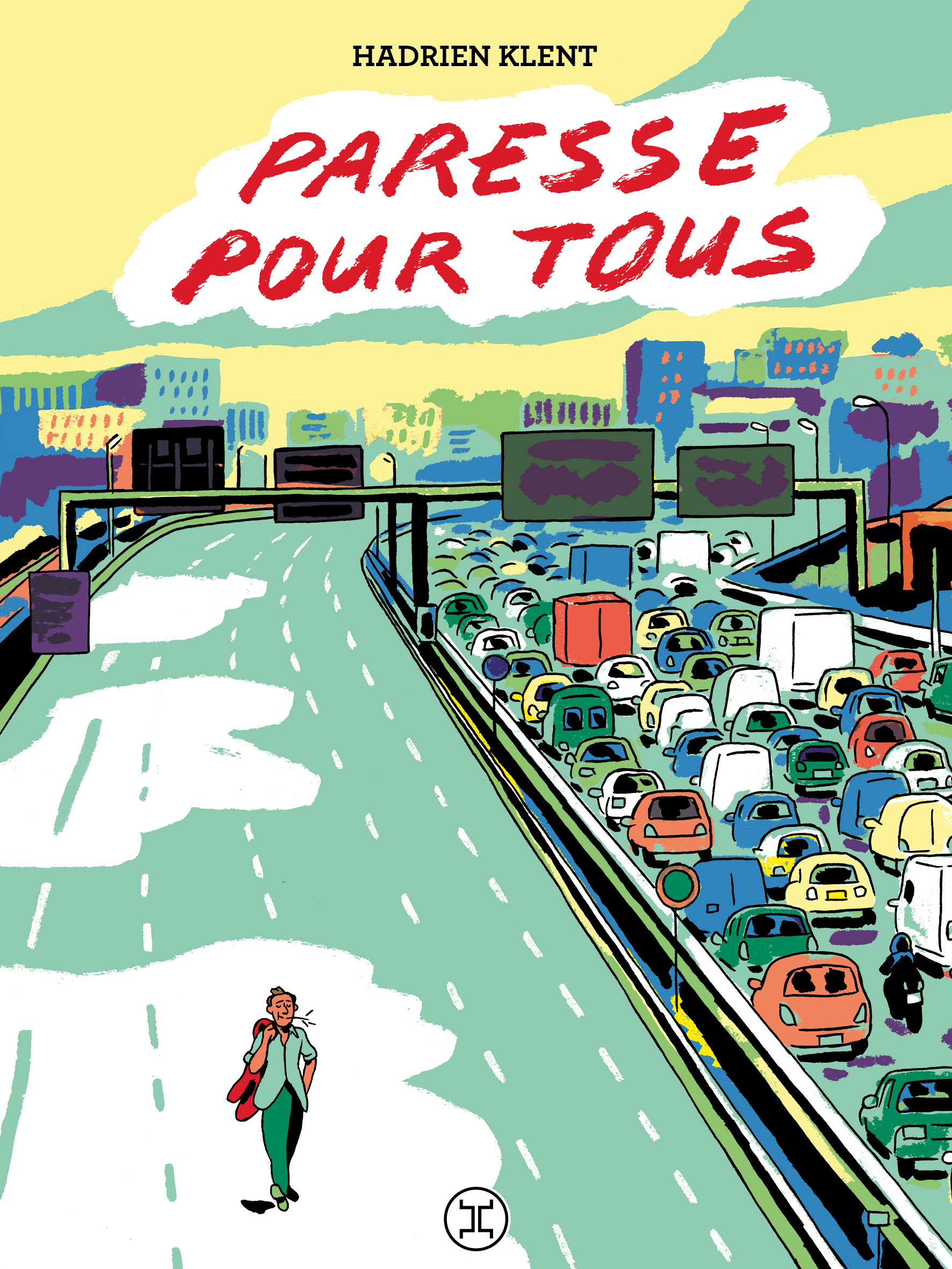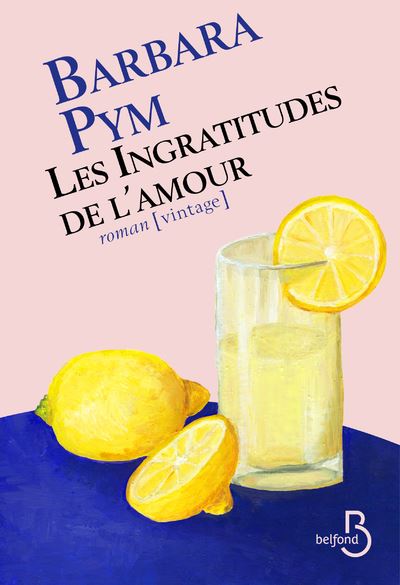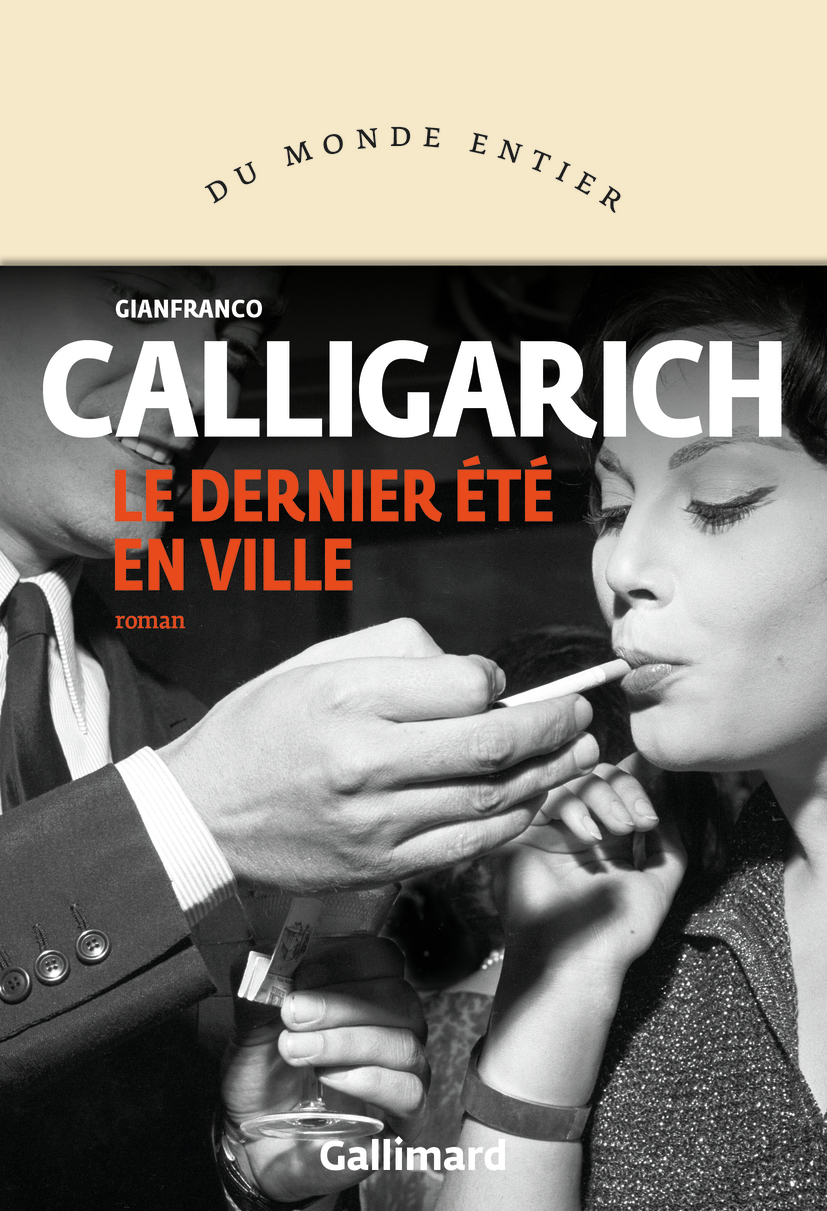Le mois d’août m’a offert un beau mélange de style, les premiers titres de la rentrée littéraires ont côtoyé des livres qui étaient depuis plus longtemps dans ma pal. Je vous reparle de certaines de ces lectures rapidement. Ce qui est certain c’est qu’entre « Les bourgeois de Calais », « Memorial drive », « 8 heures et 35 minutes » et « Le saut d’Aaron », cette rentrée littéraire commence vraiment très, très bien ! J’espère qu’elle me réserve encore de très belles surprises.
Mes coups de cœur cinématographiques du mois d’août sont les suivants :

Milla est une jeune adolescente australienne qui se bat contre un cancer. Elle est surprotégée par ses parents : son père, psychiatre, marche sur des œufs, sa mère, pianiste, se gave de calmants pour réussir à affronter la situation. C’est donc avec beaucoup d’appréhension qu’ils voient débarquer dans leur vie Moses. Milla l’a rencontré sur un quai de gare et s’en est immédiatement entiché. Le jeune homme, junkie, n’a plus de foyer et déboule comme un chien fou dans la vie calme (en apparence) et bourgeoise de cette famille.
« Milla » est un film magnifique, lumineux malgré le drame qui s’y déroule. La réalisatrice, Shannon Murphy, ne tombe jamais dans le sentimentalisme, le tire-larmes facile. C’est avec beaucoup de délicatesse qu’elle filme les derniers jours de Milla. Celle-ci veut vivre ce que vivent tous les adolescents : les premiers émois amoureux avec ce qu’ils ont de douloureux, l’émancipation de ses parents en imposant ses propres choix, découvrir sa féminité. Milla est un personnage infiniment attachant, elle ne gâche pas ce qu’il lui reste à vivre et continue à s’émerveiller de ce qui l’entoure. Elle est le lien entre tous les êtres fracassés qui sont à ses côtés et l’aiment maladroitement. Eliza Scanden incarne Milla et il faut saluer sa performance si merveilleusement juste. Le film de Shannon Murphy est évidemment bouleversant. Mais il est également émaillé de nombreux moments de joie : une journée à la plage, un premier baiser, un joyeux repas avec ceux que l’on aime et finalement ce sont instants-là qu’il faut retenir.

Pays basque, 1609, le juge Rosteguy de Lancre est venue arrêter et interroger des sorcières. Celles-ci sont de jeunes tisserandes dont les fiancés, les pères ou les frères sont partis pêcher à Terre-Neuve. Les jeunes femmes, injustement emprisonnées, savent que les marins reviendront à la pleine lune et qu’ils sont les seuls à pouvoir les sauver. L’une d’elles, Ana, va se dénoncer comme la seule sorcière du groupe et promet au juge de lui raconter le sabbat. Son long récit doit leur permettre de gagner du temps.
« Les sorcières d’Akelarre » est un film fascinant, envoûtant comme le chant scandé par les jeunes filles enfermées. Il reconstitue parfaitement la tyrannie des hommes, de la religion sur les femmes qui sortent des sentiers battus, comme ses tisserandes qui aiment chanter et danser dans la forêt. Le regard concupiscent des hommes les enferme, les juge. Les mots également : durant l’interrogatoire, le juge, cultivé, joue avec eux et fait dévier les propos d’Ana. Les jeunes femmes, fortes et libres, vont se retrouver peu à peu piégées. Le personnage d’Ana célèbre l’imaginaire à travers ses récits au juge, il est son seul échappatoire face au désir brûlant des hommes et leurs croyances absurdes. « Les sorcières d’Akelarre » est un film qui résonne toujours avec notre actualité et qui rend hommage à celles qui vécurent l’enfer pour satisfaire le besoin de domination des hommes.

Samad, policier teigneux, cherche à démanteler un réseau de trafic de drogue. Il remonte lentement les différents maillons de la chaine pour arriver à coincer la tête du réseau. Mais dans un pays qui compte 6,5 millions de toxicomane, sa quête de justice n’est-elle pas veine ?
« La loi de Téhéran » de Saeed Roustayi est un coup de poing qui nous montre la tragique réalité de l’Iran. Samad nous entraîne dans les bas-fonds de la ville où s’entassent des toxicos dans des cylindres de béton. Rapidement, on comprend que c’est la misère qu’ils fuient tous au moyen de la drogue. Et le pire, c’est que le caïd à la tête du réseau est dans le même cas. Difficile de détester cet homme qui s’est lancé dans le trafic pour sortir sa famille de la pauvreté. Et que dire de la justice iranienne ? Que vous soyez en possession de 5 gr ou de 10 kg de drogue, c’est la peine de mort qui vous attend. Alors autant faire les choses en grand comme l’explique le caïd. Une justice où d’accusateur, on peut devenir accusé en un claquement de doigts, comme le découvrira Samad. La réalité montrée par le film est terrifiante, implacable et d’une noirceur sans fin. Je n’ai pas le souvenir d’avoir déjà vu un film montrant ce visage de l’Iran, celui d’une misère sociale endémique et désespérante.

Une femme, scénariste pour la t.v., aime à inventer des histoires après avoir fait l’amour avec son mari. Celui-ci est acteur et metteur en scène de théâtre. Le couple semble heureux et amoureux malgré une terrible épreuve qu’ils ont du surmonter. Pourtant, le mari surprend sa femme, au lit avec un autre homme. Il ne dit rien, repart. Il n’aura jamais l’occasion d’en parler avec elle puisque peu de temps après il la retrouve morte dans leur appartement.
Le prologue du film dure 40 mn avant que le générique ne commence et nous présente le couple. Après celui-ci, nous retrouvons le mari qui doit mettre en scène « Oncle Vania » à Hiroshima avec des acteurs de différentes nationalités. L’une des très belles idées du film, c’est qu’une actrice en langue des signes est engagée pour la pièce. Les moments où elle joue sont d’une grâce infinie. Le silence a une place très importante dans le film de Ryusuke Hamaguchi, la parole est rare et rend les mots prononcés d’autant plus précieux. « Drive my car » met en présence deux personnes qui n’ont pas réussi à faire leur deuil, qui se sont laissées submerger par la tristesse. Le metteur en scène et sa chauffeuse vont s’apprivoiser, s’écouter tout au long de leurs trajets en voiture. D’autres destinées se mêleront aux leurs, d’autres paroles se libèreront. Le lent cheminement des personnages est emprunt de tristesse, d’une douce mélancolie qui finit par mener à l’apaisement, à une possible reconstruction. « Drive my car » dure trois heures et nous offre des images magnifiques, une méditation sur le deuil, le passé et tout cela entremêlé avec les mots de Tchekov.
Et sinon :
- « A l’abordage » de Guillaume Brac : Edouard, jeune homme de bonne famille, attend deux jeunes femmes pour un co-voiturage vers le sud et les vacances. Surprise, ce sont Félix et Chérif qui débarquent et vont accompagner Edouard durant le voyage. Félix veut retrouver dans la Drôme une jeune femme avec qui il a passé la nuit précédente à Paris. Il a emmené avec lui son pote Chérif. Tous les trois vont se retrouver coincés dans un camping suite à un problème de voiture. « A l’abordage » est une comédie solaire, au charme irrésistible où se mélangent les classes sociales et les couleurs de peau. Nos trois jeunes hommes vont se trouver un point commun qui les réunit au-delà de leurs nombreuses différences : ils sont des galériens de la drague. Guillaume Brac suit avec beaucoup de tendresse et d’empathie les mésaventures des trois camarades. Une amitié, au départ totalement improbable, se noue autour d’une bagarre dans l’eau. Les trois comédiens savent rendre leurs personnages attachants : Salif Cissé, Edouard Sulpice, Eric Nantchouang sont très prometteurs. « A l’abordage » est une comédie tout en subtilité, en fraîcheur et en truculence.
- « De bas étage » de Yassine Qnia : Mehdi gagne sa vie en perçant des coffres. Des petits casses sans envergure qui lui permettent tout juste de vivre. L’argent qu’il a mis de côté au fil des ans est parti dans une maison en ALgérie pour la retraite de sa mère. Mais, finalement, celle-ci préfère rester en France obligeant ainsi son fils à habiter avec elle. Cette situation a fait fuir la petite amie de Mehdi, Sarah, qui est également retournée vivre chez ses parents avec leur fils. Mais Mehdi ne compte pas en rester là. Yassine Qnia montre le quotidien de Mehdi et Sarah avec beaucoup de réalisme. Tous les deux se débattent avec leur quotidien et les difficultés financières. Le couple, qui semble toujours amoureux, est dans une impasse. Sarah a trouvé un emploi dans un salon de coiffure, son train-train quotidien semble méprisable aux yeux de Mehdi, tout comme l’est l’argent des casses aux yeux de Sarah. Le réalisateur nous offre deux beaux portraits de jeunes gens paumés, parfaitement incarnés par Soufiane Guerrab et Souheila Yacoub. Les proches de Mehdi changent, évoluent, y arrivera-t-il ? C’est la question que l’on se pose à la fin du film toujours juste de Yassine Qnia.
- « Louloute » de Hubert Viel : Louise est professeur d’histoire-géo et a tendance à s’endormir n’importe où. Elle semble un peu perdue et fantasque. Parmi les nouveaux professeurs, elle retrouve son amoureux de l’école primaire. Ses retrouvailles ne font qu’accentuer la tendance de Louise à se replonger dans ses souvenirs. Elle se revoit à 10 ans dans la ferme familiale en Normandie où son père élevait des vaches laitières. Le film d’Hubert Viel fait donc des allers-retours entre la vie d’adulte et l’enfance de Louise. Nous voilà replongés à la find es années 80 dans une famille de trois enfants où les chamailleries ne cachent pas l’amour fraternel. Louise est rêveuse, très attachée à son père et à son travail à la ferme. Elle s’imagine reprenant l’exploitation avec son frère et sa mère. Derrière cette douce évocation de l’enfance, se cache une difficile réalité, celle de l’agriculture face à la montée du libéralisme. Même si les parents tentent de le cacher aux enfants, les difficultés s’accumulent de plus en plus. Le passé hante quotidiennement Louise et on finit par comprendre pourquoi. « Louloute » est un film touchant, très tendre avec ses personnages.
- « Passion simple » de Danielle Arbid : « A partir du mois de septembre l’année dernière, je n’ai rien fait d’autre qu’attendre un homme : qu’il me téléphone et qu’il vienne chez moi. » La suite du film sera l’illustration de cette phrase qui l’ouvre. Hélène est suspendue au désir de son amant russe, marié et qui travaille pour le consulat de Russie à Paris. Devenue obsessionnelle, cette passion simple va peu à peu vampiriser la vie personnelle et professionnelle d’Hélène. Le film de Danielle Arbid est l’adaptation du livre éponyme d’Annie Ernaux que je n’ai pas lu. Ce que j’ai trouvé le plus réussi dans le film, c’est qu’il rend parfaitement compte de l’attente qui ronge l’héroïne, les effets dévastateurs de cette passion dévorante. Et les scènes de sexe vont dans ce sens, elles ont crues, au plus près des corps, des souffles sans être véritablement sensuelles. Hélène est incarnée par la formidable Laëtitia Dosch qui porte le film sur ses épaules. Elle perd pied et nous touche.
- « Bergman island » de Mia Hansen-Love : Chris et son mari, Tony, sont auteurs-réalisateurs. Tous les deux s’installent le temps d’un été sur l’île de Farö où vivait Bergman et où il a tourné certains de ses films. Chris et Tony doivent chacun écrire un scénario de film durant leur séjour. Tony est également invité sur l’île pour donner une master-class. Il a du succès, trouve l’inspiration aisément alors que Chris peine devant la page blanche. Cette situation finit par créer une tension, une distance dans le couple. Je vous rassure tout de suite, pas besoin d’être spécialiste de Bergman pour apprécier le film de Mia Hansen-Love, même si son ombre plane dessus. L’île de Farö, dont les paysages sont absolument splendides, est presque devenue une sorte de parce d’attraction bergmanien, ce dont s’amuse beaucoup la réalisatrice. Il est ici question d’amour, de couple et ce grâce à celui de Chris et Tony mais également grâce à celui qui sort de l’imagination de Chris. Mia Hansen-Love enchâsse un deuxième récit dans son intrigue de départ, celui du film de Chris et de son tournage. Les deux histoires de couple se font écho, se développent en parallèle devant nos yeux. La construction est habilement menée et questionne également la création et la cruauté de ceux qui se consacrent entièrement à elle.