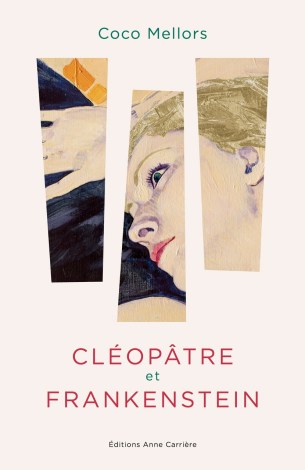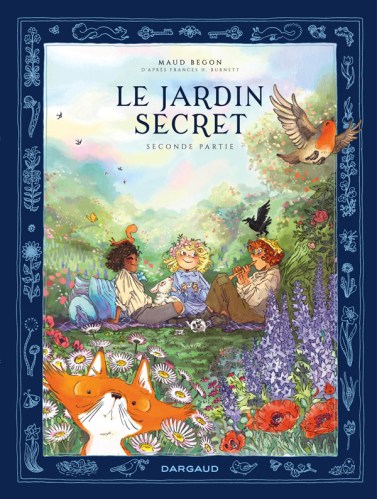Parmi mes lectures de mars, j’ai déjà pu chroniquer le splendide tome 2 du « Jardin secret » de Maud Begon et « Le petit roi » de Mathieu Belezi dont l’écriture m’a totalement éblouie. Je vous parle la semaine prochaine du formidable roman de Timothée Demeillers et du premier roman de Coco Mellers qui décrypte la désagrégation d’un couple qui avait tout pour réussir. Et j’espère vous parler rapidement de l’étonnant roman de Catriona Ward et du sombre « Dernière reine » de Rochette. Je ne ferai en revanche pas de billet sur le dernier titre de mon cher J.M. Erre que je conseille surtout aux aficionados. L’ensemble de son œuvre est en effet évoquée dans ce recueil de textes qui ne sont pas tous aussi hilarants que je l’aurais souhaité. « Les autres ne sont pas des gens comme nous » n’en reste pas moins un livre très agréable et drolatique. Je garde le meilleur pour la fin : « Divorce à l’anglaise », un vrai plaisir de lecture qui m’a permis de retrouver la talentueuse Margaret Kennedy.
Côté cinéma, je suis allée voir huit films dont voici mes préférés :

C’est dans un épais brouillard que le taxi de Julie et sa mère arrive dans un hôtel-manoir de la campagne galloise. Les lieux sont isolés, les deux femmes semblent être les seules clientes de l’hôtel. Julie, qui est cinéaste, tente d’écrire un film sur sa mère. Cette dernière se remémore ses souvenirs et notamment ceux de cette étrange demeure où elle a vécu pendant le seconde guerre mondiale.
L’année dernière, j’avais découvert Joanna Hogg avec « The souvenir part I & part II » qui m’avaient éblouie. Ici la cinéaste nous propose un conte gothique qui mélange l’univers « Des autres » et de « La maison du diable ». L’atmosphère inquiétante est créée par les bruits, par des cadrages particuliers des escaliers, des miroirs, des fenêtres et par une musique ensorcelante. Le manoir semble habité par des fantômes et nous plonge dans une sorte de songe. Tilda Swinton incarne à la fois Julie et sa mère ce qui accentue le trouble causé par les lieux et l’ambiance. Le personnage de Julie est aussi une forme de double de Joanna Hogg. Comme dans « The souvenir », les souvenirs et leurs réminiscences sont au cœur de l’intrigue. A nouveau, j’ai été envoûtée par le cinéma de Joanna Hogg et par la singularité de Tilda Swinton.

Madeleine, une comédienne débutante, est accusée du meurtre d’un producteur de cinéma qui aurait tenté de la violer. Pour la défendre, elle peut compter sur sa colocataire, Pauline, avocate sans clients pour le moment. L’histoire est largement médiatisée et le procès apportera gloire et succès aux deux jeunes femmes.
« Mon crime », tiré d’une pièce de théâtre, est une comédie réjouissante et totalement irrésistible. Ce film d’époque s’amuse avec les thématiques actuelles : dénonciation du patriarcat dans la plaidoirie de Pauline, égalité des droits homme/femme, etc… Les deux jeunes amies sauront profiter de la situation avec beaucoup de malice et d’habileté. Les dialogues virevoltent et sont millimétrés. Le casting est un bonheur absolu. Rebecca Marder et Nadia Tereszkiewicz sont éclatantes et parfaitement complémentaires. Les seconds rôles font également le sel de « Mon crime » : Fabrice Luchini est plus Louis Jouvet que jamais, Dany Boon se régale à jouer le milliardaire attendri par Madeleine, Isabelle Huppert incarne avec brio une actrice cabotine et has been. « Mon crime » est un régal, une comédie enlevée, rythmée où François Ozon met une nouvelle fois en valeur ses acteurs.
Et sinon :
- « Emily » de Frances O’Connor : Pour que les choses soient claires, « Emily » n’est pas un biopic d’Emily Brontë. Le film de Frances O’Connor est une évocation de la personnalité de l’autrice et de l’univers de son unique et fantastique roman « Les Hauts de Hurlevent ». C’est un portrait fiévreux, intense qui souligne le caractère revêche, sauvage et indépendant d’Emily Brontë. On la sent habitée par la fiction et son pouvoir d’imagination effraie son entourage (la scène du masque est sans doute la plus réussie du film). Emma Mackey est absolument parfaite et elle incarne avec beaucoup de force le personnage principal. Il faut également souligner la beauté de la photographie, des paysages (les rudes landes du Yorshire) et des costumes. Si globalement j’ai apprécié le film et la liberté incarnée par cette jeune femme, j’ai également trouvé deux gros défauts : la relation entre Emily et le vicaire n’avait pas besoin d’aller jusqu’au charnel, d’autant plus que l’homme d’église semble très accroché à ses principes moraux ; le deuxième point noir est le fait qu’Emily publie seule son roman et que celui-ci porte son nom. Cela fait oublier la formidable émulation littéraire des sœurs Brontë qui publièrent leurs romans ensemble et sous des pseudonymes masculins.
- « Toute la beauté et le sang versé » de Laura Poitras : Le documentaire de Laura Poitras revient sur le scandale de l’Oxycontin, un anti-douleur à base d’opiacés qui a fait des ravages aux Etats-Unis. Le groupe pharmaceutique le commercialisant appartenait à la famille Sackler qui plaça une partie de ses énormes profit dans le mécénat artistique. Leur nom apparaissait dans de nombreux musées à travers le monde et la photographe Nan Goldin se bat pour que celui soit effacé. Elle fut elle-même victime de leur médicament. Le documentaire raconte à la fois son engagement, son combat acharné et sa vie marquée par de nombreux épisodes douloureux (le suicide de sa sœur, l’hécatombe parmi ses amis au moment de l’apparition du sida). A travers son art, Nan Goldin a cherché à montrer les marginaux, les milieux underground, les homosexuels comme les trans. Son engagement militant cherche également à mettre en lumière les victimes de l’Oxycontin que les Sackler aimeraient faire oublier.Le documentaire, au titre magnifique, est émouvant et marquant. Si le sujet vous intéresse, en 2021, la très bonne série « Dopesick » évoquait ce scandale pharmaceutique.
- « The Fabelmans » de Stephen Spielberg : Dans son dernier film, Steven Spielberg revient sur son enfance et la naissance de sa vocation. Un accident de train dans « Sous le plus grand chapiteau du monde » le ravit et le traumatise. Sa manière de l’exorciser sera de reproduire l’accident avec son train électrique puis de le filmer. Il ne quittera plus jamais sa caméra mettant en scène par la suite des westerns, des films de guerre avec ses camarades. « The fabelmans » est également une saga familiale entre un père scientifique, inventeur et une mère pianiste fantasque. Récit d’apprentissage, naissance d’une vocation, le film de Steven Spielberg touche par le regard qu’il porte sur une famille qui se défait et sur sa découverte de la puissance des images. Entre « Babylon » et « Empire of lights », les cinéastes ne cessent de clamer leur amour pour leur art et nous offre des films réjouissants autant qu’émouvants.
- « Goutte d’or » de Clément Cogitore : Ramsès est médium à la Goutte d’or. Son commerce est florissant, prospère ce que lui reprochent les autres voyants du quartier. Ramsès reçoit les personnes en deuil et il est bluffant. Il semble réellement en contact avec les morts, son arnaque est parfaitement organisée. Mais bientôt son quotidien est perturbé par l’arrivée de jeunes gamins venus de Tanger et qui vivent dans la rue. Ils veulent obliger Ramsès à retrouver l’un de leurs amis disparu. « Goutte d’or » commence comme un film noir, un thriller social nous montrant ce quartier populaire en plein changement. Rapidement, Clément Cogitore nous entraine vers plus d’étrangeté puisque Ramsès sera rattraper par son « don » de médium. Il plongera dans les arrières boutiques de la Goutte d’or avec le groupe de gamins et sera touché par leurs destinées. Toujours parfait et intrigant, Karim Leklou incarne Ramsès qui tombera le masque au fur et à mesure de son exploration de son quartier.
- « Empire of lights » de Sam Mendès : A Margate, Hilary travaille dans un cinéma à l’ancienne, un brin décrépit. Elle est célibataire, borderline et se soigne au lithium. L’ensemble des employés forme une petite famille menée par un directeur paternaliste. Ce dernier profite de la vulnérabilité d’Hilary pour coucher avec elle. Tout change pour elle avec l’arrivée de Stephen, un beau jeune homme noir, à qui elle s’attache fortement. Plusieurs choses m’ont séduite dans le dernier film de Sam Mendès. Tout d’abord, la reconstitution de cette Angleterre thatchérienne où les skinheads insultent et violentent les personnes de couleurs (« This is England » montrait également avec brio la montée en puissance de ces groupes au moment où le chômage explose dans le pays). Ensuite, Sam Mendès livre ici un bel hommage au cinéma et à la puissance de la fiction que va finalement découvrir Hilary. Enfin, il faut saluer la performance d’Olivia Colman, vibrante et émouvante.
- « La syndicaliste » de Jean-Paul Salomé : Maureen Kearney est une syndicaliste inflexible et opiniâtre chez Areva. Lorsque Anne Lauvergeon doit quitter la présidence, l’ambiance se tend entre les nouveaux dirigeants et Maurren. Elle finit par découvrir un transfert de technologie nucléaire entre la France et la Chine via EDF. La syndicaliste se transforme en lanceur d’alerte et va le payer cher : elle est retrouvée ligotée chez elle à une chaise, un A scarifié sur le ventre et un couteau dans le vagin. Un engrenage terrifiant va alors s’engager pour transformer la victime en manipulatrice. L’histoire de Maureen Kearney parait folle et pourtant tout est vrai. Jean-Paul Salomé réalise un film politique qui décortique de manière compréhensible tous les rouages de cette affaire. Pour incarner cette syndicaliste d’exception, il fallait une grande Isabelle Huppert au jeu d’une infinie subtilité.