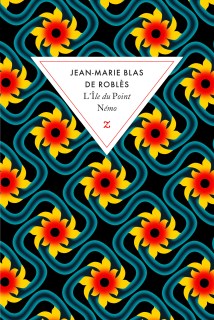En ce mois d’octobre 1686, Nella Oortman âgée de 18 ans, arrive à Amsterdam pour y découvrir ce que sera dorénavant son foyer. Venant de la campagne, elle fut mariée quelques mois plus tôt à Johannes Brandt, un prospère marchand de 39 ans. Arrivée dans sa nouvelle demeure, elle est fraîchement accueillie par sa belle-sœur Marin et les deux serviteurs : Otto, un ancien esclave et Cornelia, une orpheline. Johannes n’est pas présent pour recevoir sa toute jeune épouse. Cette absence, la rigueur de Marin, les moqueries de Cornelia sont bien loin de rassurer la craintive Nella. Les jours suivants vont la conforter dans sa première mauvaise impression. Johannes passe en coups de vent chez lui et surtout il n’honore pas le lit conjugal au grand désarroi de sa femme. Mais il lui fait un présent somptueux pour célébrer leur mariage : une maison de poupées, réplique miniature de leur propre maison : « L’exactitude de la reproduction est fascinante, comme si la véritable maison avait été rétrécie, son corps coupé et ses organes dévoilés. Les neuf pièces, de l’office au salon, jusqu’à l’espace où on garde la tourbe et le bois à l’abri de l’humidité, sont des répliques parfaites. » Nella a toute latitude pour compléter le mobilier de la maison de poupées. Elle fait appel à une miniaturiste qui bientôt va dévancer les commandes et les souhaits de Nella comme si elle savait ce qui se passait chez les Brandt.
« Miniaturiste » est le premier roman de l’anglaise Jessie Burton et il est arrivé en France auréolé de nombreux prix. Les premières pages nous plongent très rapidement dans l’ambiance austère et rigoriste de l’Amsterdam calviniste du 17ème siècle. Il semble que l’auteure se soit beaucoup documentée sur cette période et sur les contradictions de la ville. Les bourgmestres interdisent par exemple de consommer du sucre mais il n’est bien entendu pas interdit de le vendre à l’extérieur. Amsterdam, la prospère, vénère le commerce et l’argent. Une ville où la religion dicte ses lois et où il est tout à fait conseiller de dénoncer les péchés des autres aux autorités. Cela évitait certainement de regarder ses propres entorses à la religion.
Et c’est dans une atmosphère fort gothique que Nella commence sa vie d’épouse. Son arrivée m’a évoqué certains passages de « Rebecca », la jeune et ingénue mariée qui se retrouve guidée et dominée par Mrs Denvers/Marin Brandt. L’ambiance étrange et chargée de mystères va se prolonger pendant toute la lecture et sera renforcée par le côté surnaturel des « révélations » des paquets de la miniaturiste. Ce personnage, dans l’ombre, semble tirer les ficelles de la vie des Brandt ce qui intrigue aussi bien Nella que le lecteur. « Miniaturiste » est bel et bien un page-turner qu’il est difficile de lâcher tant que notre curiosité n’est pas satisfaite. Malheureusement, c’est là que le roman pêche. Les révélations sur la miniaturiste ne furent pas à la hauteur de mes attentes et je les ai trouvées vite balayées par l’auteur.
Malgré ce bémol (n’oublions pas qu’il s’agit d’un premier roman), « Miniaturiste » m’a énormément plu grâce à une intrigue bien ficelée, des personnages attachants et bien campés, un âge d’or d’Amsterdam parfaitement reconstitué. Ne boudons pas notre plaisir, ce roman est extrêmement prometteur.