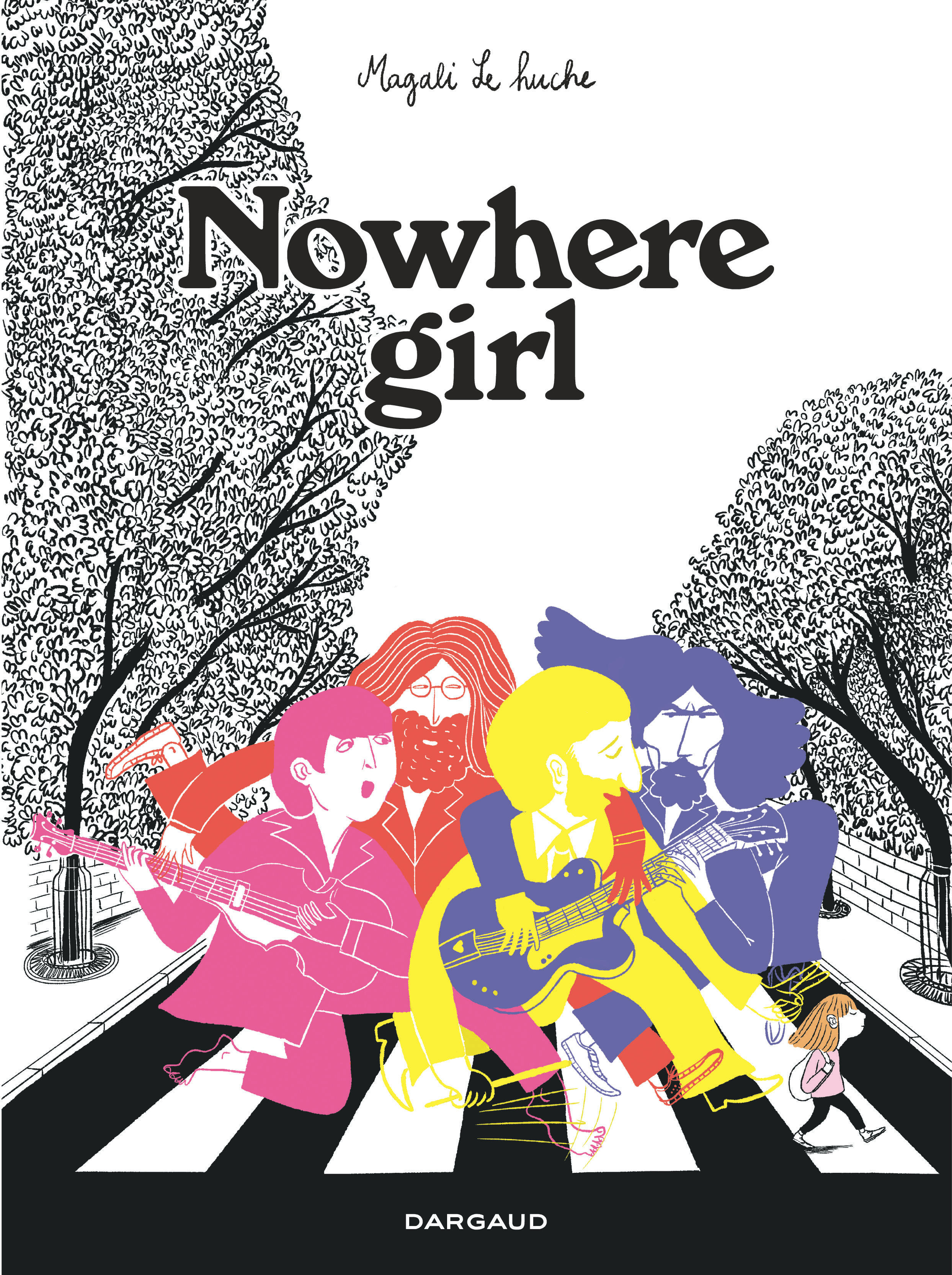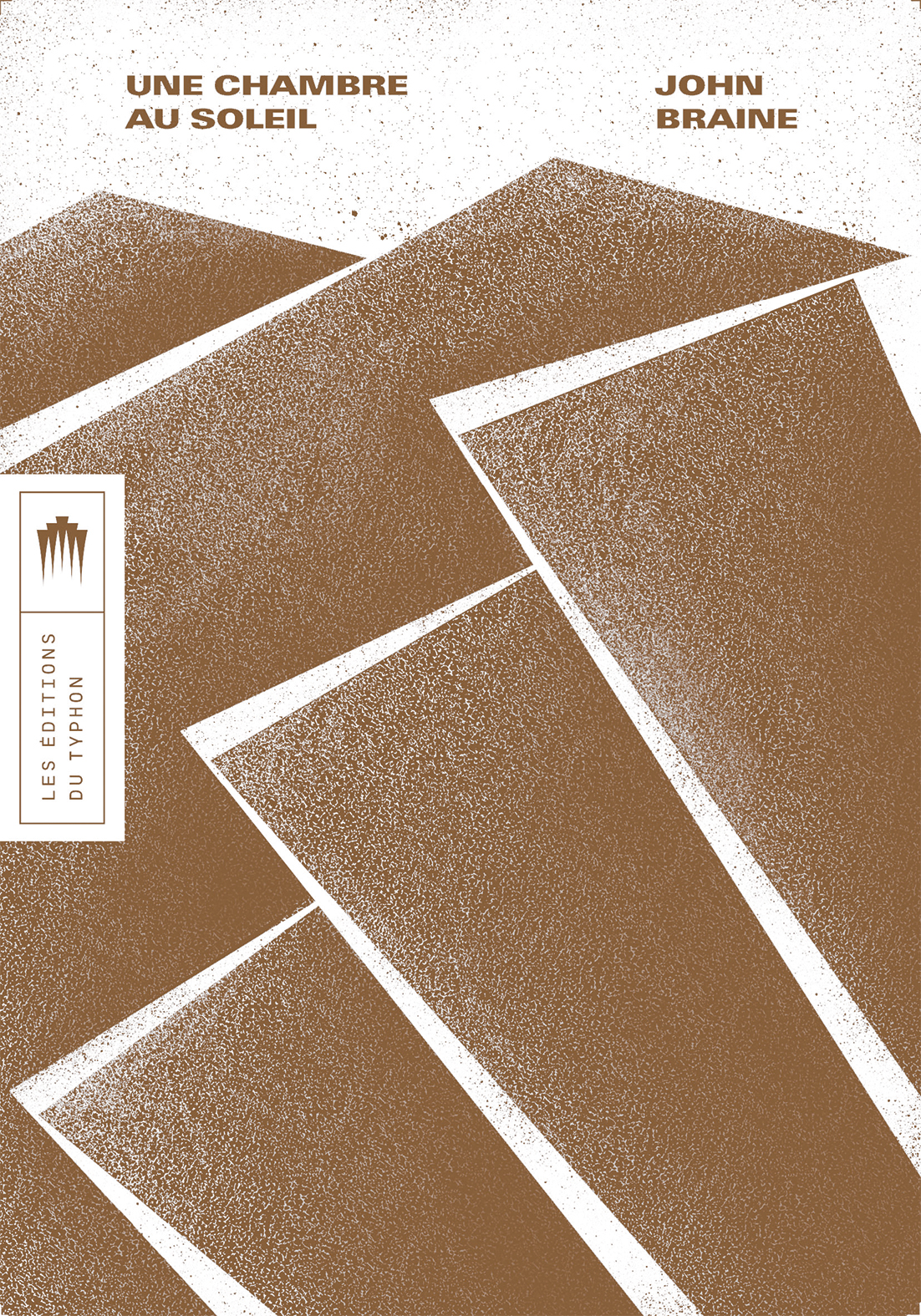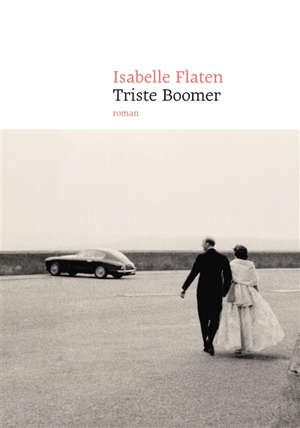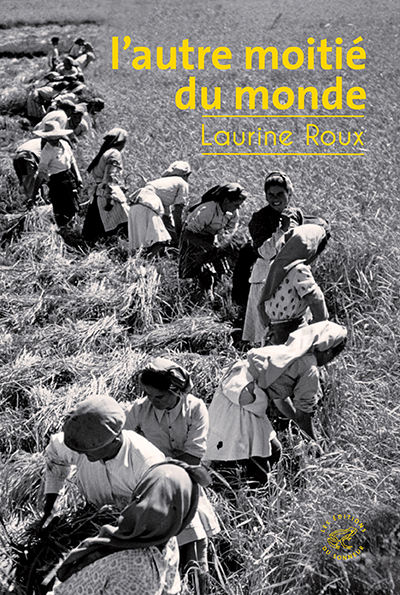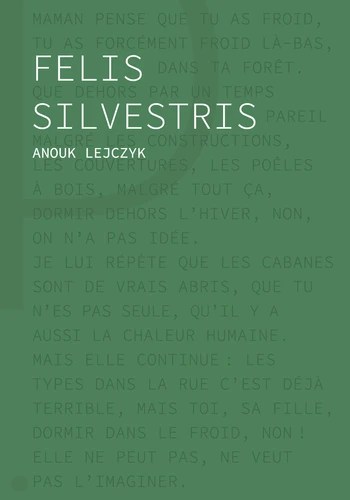Simeon Brown, journaliste afro-américain, a quitté Philadelphie pour s’installer à Paris. Las de subir le racisme ordinaire et la violence des blancs, il trouve la paix dans les rues du quartier latin. Il rencontre de nombreux américains exilés comme lui, il fréquente les terrasses des cafés, les clubs de jazz. Les français le considèrent comme un des leurs. La vie pourrait être idyllique pour Simeon mais il ne peut rapidement plus fermer les yeux sur ce qui l’entoure. Au début des années 60 à Paris, ce sont les algériens qui sont victimes du racisme et de la violence brutale de la police. Simeon se sent de plus en plus mal à l’aise. « Le printemps fut tardif, mais chaud et splendide. Néanmoins, la joie de vibre à Paris refluait pour Simeon ; la guerre d’Algérie faisait quelque chose de terrible à Paris et à la France. A mesure que les colonies africaines gagnaient leur indépendance et que l’empire français rétrécissait, une décomposition s’installait. Simeon le sentait partout autour de lui. »
« Le visage de pierre » a été commencé en 1961 à Paris et fut publié en 1963 aux États-Unis. Il aura fallu attendre 2021 pour qu’il soit traduit en français, ce qui montre à quel point la guerre d’Algérie reste un sujet délicat. William Gardner Smith était journaliste, comme son personnage, et cela se sent dans le dernier chapitre, extrêmement réaliste, qui décrit les massacres du 17 octobre 1961. La brutalité, la haine des unités de police dirigées par Papon (il est toujours bon de le rappeler) glacent le sang.
« Le visage de pierre » est celui des agresseurs, qui ont croisés la route de Simeon, aveuglés par le racisme, remplis de haine et dont le regard est fou. Des flash-backs nous racontent ce que signifie être noir aux États-Unis et ce que le personnage a fui. Mais ce que comprend Simeon, c’est que le visage de pierre existe partout. Dans son roman, William Gardner Smith décrit toutes les formes de racisme qui touchent les noirs, les algériens mais également l’antisémitisme. La détestation de l’autre n’est pas réservé à un peuple, une culture. Et finalement, « Le visage de pierre » est le récit d’un éveil politique, d’une prise de conscience morale.
Je ne peux que vous conseiller de lire « Le visage de pierre » pour mieux comprendre l’atmosphère qui régnait au début des années 60 à Paris et pour redécouvrir un épisode peu glorieux de notre histoire.
Traduction de Brice Matthieussent