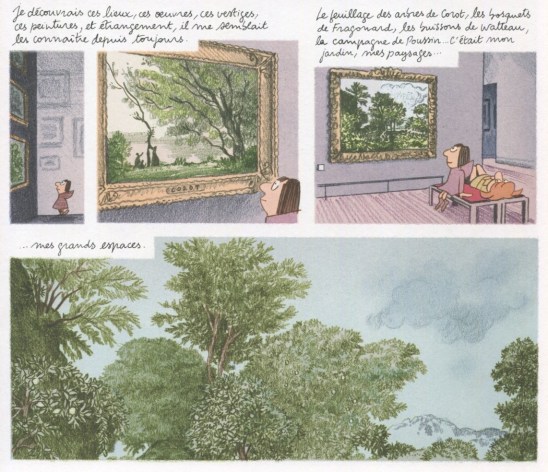La vie et la redécouverte de la photographe Vivian Maier a de quoi fasciner. A l’aide d’une documentation solide, Gaëlle Josse entreprend de nous raconter la vie de cette femme mystérieuse et secrète. L’auteure nous montre une femme éprise de liberté (en 1959, elle fera seule le tour du monde pendant 9 mois) qui prenait en photo les déclassés du rêve américain : les marginaux, les exclus, les noirs, les Hispanos. « Sa distance de déclenchement, sa proximité avec le sujet est celle que je ressens comme « la bonne distance ». Au contact. Directe. Clochards, ouvriers épuisés, ivrognes ramassés par la police, enfants de la rue, couples de tous les âges, adolescents. Ils la regardent. Elle les voit. Elle les reconnaît. Photographier, c’est incorporer le sujet, symboliquement. Pour cette raison-là, et pour nulle autre, il n’y a pas de voyeurisme dans son travail, en dépit des scènes de disgrâce, de désespoir, d’abandon. »
Gaëlle Josse explique également parfaitement à quel point Vivian Maier était un être paradoxal. Vivian est une photographe née, elle a pris des milliers de clichés, ne se séparait jamais de son appareil photo. Mais jamais elle n’a montré un seul de ses clichés. (Gaëlle Josse la compare à d’autres artistes dont le geste artistique était vital sans que cela leur apporte une notoriété de leur vivant : Ossip Mandelstam, Fernando Pessoa ou Franz Schubert). Pire, elle n’en fit développer que très peu. Autre paradoxe à son propos, l’avis des gens sur elle. Elle fut nurse, certains enfants gardent d’elle un souvenir ému (trois frères la sauveront de la misère à la fin de sa vie) et d’autres disent qu’elle fut une tortionnaire. La personnalité de Vivian Maier se dérobe sans cesse et l’on ne peut savoir si elle aurait apprécié la notoriété qui lui a été offerte par la découverte de ses photos par John Maloof en 2007.
Le livre de Gaëlle Josse est d’ailleurs lui-même paradoxal. L’auteure souligne bien le mystère de cette personnalité mais cela met son sujet trop à distance. J’ai trouvé que Vivian Maier était désincarnée, trop lointaine. Peut-être est-ce également dû au côté très factuel de cette biographie, très linéaire. Une personnalité comme celle de Vivian Maier aurait peut-être mérité un peu plus de fantaisie, d’originalité.
Malgré une belle écriture et un travail documenté, « Une femme en contre-jour » n’a pas su me séduire et je n’ai pas senti de plus-value par rapport au documentaire » A la recherche de Vivian Maier » que j’avais vu à sa sortie en 2014. Néanmoins, je conseillerais cette biographie à ceux qui ne connaîtrait pas du tout la vie romanesque de la photographe.