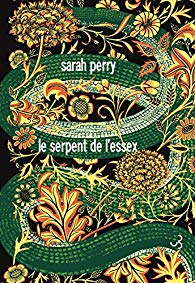Le froid nous saisit, c’est le moment rêvé pour filer sous la couette avec un bon livre et un thé bien chaud ! J’en ai lu quatre ce mois-ci : le formidable premier roman de Adeline Dieudonné, le très bel hommage de Vanessa Schneider à sa cousine Maria, le dernier roman de Maylis de Kerangal qui m’a malheureusement déçue et je poursuis ma lecture de l’ensemble des Rougon-Macquart dans l’ordre avec « Germinal ». J’ai également pu lire deux bande-dessinées dont je n’ai pas eu l’occasion de vous parler : l’excellente adaptation de « Profession du père » de Sorj Chalandon par Sébastien Gnaedig et « Gramercy Park » de Timothée de Fombelle et Christian Cailleaux dont j’ai beaucoup apprécié le dessin.
Un excellent mois au niveau du cinéma avec des films de grande qualité dont trois coups de cœur :

Jacques débarque sans prévenir, en peignoir et claquettes, dans la communauté Emmaüs dirigée par sa sœur Monique. Toute sa vie, il a rêvé d’être immensément riche. Il admire Bill Gates et Bernard Tapie. Et cette fois, il en est sûr, il a trouvé l’idée qui va lui permettre d’accéder à son rêve. Il veut rendre beaux les plus pauvres et il veut leur proposer une chirurgie esthétique low-cost. Monique essaie de canaliser son frère tout en ne le contrariant pas. Quel plaisir de replonger dans l’univers de Kervern et Delépine ! Entre Groland et les Deschiens, ces deux-là s’intéressent toujours aux déclassés, aux cabossés du libéralisme qui broie sans vergogne les plus faibles, les plus tendres. La communauté Emmaüs du film existe vraiment et montre une alternative à notre consumérisme effréné. C’est toujours avec beaucoup de tendresse, d’humanisme que les réalisateurs posent leur regard sur les autres. Même sur Jacques, qui incarne tout ce qu’ils détestent, mais qui est au fond perdu, un peu idiot. Yolande Moreau et Jean Dujardin sont excellents chacun dans leurs rôles, elle en grande sœur lunaire et lui battant pathétique. C’est foutraque, extrêmement drôle et d’une grande humanité.

La femme d’Olivier quitte son foyer sans laisser aucune trace, aucune explication. Olivier, contremaître dans une usine, se retrouve seul face à ses deux enfants. Il doit apprendre à gérer son travail, les contraintes liées aux emplois du temps des enfants tout en cherchant sa femme. Perdu, débordé, Olivier peine à tout concilier et cherche l’aide temporaire de sa mère ou de sa sœur. Le film de Guillaume Senez est formidablement sensible et subtil. Il réussit à capturer les deux pans de la vie d’Olivier : son quotidien au travail et celui auprès de ses enfants. Le film est à la fois un film social (le début parle du suicide d’un employé près à être licencié en raison de son âge) et un film intime (la reconstruction de la famille après la disparition de la mère). Romain Duris est Olivier, son interprétation est magistrale de vérité, de profondeur et de sensibilité. Le comédien a également de très belles scènes avec Laëtitia Dosch, toujours aussi fantasque et confondante de naturel. « Nos batailles » est au plus près des combats quotidiens d’Olivier, de sa fatigue, de la grisaille de son travail à l’usine, de sa volonté de ne pas s’écrouler pour ses enfants. Une belle chronique sur un homme attachant et émouvant.

Lara, 15 ans, veut devenir danseuse étoile. Elle souhaite intégrer une école à Bruxelles qui la prend à l’essai. Lara a en effet beaucoup de retard par rapport aux autres danseuses. Sa technique est excellente mais Lara débute sur les pointes. Elle est en effet née garçon et c’est dans ce genre qu’elle a appris à danser. Il lui faut donc travailler dur, très dur pour être à la hauteur de ses camarades. Dans le même temps, Lara commence un traitement hormonal préalable à l’opération qui fera d’elle une femme à part entière. Mais son corps tiendra-t-il le coup ? « Girl » est le premier film de Lukas Dhont et il est bluffant de maîtrise et d’une force incroyable. Le personnage de Lara est de ceux que l’on oublie pas. Le réalisateur ne la lâche pas. Elle est d’une ténacité, d’une détermination folles. Et d’une terrible impatience malgré un père bienveillant qui l’accompagne à chaque étape de sa transformation. Ce que montre Lukas Dhont c’est un corps souffrant, un corps indésirable que Lara combat avec violence. Elle semble totalement prisonnière de cette identité qui ne lui correspond pas. Ce corps, ce visage angélique et mutique, sont ceux de Victor Polster. Sa performance est proprement extraordinaire. Il se donne corps et âme à ce rôle, épousant les douleurs, les doutes, les espoirs de Lara. Un film à voir absolument.
Et sinon :
- « Le grand bain » de Gilles Lellouche : Bertrand fait une dépression depuis plusieurs années. Il se fait embaucher par son exécrable beau-frère comme vendeur de meubles. Pour se changer les idées, il s’inscrit à un club de natation synchronisée pour hommes. Il y retrouve une bande de quadra-quinquagénaires aussi en difficulté que lui : Simon qui travaille dans une cantine le jour et fait des concerts de hard-rock le soir dans des salles des fêtes, Thierry est un gardien de piscine lunaire et moqué, Marcus est au bord de la faillite, Laurent vient de se faire larguer par sa femme. Leur entraîneuse n’est pas tellement mieux, c’est une ancienne alcoolique qui vit dans le passé. La petite troupe décide pourtant de participer aux championnats du monde de natation synchronisée. Le premier film de Gilles Lellouche fait bien entendu penser à « The full monty » version natation synchronisée. On y retrouve des hommes au bout du rouleau qui sont loin d’être des sex-symbols et qui vont se transcender dans une activité qui sort de l’ordinaire. Ce sont des hommes fragiles, conscients de leurs faiblesses et qui n’ont plus peur de l’avouer. Ensemble, ils relèvent la tête et c’est cette solidarité qui est mise en avant. Gilles Lellouche allie dans son film les scènes de groupe et les scènes intimes ce qui rend particulièrement touchants ces personnages. Bien entendu, il y a également beaucoup d’humour et des dialogues particulièrement bien écrits qui font mouche. Le casting est irréprochable, tous les acteurs sont particulièrement bien choisis et tous jouent leurs partitions à merveille. Une comédie française comme on aimerait en voir plus souvent.
- « Dilili à Paris » de Michel Ocelot : Dilili est venue de Nouvelle Calédonie pour être exposée aux yeux des parisiens dans un village indigène reconstitué. Fort heureusement pour elle, elle fit la rencontre d’une comtesse durant le voyage qui la prend sous son aile. C’est habillée comme une jolie poupée avec dentelles et nœuds qu’elle part visiter Paris. Elle le fait à bord du triporteur du bel Orel. A travers son voyage, Dilili rencontre les personnages les plus brillants de l’époque : Marie Curie, Louise Michel ( qui fut son institutrice en Nouvelle Calédonie), la cantatrice Emma Calvé, Toulouse-Lautrec, Marcel Proust, Matisse, Suzanne Valadon, Erik Satie, Louis Pasteur, etc… Mais les trajets dans la capitale française ne sont pas que joyeux car des jeunes filles sont enlevées. On soupçonne une secte, les Mâles-Maîtres, d’être derrière ces rapts. Dilili et Orel deviennent enquêteurs. Encore une fois, Michel Ocelot nous émerveille. Il mêle dans « Dilili à Paris » des photographies de Paris à ses dessins. Le résultat est surprenant, le Paris 1900 semble revivre devant nos yeux. Michel Ocelot semble s’être beaucoup amusé en composant sa galerie de personnages célèbres. Dilili est heureuse de les rencontrer et pourra probablement éveiller la curiosité des jeunes spectateurs qui assisteront à ses aventures. Mais le film n’est pas qu’une simple carte postale. L’enquête, qui fait penser à Gaston Leroux et Maurice Leblanc, est bien menée et elle se double de propos féministes. De quoi ravir les petits comme les grands.
- « L’amour flou » de Romane Bohringer et Philippe Rebbot : Romane Bohringer et Philippe Rebbot ont décidé de se séparer. Il ne s’aime plus assez pour continuer à partager leur quotidien. Mais comment faire pour que leurs deux enfants n’en pâtissent pas ? C’est Romane qui trouve la solution : un grand appartement séparé en deux avec une pièce centrale qui communique avec les deux parties : la chambre des enfants. Mais comment refaire sa vie quand son ex habite juste à côté ? Les deux acteurs racontent, à travers ce film, leur véritable séparation, on y croise d’ailleurs leurs familles respectives. Mais l’autofiction se mélange à l’imagination comme le personnage de Reda Kateb, amoureux fou de sa chienne et qui lui parle comme à un enfant. « L’amour flou » est à l’image du couple : fantasque, bohème, drôle et surtout plein de tendresse. Et c’est toujours un plaisir de voir la silhouette dégingandée et lunaire de Philippe Rebbot !
- « Frères ennemis » de David Oelhoffen : Imrane et Manuel font du trafic de drogue. Lors d’une sortie de leur cache, Imrane est assassiné en pleine rue. Manuel en réchappe, se planque mais il devient rapidement suspect dans leur cité. Le fait qu’il soit encore en vie ne plaide pas en sa faveur. Une personne va lui proposer son aide : Driss, un policier des stups. Le flic et le voyou ont grandi ensemble dans une cité des Lilas. Ils sont les deux côtés d’une même pièce, peu de choses les séparent. « Frères ennemis » est un bon polar à l’ancienne, sous tension du début à la fin et où l’intime prend une place essentielle dans l’histoire. Les états d’âme de Driss et Manuel, leurs confrontations, leurs souvenirs communs font tout le sel du film de David Oelhoffen. Autre atout majeur : deux acteurs remarquables et intenses Reda Kateb et Matthias Schoenaerts. Leur face-à-face est un grand plaisir cinématographique.
- « The little stranger » de Lenny Abrahamson : Le docteur Faraday est devenu médecin de campagne dans la petite ville qui l’a vue grandir. Il recroise la route de la famille Ayres et leur manoir Hundreds Hall où sa mère fut employée de maison. Fasciné par cet endroit depuis son enfance, il décide tout naturellement de soigner le fils Ayres, revenu gravement blessé de la deuxième guerre mondiale. Hundreds Hall n’abrite plus que Mrs Ayres, sa fille, son fils et une jeune domestique. Le docteur Faraday va découvrir que d’étranges événements se déroulent derrière les murs du manoir. « The little stranger » est adapté d’un roman de Sarah Waters, traduit en français sous le titre « L’indésirable ». L’ambiance est l’atout principal du film. Elle est inquiétante, pesante, gothique au possible ! Domhnall Gleeson est également remarquable, glaçant et presque fantomatique. Les autres acteurs sont très bien, le casting est haut de gamme avec Ruth Wilson et Charlotte Rampling. Mais il s’agit là d’une adaptation un peu lisse, très classique dans sa réalisation, soignée dans les décors et les costumes mais manquant un peu d’épaisseur, de relief.