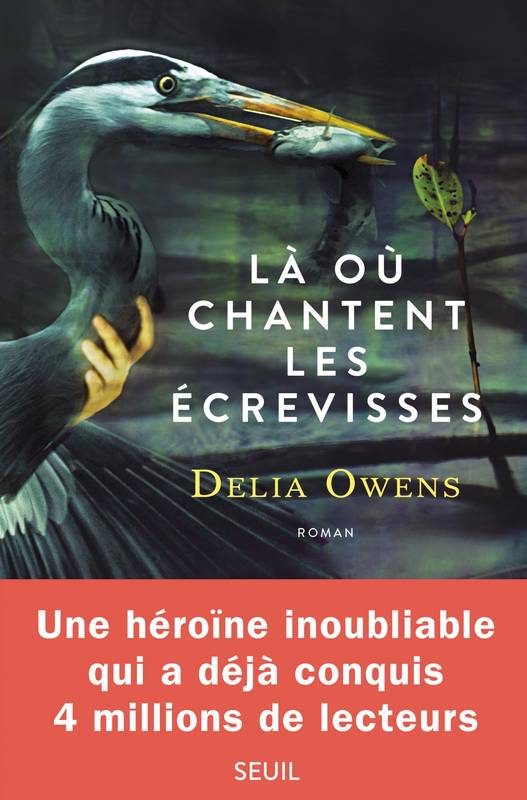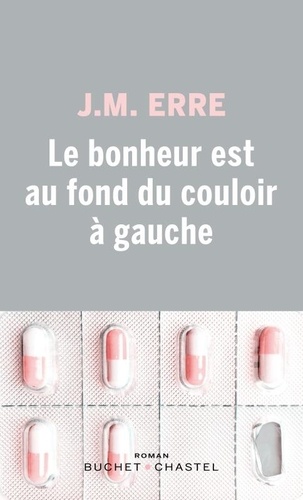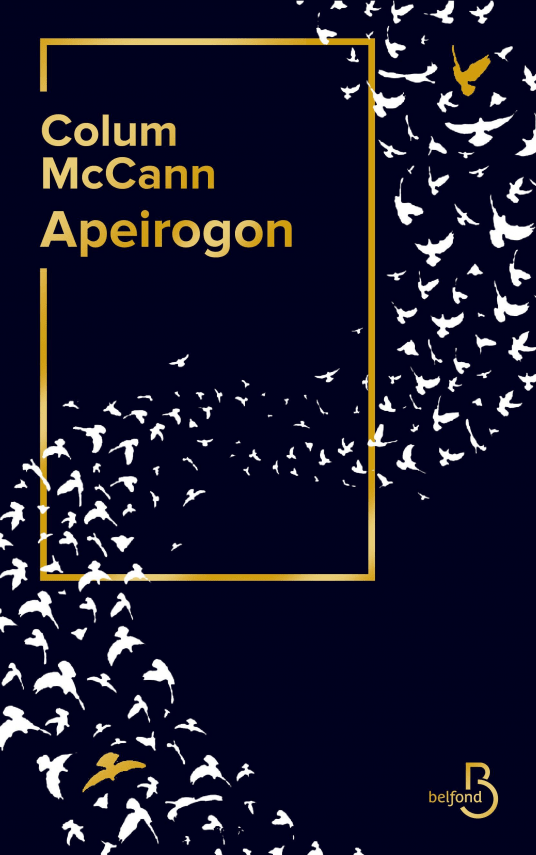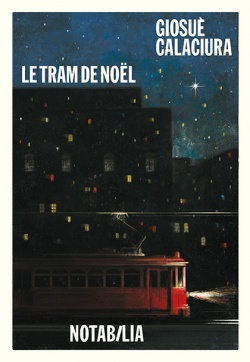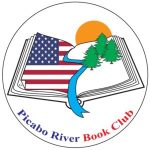Voilà une drôle d’année qui s’achève et, à l’heure où je vous écris, les cinémas, les théâtres et les salles de concert n’ont toujours pas de date de réouverture. Durant cette année, j’ai lu 129 livres dont 10 bande-dessinées dont voici mes coups de cœur :

1- En tête de mon classement, « Étés anglais » et « A rude épreuve » de Elizabeth Jane Howard qui sont les deux premiers volumes de la saga familiale consacrée à la famille Cazalet. La plume est élégante, les personnages attachants et leur psychologie approfondie. Un projet ambitieux qui tient toutes ses promesses et dont j’ai hâte de découvrir le volume suivant.
2- « La maison dans l’impasse » de Maria Messina qui montre l’enfermement physique et mental de femmes siciliennes dans les années 1900. Un roman remarquablement écrit et percutant.
3- « Fille, femme, autre » de Bernardine Evaristo qui dresse le portrait de douze femmes noires dans l’Angleterre d’aujourd’hui. Ambitieux, foisonnant, ce roman est également audacieux dans sa forme.
4- « Le cœur de l’Angleterre » de Jonathan Coe que j’ai toujours grand plaisir à retrouver et qui retrouve ici sa veine politique. En reprenant les personnages de « Bienvenue au club » et « Du cercle fermé », il continue à analyser son pays, ici post-Brexit et c’est là qu’il est le plus brillant, le plus incisif.
5- « Vie de Gérard Fulmard » de Jean Echenoz, l’un de mes écrivains préférés nous a livré cette année un roman réjouissant, drôle et toujours dans une langue épurée et d’une précision redoutable.
2020 fut également l’occasion de découvrir de nouvelles plumes que je vais suivre à l’avenir avec grande attention : « Le dit du mistral » d’Olivier Mak-Bouchard, « Le chien noir » de Lucie Baratte, « Ohio » de Stephen Markley et « Je suis la bête » d’Andrea Donaera. Quatre romans fort différents mais pour lesquels j’ai eu un véritable coup de cœur.
Mon année 2020 fut également marqué par Émile Zola. J’ai achevé la lecture de l’ensemble des volumes des Rougon-Macquart avec des découvertes magnifiques comme « La conquête de Plassans », des confirmations comme « L’assommoir » qui reste le meilleur de cette série ou des déceptions comme « Au bonheur des dames » qui m’a malheureusement ennuyée alors qu’il m’avait laissé un bon souvenir. Et puis, il y a « La faute de l’abbé Mouret » qui est hors-classement tellement je le déteste et le considère comme totalement raté. J’ai complété les Rougon-Macquart avec deux BD : « Les Zola » de Méliane Marcaggi et Alice Chemana qui met en lumière les femmes qui ont entourées l’écrivain, « L’affaire Zola » de Jean-Charles Chapuzet, Christophe Girard et Vincent Gravé qui revient sur l’affaire Dreyfuss et émet l’hypothèse de l’assassinat de Zola. Cette thèse était également défendue dans le formidable roman de Jean-Paul Delfino intitulé « Assassins ! ». Je n’ai pas pu vous en parler ici mais il rend parfaitement compte du contexte politique et social de l’époque. Enfin, quand nous pouvions encore nous rendre au théâtre, j’ai eu le plaisir de voir « Madame Zola » au théâtre Montparnasse qui rendait un bel hommage à Alexandrine Zola avec une Catherine Arditi absolument extraordinaire dans ce rôle.
Enfin, je voulais à nouveau vous conseiller le formidable « Honoré et moi » de Titiou Lecocq qui fut une lecture enthousiasmante au ton enlevé, drôle mais également plein d’empathie pour Honoré de Balzac.
Malgré le peu de films vus cette année (à mon grand désarroi), voici mon top cinq qui comportent plusieurs comédies pour nous remonter le moral :

1- « Un divan à Tunis » de Manele Labidi est une comédie pétillante sur une jeune psychanalyste qui décide d’installer son cabinet à Tunis après avoir été formée en France. Le film nous offre une formidable galerie de personnages et une lumineuse Golshifteh Farahani qui vaut à elle seule le visionnage de ce film.
2- « Tout simplement noir » de Jean-Pascal Zadi qui est faux documentaire, une vraie farce mais également un état des lieux de la visibilité des noirs en France. Le constat est loin d’être réjouissant.
3- « Effacer l’historique » de Gustave Kervern et Benoit Delépine où le duo décapant montre l’absurdité de notre monde connecté.
4- « Michel Ange » de Andreï Kontchalovski qui montre la réalité de la vie de ce génie au caractère terrible, tourmenté et complexe. J’ai beaucoup apprécié la reconstitution non édulcorée de la vie à la Renaissance et la prestation de Alberto Testone.
5- « Felicità » de Bruno Merle qui m’a fait penser à « Little miss Sunshine » pour l’humour et la famille dysfonctionnelle. Pio Marmai fait encore une fois merveille de ce rôle de père décalé, sans cesse en mouvement et en marge de la société.
2021 débute à peine et je ne peux qu’espérer que cette nouvelle année me permettra de retrouver rapidement le chemin des salles obscures.