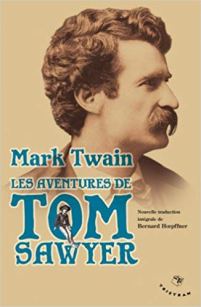Le mois d’octobre est terminé et huit romans m’ont accompagnée pendant que les feuilles jaunissaient doucement. J’ai déjà eu l’occasion de vous parler de certains d’entre eux : le splendide « Le ghetto intérieur » de Santiago H. Amigorena (quelqu’un peut-il m’expliquer pourquoi ce livre n’est plus en lice pour le prix Goncourt ???), « Mon territoire » de Tess Sharpe un polar féministe très réussi, « Automne » de Ali Smith un roman original et parfois déroutant et « 19 femmes, les syriennes racontent » de Samar Yazbek sur la révolution syrienne vue par les femmes. Je vais vous parler très bientôt du deuxième roman de Kevin Powers, « L’écho du temps », une fresque historique ambitieuse, « L’arbre aux fées » de B. Michael Radburn, un polar classique se déroulant en Tasmanie, »Où vont les fils » de Olivier Frébourg qui interroge notre époque et son enfance et « Girl » le dernier roman de la grande romancière irlandaise Edna O’Brien.
Côté cinéma, trois films ont marqué mon mois d’octobre :

Maria, professeure de droit, est volage. Elle collectionne les aventures avec ses étudiants. Richard, son mari, tombe un soir sur des échanges de sms entre sa femme et l’un de ses amants. Il est dévasté. Maria ne comprend pas, après 20 ans de mariage avoir des amants lui semble évident. Richard, lui, est resté fidèle. Le couple se dispute et Maria part s’installer dans une chambre d’hôtel en face de son appartement. Elle peut ainsi observer son mari qui se morfond en chaussette et vieux gilet. Mais, dans la chambre de l’hôtel, surgit le passé de Maria : Richard a l’âge de 25 ans.
Le dernier film de Christophe Honoré est absolument irrésistible. Il s’agit d’une comédie du remariage d’une légèreté infinie. Nous sommes dans le vaudeville où les amants se cachent derrière des rideaux. Maria virevolte d’un homme à un autre tout en aimant toujours son mari. Mais après 20 ans, l’usure, le quotidien transforment le couple en une relation plus amicale. L’idée magnifique du film est de faire resurgir Richard à 25 ans mais également sa prof de piano dont il était amoureux avant de rencontrer Maria. Spectateur, nous voyageons entre le passé et le présent mais également l’avenir au bord d’une plage. Les dialogues, les mouvements de caméra apportent beaucoup de fantaisie et de drôlerie à cette histoire entre rêve et réalité. Doucement, Christophe Honoré pose des questions sur la longévité d’un couple, sur les choix de vie que l’on réinterroge, sur les rêves que les personnages avaient à 20 ans. Et quel casting ! Le quatuor principal est un bonheur absolu : Chiara Mastroianni toute en légèreté, en frivolité (je ne cesserai jamais de regretter de la voir si peu sur grand écran), Vincent Lacoste jouant toujours de sa nonchalance naturelle, Camille Cottin toute en gravité qui tente de reconquérir son amour perdu et Benjamin Biolay déprimé et se laissant dériver après le départ de sa femme. Ce film est tout simplement un régal !

Après toute une série de petits boulots, Ricky devient chauffeur-livreur pour une plateforme de vente en ligne. Il devient auto-entrepreneur dont on lui vante la liberté. Le rythme devient rapidement infernal. Sa femme travaille également beaucoup comme aide à domicile pour des personnes âgées ou handicapées. Tous deux sont rarement à la maison, leurs deux enfants sont livrés à eux-mêmes. Et cela finit par mal tourner pour fils adolescent.
« Moi, Daniel Blake » devait être le dernier film de Ken Loach mais l’ubérisation de la société le met tellement en colère qu’il a repris sa caméra. A 83 ans, son cinéma n’a rien perdu de son indignation et ses convictions sont toujours fortes. Il montre parfaitement bien l’engrenage dans lequel s’enferme Ricky. La soi-disant liberté promise se transforme rapidement en esclavage (les chauffeurs doivent faire pipi dans une bouteille en plastique, pas le temps de s’arrêter si on veut respecter les cadences). La famille se délite devant nos yeux, alors que cette famille est unie, aimante, cherchant toujours le dialogue. Les parents, épuisés, ne maîtrisent plus rien. Ken Loach ne réalise pas des films spectaculaires en terme de mise en scène mais ses films sont toujours d’une efficacité redoutable. Encore une fois, c’est une dénonciation implacable du néolibéralisme. Comme toujours, la grande force de Ken Loach est sa direction d’acteurs. Tous, professionnels et non professionnels, sont d’une justesse et d’un naturel confondants. Ken Loach est toujours en colère et c’est une excellente nouvelle pour nous, spectateurs.

A Naples, Martin Eden est un jeune homme séduisant qui travaille comme matelot depuis l’âge de 11 ans. Un jour, il sauve un inconnu des mains d’une brute. Pour le remercier, Martin est invité dans la maison du jeune homme qu’il a défendu. Il fait alors connaissance de la belle Elena dont il tombe amoureux. Mais Elena vient d’une famille bourgeoise, cultivée et érudite. Martin veut s’élever à son niveau, dévore tous les livres qu’il trouve pour y arriver et veut devenir écrivain.
Je considère « Martin Eden » comme un chef-d’oeuvre, j’attendais donc beaucoup du film de Pietro Marcello. Le film est fidèle à l’esprit du roman et on retrouve bien le caractère fougueux du héros de Jack London. L’intrigue est transposée de la Californie à Naples sans que cela soit gênant, elle reste inscrite dans une ville portuaire. Ce qui est original, c’est le changement d’époque. Pietro Marcello inscrit son héros dans une période indéfinie du XXème siècle où l’on sent tous les bouleversements à venir de ce siècle : révolution socialiste, guerre, etc… Mais cela n’est pas pesant, Martin Eden s’y inscrit parfaitement (une belle scène le voit se confronter aux ouvriers en grève pour leur expliquer que la seule voie à suivre est celle de l’individualisme libertaire). Pietro Marcello émaille son film d’images d’archives : le peuple de Naples, des bateaux, des manifestations. C’est une très belle idée qui fonctionne parfaitement. Autre point fort du film, le charismatique acteur principal, Luca Marinelli, qui interprète avec justesse toutes les nuances du personnages (de l’exaltation au dégoût de soi). Le film de Pietro Marcello est une réussite qui rend bien compte des thématiques abordées par Jack London et qui est servi par un formidable acteur à la hauteur du personnage.
Et sinon :
- « Ceux qui travaillent » de Antoine Russbach : Frank travaille pour une société de fret par cargos. Lors d’un transport de marchandises, un clandestin est découvert sur un bateau. Faire demi-tour pour le ramener chez lui ferait perdre trop de temps et il fait éviter qu’il soit découvert à la douane. Frank ordonne alors au capitaine de se débarrasser du problème. Profitant de l’événement pour se débarrasser d’un salarié qui coûtait trop cher, les patrons de l’entreprise renvoie Frank. Contrairement à ce que l’on pourrait attendre, Frank ne se remet pas en cause après ce licenciement. Il ne regrette pas ce qu’il a fait et recommencera sans problème s’il est question de profit. Il est prêt à tout pour maintenir son niveau de vie et d’ailleurs lorsque ses enfants apprennent son licenciement, ils lui ordonnent de pas faire baisser leur train de vie. Le film et le personnage de Frank sont glaçants. L’argent régit tout, même les liens familiaux. Olivier Gourmet interprète, toujours avec talent et justesse, un monstre de froideur et de calcul. Un film implacable sur un monde sans pitié.
- « Alice et le maire » de Nicolas Pariser : Alice est une jeune normalienne qui vient de se faire embaucher à la mairie de Lyon. Son rôle est simple : il faut qu’elle l’aide le maire à penser à nouveau. Celui-ci est un veux briscard de la politique qui refuse de quitter le devant de la scène. Alice réalise donc des fiches sur des sujets généraux comme la modestie. La jeune femme découvre les coulisses du pouvoir avec ses revirements, les egos démesurés et les inaugurations à tour de bras. Le film de Nicolas Pariser utilise le ton de la comédie pour nous montrer les arcanes du pouvoir dans une grande ville. La communication prend une place importante, tout semble être une question d’affichage. Une jolie relation se crée entre le maire mélancolique et la jeune diplômée, le 1er ayant besoin de la fougue de l’autre pour redécouvrir l’envie de participer au jeu politique. Fabrice Luchini joue parfaitement bien la mélancolie, la lassitude de ce maire en place depuis trop longtemps et Anaïs Demoustier apporte beaucoup de fraîcheur à cette comédie.
- « Shaun le mouton : la ferme contre-attaque » de Will Becher et Richard Phelan : A la ferme, la bande de Shaun tente toujours de se trouver des occupations réjouissantes comme le lancer de mouton par canon, le saut à partir d’une rampe ou la conduite de tracteur. Heureusement que le chien de la ferme vient remettre de l’ordre dans la cour. Un étrange individu va venir perturber le quotidien des animaux. Il s’agit de Lu-la, jeune alien qui vient d’atterrir à proximité de la ferme. Elle est recueillie par Shaun et sa bande qui vont la protéger des agents gouvernementaux qui sont à sa poursuite. Même si les aventures de Shaun s’adressent plus à un public jeune, c’est toujours un plaisir de retrouver les personnages des studios Aardman. Le film est bourré de gags et de références qui cette fois sont à l’attention des adultes : Men in black, Rencontres du 3ème type, Doctor Who, 2001 l’odyssée de l’espace, X-Files. Comme toujours avec les studios Aardman, les décors regorgent de détails drôles, tout est peaufiné avec une grande minutie. L’inventivité, le rythme des gags, la tendresse font de ce film un spectacle réussi qui plaira à toutes les générations.