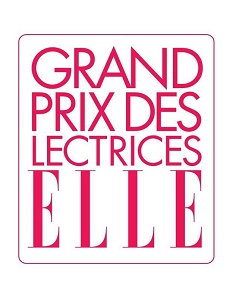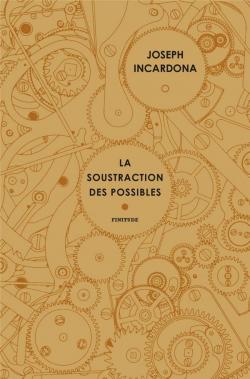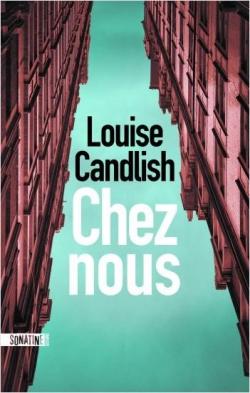Elizabeth Day est journaliste, écrivaine et elle est aussi la créatrice d’un podcast qui a rencontré un énorme succès : How to fail with Elizabeth Day. Deux ans après un divorce douloureux à 36 ans, elle a décidé de créer son podcast pour discuter avec des personnalités des échecs qu’elles ont pu connaitre. Le constat est évident : tout le monde a connu l’échec dans sa vie professionnelle ou personnelle et chacun a pu en tirer des leçons, a pu apprendre de ses échecs pour mieux rebondir ou se réinventer.
Son livre est inspiré de son podcast et elle y raconte ses propres échecs à l’école, au travail, avec sa famille, ses amis, son couple. Le récit de ses expériences douloureuses est émaillé des exemples tirés de son podcast et de l’expérience de Jessie Burton, Phoebe Waller-Bridge, David Nicholls, Tara Westover, Sebastian Faulks, Nicole Kidman, Robert Pattinson pour n’en citer que quelque uns.
Dans une société de la performance, des réseaux sociaux aux images parfaites, l’échec ne semble pas avoir sa place. La société nous envoie des injonctions permanentes à la perfection, surtout aux femmes. Elizabeth Day a longtemps tout fait pour l’atteindre, elle était dans une volonté de plaire aux autres et de leur faire plaisir (c’est ainsi qu’elle se retrouva à manger du blaireau dans une maison isolée ou à essayer un sauna vaginal à la manière de Gwyneth Paltrow pour des articles). De siècles de misogynie institutionnalisée ont mené les femmes à vouloir être toujours plus parfaites, plus performantes dans de nombreux domaines. Ce qui est impossible à réaliser et donne un sentiment d’échec.
« L’art d’échouer » est un livre d’une parfaite honnêteté, Elizabeth Day n’hésite pas à montrer ses failles, sa vulnérabilité, ses complexes. Elle le fait avec beaucoup d’humour et le recul nécessaire pour montrer à quel point ses échecs lui ont été utiles pour se construire et trouver sa voix. Son témoignage est précieux tant il permet de se décomplexer et de réfléchir sur son propre parcours.
Drôle, intelligent, déculpabilisant, « L’art d’échouer » dévoile les déboires douloureux du parcours d’Elizabeth Day mais également la manière dont elle a su les exploiter pour se reconstruire et s’épanouir.